- ACCUEIL
- L’UE en 2024
- UKRAINE
- Introduction
- Solidarité avec l’Ukraine
- Aider l’économie ukrainienne
- Accords d’intégration et autres accords
- La reconstruction de l’Ukraine
- Soutenir les États membres et les agriculteurs de l’UE
- Sanctions de l’UE
- Demander des comptes à la Russie
- Soutenir une paix et une sécurité justes pour l’Ukraine
- COMPÉTITIVITÉ
- ÉCONOMIE
- CLIMAT
- NUMÉRIQUE
- SOCIAL
- PERSONNES
- MONDE
- DÉMOCRATIE
CHAPITRE 4
Vers une Europe neutre pour le climat

 Voir la légende de la photo
Voir la légende de la photo
Le pacte vert pour l’Europe définit les mesures proposées par l’Union européenne (UE) pour faire face à la triple crise planétaire du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution. Afin de protéger les populations et la planète, l’UE s’est engagée à devenir neutre pour le climat — c’est-à-dire à transitionner vers une économie à zéro émission nette et exempte de pollution nocive — à l’horizon 2050, principalement en réduisant ses émissions, en investissant dans les technologies vertes et en préservant le milieu naturel. Cet engagement s’inscrit dans un nouveau modèle de croissance pour l’Europe reposant sur une économie propre et circulaire et faisant la promotion d’une transition propre qui soit économiquement saine et socialement équitable. En 2024, la priorité portait sur la mise en œuvre du cadre juridique du pacte vert pour l’Europe afin d’atteindre l’objectif climatique de l’UE à l’horizon 2030 et de préparer la voie à la réalisation d’un objectif en la matière pour 2040 en application de la loi européenne sur le climat. Alors que l’année 2024 a, elle aussi, été marquée par des phénomènes météorologiques extrêmes et par leurs effets dévastateurs, l’importance de renforcer la résilience face au changement climatique a été mise en évidence par la publication de l’évaluation européenne des risques climatiques, elle-même suivie de l’annonce d’un plan européen d’adaptation au changement climatique.
Au cours d’une autre année record pour les températures à l’échelle mondiale, l’Europe a continué d’être aux prises avec les dures réalités induites par la rapidité du changement climatique. Les États membres et régions de l’UE ont connu de multiples phénomènes climatiques extrêmes — qu’il s’agisse des sécheresses persistantes dans le sud de l’Europe et des graves incendies de forêt au Portugal et en zone méditerranéenne, ou des inondations meurtrières en Europe centrale et orientale et en Espagne, qui ont, ensemble, coûté la vie à plus de 250 personnes.
On a enregistré une augmentation notable du nombre des activations du mécanisme de protection civile de l’UE - ouvrir un nouvel onglet. en réaction à des événements météorologiques extrêmes. Ces tendances mettent en évidence l’intensification des effets du changement climatique sur le continent, qui donne lieu à une demande accrue de réaction coordonnée en cas de catastrophe. Face à cette intensification, les nations européennes ont renforcé leur coopération et fait preuve de solidarité en période de crise. En 2024, l’UE a pris de nouvelles mesures pour consolider son mécanisme de protection civile afin de mieux se préparer aux catastrophes sur tout son territoire et au-delà, de mieux prévenir celles-ci et de mieux y réagir. Ces mesures ont notamment consisté à renforcer la flotte aérienne de lutte contre les incendies de rescEU - ouvrir un nouvel onglet. et à poster de manière stratégique des pompiers dans tous les lieux névralgiques du territoire européen pour qu’ils épaulent les sapeurs-pompiers locaux.
Les auteurs du rapport annuel sur l’état du climat en Europe - fichier PDF, ouvrir un nouvel onglet. ont souligné la tendance haussière alarmante des températures, le réchauffement de l’Europe étant deux fois supérieur à la moyenne planétaire, et ont insisté sur la nécessité pour l’UE de devenir neutre pour le climat et résiliente face au changement climatique. La fréquence et la gravité des événements météorologiques extrêmes se sont accrues, entraînant une augmentation des décès liés à la chaleur, de graves canicules marines et des perturbations frappant l’agriculture, l’approvisionnement en eau et les infrastructures.




Vers une plus grande résilience face au changement climatique
Les dévastations et destructions causées par des événements météorologiques extrêmes témoignent de la nécessité urgente d’être mieux préparés à anticiper les effets du changement climatique et à y apporter des solutions. De même que l’UE s’emploie à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à circonscrire le changement climatique, elle doit également renforcer sa capacité de résilience face aux effets qui sont inévitables. Donnant suite à la toute première évaluation européenne des risques climatiques - ouvrir un nouvel onglet. publiée par l’Agence européenne pour l’environnement, la Commission européenne a présenté des initiatives de premier plan - ouvrir un nouvel onglet. permettant de faire face aux risques climatiques et d’œuvrer à une Europe résiliente face au changement climatique afin de protéger les populations et la prospérité.
Le cadre d’action pour renforcer la résilience climatique
GOUVERNANCE
- Une plus grande clarté quant aux responsabilités et quant aux risques qui sont gérés au niveau, respectivement, de l’UE et des États membres.
- L’établissement de processus à l’échelle de l’UE visant à mieux intégrer le risque climatique dans la planification et l’élaboration des politiques.
- Les États membres devraient veiller à disposer de capacités suffisantes pour faire face aux risques.
POLITIQUES STRUCTURELLES
- Les États membres devraient tenir compte des risques climatiques dans les décisions d’aménagement du territoire et dans les mesures de protection des infrastructures critiques.
- Des mécanismes de solidarité de l’UE renforcés pour inciter davantage à l’anticipation des risques.
OUTILS
- Accès amélioré aux données, aux modèles et aux scénarios nécessaires à une prise de décision éclairée sur des questions allant des systèmes d’alerte précoce à la planification à long terme.
- Soutien continu au renforcement des capacités et à la fourniture de lignes directrices, ainsi qu’à une meilleure utilisation des outils existants.
RÉSILIENCE FINANCIÈRE
- Veiller à ce que la résilience climatique soit au cœur de toutes les décisions de l’UE en matière de dépenses.
- Les institutions financières publiques et privées ainsi que l’industrie devraient améliorer la mobilisation des investissements privés.
- Les États membres devraient tenir compte de la résilience dans leurs procédures de passation de marchés publics.
Ces actions s’appuient sur la mise en œuvre de la stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique, adoptée en 2021 - ouvrir un nouvel onglet., qui est bien engagée. Les États membres, qui font figurer la résilience au changement climatique dans leur projet de plan national en matière d’énergie et de climat - ouvrir un nouvel onglet., ont reçu des recommandations de la Commission relatives à l’amélioration de leurs mesures d’adaptation conformément à la loi européenne sur le climat - ouvrir un nouvel onglet.. La mission de l’UE «Adaptation au changement climatique» - ouvrir un nouvel onglet. spécialement créée a pour objectif d’accompagner au moins 150 régions et collectivités dans l’appréhension des risques climatiques, dans l’élaboration de parcours de préparation et dans la mise en œuvre de solutions innovantes d’ici à 2030.
Dans son rapport spécial sur l’adaptation au changement climatique dans l’UE - ouvrir un nouvel onglet., publié en octobre, la Cour des comptes européenne a conclu qu’il était à craindre que la politique de l’UE en matière d’adaptation évolue moins vite que le changement climatique. Le rapport a formulé plusieurs recommandations: améliorer la manière dont les États membres font rapport sur l’adaptation au changement climatique; faire un meilleur usage des outils d’adaptation mis au point par l’UE; et assurer la pérennité du financement, par l’UE, de l’adaptation au changement climatique. La Commission a accepté ou partiellement accepté ces recommandations. La nouvelle Commission aura notamment pour priorité de proposer un plan européen d’adaptation au changement climatique destiné à aider les États membres et l’UE à renforcer sensiblement leur résilience au changement climatique.
Le 15 juillet a eu lieu la deuxième Journée annuelle de l’UE pour les victimes de la crise climatique mondiale, qui a été l’occasion de rendre hommage aux personnes touchées et de prôner des actions visant à atténuer les conséquences des catastrophes à venir. Nombre d’États membres ne sont pas encore entièrement remis d’événements météorologiques catastrophiques. En août, la Commission a proposé - ouvrir un nouvel onglet. l’octroi de plus de 1 milliard d’euros d’aide du Fonds de solidarité de l’UE - ouvrir un nouvel onglet. à la Grèce, à la France, à l’Italie, à l’Autriche et à la Slovénie pour permettre à ces pays de faire face aux conséquences des inondations survenues en 2023. En réaction aux inondations et aux incendies de forêt dévastateurs qui ont frappé l’Europe centrale, orientale et méridionale à l’automne 2024, la Commission a proposé de faciliter l’utilisation des fonds de la politique de cohésion - ouvrir un nouvel onglet. afin d’aider les États membres touchés par des catastrophes d’origine climatique. En novembre, un dispositif d’aide de 116 millions d’euros - ouvrir un nouvel onglet. provenant du Fonds de solidarité de l’UE a été approuvé pour soutenir l’Allemagne et l’Italie à la suite des catastrophes naturelles dévastatrices survenues au printemps.
Changement climatique et santé
Près de 500 chercheurs, décideurs et organismes de financement du monde entier se sont réunis à l’occasion d’une conférence de haut niveau - ouvrir un nouvel onglet. qui s’est tenue à Bruxelles (Belgique) en février pour réfléchir aux besoins en matière de recherche dans le domaine du changement climatique et de la santé. Les participants, qui ont discuté des priorités et défis les plus importants dans ce domaine, ont entamé les travaux de préparation d’un programme de recherche et d’innovation européen qui se veut ambitieux, tourné vers l’avenir et inclusif tout en présentant une perspective mondiale.

Les effets du changement climatique ont entraîné la présence accrue en Europe de moustiques susceptibles de transmettre des maladies graves. L’UE y a réagi en autorisant - ouvrir un nouvel onglet. le tout premier vaccin contre le virus Chikungunya. Dans un rapport - ouvrir un nouvel onglet., le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a confirmé la présence dans 13 pays européens du moustique Aedes albopictus (moustique tigre), vecteur du Chikungunya. Le moustique Aedes aegypti, qui s’est récemment implanté à Chypre, peut également contribuer à la propagation du Chikungunya ainsi que du Zika, de la dengue et de la fièvre jaune. L’autorisation de ce premier vaccin a été approuvée à l’unanimité par les États membres à la suite d’une évaluation - ouvrir un nouvel onglet. rigoureuse réalisée par l’Agence européenne des médicaments. Afin de réduire davantage le risque de propagation de maladies transmises par les moustiques en Europe, la Commission a annoncé le financement, à hauteur de 500 000 euros au titre du programme «L’UE pour la santé», d’un projet pilote visant à éradiquer le moustique Aedes aegypti à Chypre.
Consultez le site web de l’Observatoire européen du climat et de la santé - ouvrir un nouvel onglet. pour savoir comment l’Europe renforce sa résilience face aux risques sanitaires associés au changement climatique.
Le pacte vert pour l’Europe - ouvrir un nouvel onglet. est à l’origine des changements nécessaires pour parvenir à la neutralité climatique à l’horizon 2050. La réglementation visant à atteindre, et même à dépasser, l’objectif à moyen terme de l’UE consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 est désormais en vigueur.
Par l’adoption de la loi européenne sur le climat - ouvrir un nouvel onglet. et des instruments législatifs relevant du pacte vert pour l’Europe - ouvrir un nouvel onglet., l’UE dispose désormais d’objectifs climatiques juridiquement contraignants qui s’appliquent à tous les secteurs clés de l’économie. Elle s’engage ainsi sur une trajectoire qui lui permettra d’atteindre ses objectifs de 2030 d’une manière équitable, compétitive et d’un bon rapport coût/efficacité. Afin d’assurer aux entreprises européennes des conditions de concurrence équitables, un nouveau mécanisme - ouvrir un nouvel onglet. prévoit le paiement d’un prix du carbone équivalent pour les marchandises importées dans des secteurs ciblés. En outre, dans les régions les plus touchées, les travailleurs seront accompagnés pour développer de nouvelles compétences, tandis que les citoyens et entreprises vulnérables bénéficieront d’un soutien social.
L’étape ultérieure sur la voie de la neutralité climatique a été la présentation - ouvrir un nouvel onglet., par la Commission, de son évaluation en vue d’un objectif climatique pour l’UE à l’horizon 2040. La Commission y recommande de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre de 90 % d’ici à 2040 par rapport aux niveaux de 1990, conformément aux récents avis scientifiques et aux engagements pris par l’UE au titre de l’accord de Paris - ouvrir un nouvel onglet.. La nouvelle Commission s’inspirera de cette évaluation afin d’élaborer sa proposition législative concernant l’objectif pour 2040 prévue par la loi européenne sur le climat.
À l’instar des réductions approfondies et soutenues des émissions, la réduction recommandée de 90 % ne pourra être atteinte que par l’adoption de mesures visant à éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère. Cela signifie que l’UE aura besoin de technologies permettant de capter le dioxyde de carbone ou de l’éliminer directement de l’atmosphère, et ultérieurement de le stocker ou de l’utiliser. La stratégie de gestion industrielle du carbone - ouvrir un nouvel onglet., présentée en mars, répertorie un ensemble d’initiatives qui devront être prises au niveau de l’UE et à celui des États membres pour permettre le déploiement de ces technologies et des infrastructures nécessaires en vue de la création d’un marché unique du dioxyde de carbone en Europe au cours des décennies à venir. Un règlement - ouvrir un nouvel onglet. a été adopté - ouvrir un nouvel onglet. en novembre, qui crée le premier cadre volontaire de certification à l’échelle de l’UE relatif aux absorptions de carbone, à l’agrostockage de carbone et au stockage de carbone dans des produits sur tout le territoire européen. Cela facilitera les investissements aussi bien dans les technologies innovantes d’absorption de carbone que dans les solutions durables d’agrostockage de carbone - ouvrir un nouvel onglet..

Aider l’industrie de l’UE à atteindre l’objectif «zéro net»
Le règlement pour une industrie «zéro net» - ouvrir un nouvel onglet., entré en vigueur en juin, instaure un cadre réglementaire visant à stimuler la compétitivité de l’industrie et à donner une impulsion aux technologies qui aideront l’UE à atteindre ses objectifs climatiques. L’UE est ainsi engagée sur la voie du renforcement de sa production intérieure de technologies propres essentielles. En créant un environnement unifié et prévisible pour les entreprises produisant des technologies propres, ce règlement permettra d’accroître la sécurité en matière de planification et d’investissement, et favorisera la création d’emplois de qualité et l’avènement d’une main-d’œuvre qualifiée (voir également le chapitre 2).
À l’automne, l’UE a commencé à accepter des demandes de reconnaissance - ouvrir un nouvel onglet. de projets de production de technologies propres, qui doivent être dénommés «projets stratégiques “zéro net”» selon le règlement pour une industrie «zéro net». Les projets approuvés dynamiseront le secteur des technologies propres de l’UE et permettront de renforcer la compétitivité et l’action pour le climat, tandis que ceux qui porteront ces projets bénéficieront de procédures d’octroi de permis plus rapides, d’un traitement prioritaire à l’échelle nationale et de conseils en matière de financement.
Le lancement de l’Académie solaire européenne - ouvrir un nouvel onglet. en juin jouera un rôle prépondérant pour ce qui est de doter les personnes des compétences dont elles ont besoin pour travailler dans le secteur de l’énergie solaire, étape essentielle à la réalisation par l’UE de ses objectifs en matière d’énergies renouvelables. Cette académie est la première d’une série d’académies européennes qui sont créées en vertu du règlement pour une industrie «zéro net».
Le marché mondial des technologies «zéro net» devrait tripler d’ici à 2030, avec une valeur annuelle d’environ 600 milliards d’euros.
Technologies «zéro net» essentielles
- SYSTÈMES SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES ET SYSTÈMES SOLAIRES THERMIQUES
- ÉLECTROLYSEURS ET PILES À COMBUSTIBLE
- ÉNERGIE ÉOLIENNE TERRESTRE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES EN MER
- BIOGAZ/BIOMÉTHANE DURABLE
- BATTERIES ET STOCKAGE
- CAPTAGE ET STOCKAGE DU CARBONE
- POMPES À CHALEUR ET ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE
- TECHNOLOGIES DE RÉSEAU
Faire progresser la transition vers une énergie propre
En réaction à la perturbation du marché mondial de l’énergie et aux graves difficultés causées par l’invasion non provoquée et injustifiée de l’Ukraine par la Russie en 2022, l’UE a lancé le plan REPowerEU - ouvrir un nouvel onglet. afin d’accélérer la transition vers une énergie propre et de réduire rapidement sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes. Au cours des deux dernières années, REPowerEU a aidé l’UE à économiser l’énergie, à diversifier ses approvisionnements, à produire de l’énergie propre et à combiner avec intelligence investissements et réformes.
Les économies d’énergie et l’amélioration de l’efficacité énergétique ont contribué à réduire la consommation. Des progrès considérables ont également été accomplis dans le domaine des énergies renouvelables. Au premier semestre de 2024, la moitié de l’électricité produite dans l’UE était d’origine renouvelable. La Norvège a supplanté la Russie comme principal fournisseur de gaz de l’UE. Cette dernière s’est aussi nettement réorientée vers les importations de gaz naturel liquéfié, les États-Unis étant désormais son premier fournisseur. Surtout, l’UE a réussi à faire face aux risques critiques pesant sur la sécurité de son approvisionnement énergétique, à reprendre le contrôle du marché et des prix de l’énergie, et à accélérer la transition vers la neutralité climatique.
- En 2024, l’énergie éolienne est passée, pour la première fois, devant la production de gaz, devenant ainsi la deuxième source d’électricité de l’UE derrière le nucléaire.
- La part des importations de gaz russe (acheminé par gazoduc, et le gaz naturel liquéfié) dans les importations totales de l’UE a chuté, passant de 45 % en 2021 à seulement 19 % en 2024.
- L’UE est parvenue à réduire sa demande de gaz de 18 % entre août 2022 et novembre 2024, soit une économie d’environ 165 milliards de mètres cubes.
- Les mesures prises au niveau de l’UE et à celui des États membres ont porté leurs fruits, les prix de l’électricité et du gaz étant désormais bien plus bas et plus stables qu’au plus fort de la crise énergétique.
- Par ailleurs, les émissions de gaz à effet de serre de l’UE ont diminué de 37 % par rapport à leur niveau de 1990, l’économie enregistrant sur la même période une croissance de 68 %.

Réforme du marché de l’électricité
Les marchés de l’énergie ont retrouvé une certaine stabilité, les prix pratiqués étant inférieurs à ceux de 2022 et 2023. Grâce à l’adoption de nouvelles réglementations, telles que le nouveau règlement et la nouvelle directive relatifs à la réforme du marché de l’électricité - ouvrir un nouvel onglet., les prix de détail devraient être davantage décorrélés des prix des marchés à court terme. En cas d’une crise future des prix du gaz, les États membres pourront introduire des mesures visant à protéger les consommateurs et à garantir l’accès à une énergie à prix abordable ainsi qu’à des services sociaux essentiels. La réforme du marché de l’électricité permet également aux consommateurs de bénéficier d’un choix de contrats plus vaste et de recevoir des informations plus claires avant de s’engager. La pérennité des marchés de l’énergie permettra également de stimuler les investissements dans l’énergie propre et contribuera à faire baisser les prix et à les stabiliser, élément clé pour renforcer la compétitivité de l’industrie européenne à l’échelle mondiale.
La réforme du marché européen de l’électricité permettra:
- de stimuler l’investissement dans les énergies renouvelables;
- de mieux protéger les consommateurs de l’UE et de leur donner des moyens d’action;
- de renforcer la compétitivité de l’industrie de l’UE.
Accroître l’efficacité énergétique des bâtiments
Le secteur du bâtiment revêt une importance cruciale pour la concrétisation des objectifs de l’UE en matière d’énergie et de climat. La directive révisée sur la performance énergétique des bâtiments - ouvrir un nouvel onglet., entrée en vigueur en mai, contribuera à l’augmentation du taux de rénovation dans l’UE, en particulier des bâtiments les moins performants. La nouvelle réglementation définit un cadre permettant aux États membres de réduire les émissions et la consommation d’énergie dans les bâtiments, qu’il s’agisse des logements, des locaux commerciaux ou des bâtiments publics, ce qui concourra à améliorer la santé et la qualité de vie des citoyens et à faire baisser le montant des factures.
- Quelque 40 % de l’énergie consommée dans l’UE est utilisée dans les bâtiments.
- Les bâtiments représentent pour plus d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre liées à l’énergie au sein de l’UE.
- Environ 80 % de l’énergie utilisée dans les foyers européens est destinée au chauffage, au refroidissement et à l’eau chaude.
Dynamiser le marché européen de l’hydrogène
La décarbonation du secteur gazier de l’UE et la création d’un marché de l’hydrogène contribueront de manière essentielle à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050. Les nouvelles règles - ouvrir un nouvel onglet. sur l’hydrogène et le gaz bas carbone, adoptées en mai par l’UE, y compris un réseau européen des gestionnaires de réseau d’hydrogène - ouvrir un nouvel onglet. et un mécanisme pilote - ouvrir un nouvel onglet. qui vise à faciliter les contacts entre acheteurs et fournisseurs, permettront de dynamiser le marché de l’hydrogène. De nouvelles mesures d’incitation en faveur de l’hydrogène renouvelable, telles que la première enchère organisée par la Banque européenne de l’hydrogène - ouvrir un nouvel onglet. et l’approbation - ouvrir un nouvel onglet. de quatre projets importants d’intérêt européen commun - ouvrir un nouvel onglet. sur l’hydrogène, devraient générer davantage d’investissements. L’UE s’est engagée à créer, d’ici à 2030, au moins 50 vallées de l’hydrogène - ouvrir un nouvel onglet., au sein desquelles de l’hydrogène propre sera produit et utilisé localement par les ménages, dans les transports et par l’industrie.

Les règles en matière d’aides d’État, telles que les lignes directrices concernant les aides au climat, à l’énergie et à la protection de l’environnement - ouvrir un nouvel onglet., contribuent à permettre aux États membres d’atteindre les objectifs fixés par le pacte vert pour l’Europe. Ces lignes directrices favorisent le déploiement des énergies renouvelables en permettant aux États membres d’accorder, au coût le plus bas possible pour les contribuables et sans distorsion indue de concurrence, un financement public aux entreprises qui réalisent les investissements nécessaires.
Faire progresser le plan d’action «zéro pollution»
La pollution présente de multiples risques pour la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes. Afin de se rapprocher de son objectif «zéro pollution», l’UE prend des mesures pour mieux surveiller, notifier et prévenir la pollution de l’air, de l’eau et des sols ainsi que les dommages causés par les substances chimiques et pour y remédier.
L’EAU
Plusieurs nouvelles mesures visant à garantir la qualité de l’eau potable pour tous dans l’UE ont été adoptées en 2024. De nouvelles normes et procédures - ouvrir un nouvel onglet. applicables aux matériaux et aux produits qui entrent en contact avec l’eau potable visent à empêcher la prolifération microbienne et à réduire le risque de lixiviation des substances nocives des matériaux dans l’eau potable. Une nouvelle méthode - ouvrir un nouvel onglet. de mesure des microplastiques a également été adoptée, tandis que des lignes directrices techniques - ouvrir un nouvel onglet. ont été établies pour la surveillance des substances chimiques persistantes.
Les eaux urbaines résiduaires sont l’une des principales sources de pollution des eaux, si elles ne sont pas collectées et traitées conformément à la législation de l’UE. Un accord a été trouvé - ouvrir un nouvel onglet. sur de nouvelles règles visant à réduire davantage la pollution de sources urbaines et à lutter contre les polluants émergents, dont les microplastiques et les micropolluants. En cohérence avec le principe du «pollueur-payeur», la responsabilité élargie des producteurs a été introduite. Cela signifie que les pollueurs devront supporter les coûts du traitement pour éliminer les micropolluants. De nouvelles lignes directrices - ouvrir un nouvel onglet. ont été publiées afin que les autorités des États membres veillent à ce que la réutilisation, pour l’agriculture, des eaux résiduaires traitées soit sûre.
Le rapport annuel - ouvrir un nouvel onglet. de l’UE sur l’état des plages et des zones de baignade fait apparaître que les eaux de baignade européennes restent sûres, plus de 85 % d’entre elles satisfaisant à la norme de qualité de l’eau «excellente».
L’UE a adopté - ouvrir un nouvel onglet. quatre nouveaux actes législatifs qui la doteront de nouveaux outils pour soutenir un transport maritime propre et moderne. Les règles adoptées visent également à contribuer à la prévention des rejets illégaux et à la préservation des écosystèmes marins.
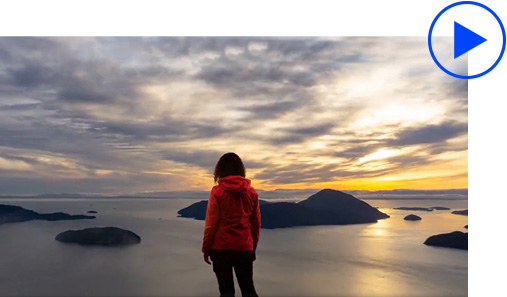
L’AIR
Un nouvel acte législatif - ouvrir un nouvel onglet. visant à renforcer les normes de qualité de l’air de l’UE pour 2030 afin de mieux protéger la santé humaine et l’environnement est entré en vigueur - ouvrir un nouvel onglet. en décembre. Les règles révisées réduisent de plus de moitié la valeur limite annuelle du principal polluant — à savoir les particules fines. Les personnes dont la santé aura été affectée par la pollution atmosphérique auront également le droit d’être indemnisées en cas de violation des règles de l’UE en matière de qualité de l’air.
LES ÉMISSIONS INDUSTRIELLES
Une grande partie de la pollution dans l’UE, qui englobe l’émission de polluants atmosphériques, les rejets d’eaux usées et la production de déchets, provient des processus de production industrielle. De nouvelles règles - ouvrir un nouvel onglet. permettront de réduire davantage les émissions des principaux polluants dans l’air, dans l’eau et dans le sol, en ce qu’elles s’appliqueront à des sources d’émissions supplémentaires et rationaliseront les dispositions régissant l’octroi des permis d’exploitation aux installations industrielles et aux exploitations agricoles concernées. Elles instaurent, en outre, des obligations et des mesures qui permettront d’améliorer les informations mises à la disposition du public sur les émissions des plus grandes installations industrielles de l’UE et sur l’utilisation que ces dernières font des ressources. Le Centre d’innovation pour la transformation et les émissions industrielles - ouvrir un nouvel onglet., créé en juillet, a pour objectif d’accélérer la mise au point et l’adoption de solutions innovantes de lutte contre la pollution.
LES SOLS
Dans le cadre de ses efforts pour améliorer l’état de santé des sols en Europe, l’UE ambitionne de créer 100 laboratoires vivants - ouvrir un nouvel onglet. et phares - ouvrir un nouvel onglet. (sites de démonstration de solutions pouvant servir d’exemples) d’ici à 2030. Au titre de l’initiative de l’UE qu’est la mission «Sols» - ouvrir un nouvel onglet., les 25 premiers laboratoires vivants ont été sélectionnés et lancés, au sein desquels de nombreux partenaires se réunissent pour cocréer des solutions et des modèles économiques et pour les expérimenter en conditions réelles. En outre, 10 projets relevant de la mission «Sols» portent précisément sur l’élaboration de stratégies, de modèles et de solutions d’assainissement visant à surveiller et à lutter contre la pollution des terres et des eaux dans les zones urbaines, rurales et côtières ainsi qu’à suivre de près et à mener à bien la décontamination de ces terres et de ces eaux.
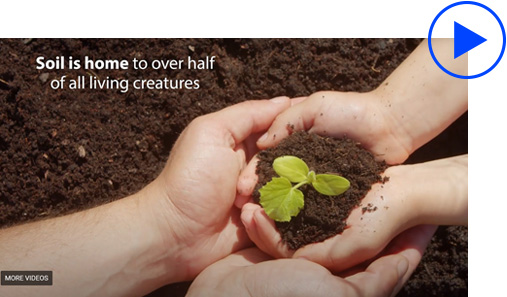
LES SUBSTANCES CHIMIQUES
L’UE a instauré des principes directeurs - ouvrir un nouvel onglet. permettant de déterminer ce qui constitue une «utilisation essentielle» des substances chimiques particulièrement nocives pour la société. L’objectif est de parvenir à une élimination progressive plus rapide des utilisations des substances particulièrement nocives qui sont non essentielles, tout en autorisant un délai plus long pour l’élimination progressive des utilisations qui sont essentielles pour la société et pour lesquelles il n’existe pas encore de solutions de remplacement.
De nouvelles règles - ouvrir un nouvel onglet. qui interdisent les derniers cas d’utilisation intentionnelle de mercure sont entrées en application sur l’ensemble du territoire de l’UE en 2024. Elles interdisent l’utilisation et l’exportation d’amalgames dentaires à partir du 1er janvier 2025. Les États membres qui ont besoin de plus de temps pour adapter leur système de santé national peuvent se voir accorder une dérogation limitée et temporaire pour l’utilisation, la fabrication et l’importation d’amalgames dentaires (jusqu’au 30 juin 2026). À terme, les matériaux d’obturation dentaire seront sans mercure, sauf lorsqu’il s’agira de répondre à des besoins médicaux spécifiques et que le praticien de l’art dentaire l’aura jugé strictement nécessaire.
L’UE a également adopté - ouvrir un nouvel onglet. de nouvelles mesures visant à restreindre la présence de certaines substances chimiques persistantes nocives dans des produits tels que textiles, cosmétiques et emballages, afin de protéger la santé humaine et l’environnement.
Le règlement révisé relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques est entré en vigueur - ouvrir un nouvel onglet. en décembre. Par ces nouvelles règles, l’UE a pour objectif de protéger les travailleurs, les consommateurs et l’environnement contre les substances chimiques dangereuses moyennant une meilleure communication sur les risques présents tout au long des chaînes d’approvisionnement.

En 2024, l’UE a continué de progresser sur la voie d’une économie circulaire, afin de diminuer la pression sur les ressources naturelles, de réduire les déchets et de créer une croissance et des emplois durables. La législation récemment adoptée contribuera à accroître la productivité des ressources et à renforcer la compétitivité et la résilience à long terme de l’économie de l’UE.
78 %
des habitants de l’UE estiment que l’environnement a un effet direct sur leur vie quotidienne et leur santé.
Ils considèrent que le moyen le plus efficace de résoudre les problèmes environnementaux est:
17 %
de promouvoir l’économie circulaire par la réduction des déchets et par la réutilisation ou le recyclage des produits;
15 %
de restaurer la nature;
14 %
de veiller au respect de la législation environnementale;
14 %
de veiller à ce que les produits vendus sur le marché de l’UE ne contribuent pas à nuire à l’environnement.
Source: Commission européenne, Eurobaromètre spécial 550 - ouvrir un nouvel onglet., mai 2024.
Faire des produits durables la norme
Les produits, et la manière dont nous les utilisons, peuvent avoir une incidence significative sur l’environnement, mais grâce aux nouvelles règles de l’UE, les produits durables deviendront progressivement la norme. Ce progrès résultera de l’entrée en vigueur de nouvelles règles - ouvrir un nouvel onglet. qui exigent que les biens ménagers et les produits industriels de consommation courante durent plus longtemps, utilisent plus efficacement l’énergie et les ressources, soient plus faciles à réparer et à recycler, et incluent un contenu recyclé plus élevé. Les consommateurs pourront également faire des choix plus durables grâce aux passeports numériques de produit - ouvrir un nouvel onglet. — des étiquettes scannables apposées sur les produits, qui permettront de consulter facilement les informations sur leur durabilité. La destruction des vêtements et chaussures invendus sera interdite par les nouvelles règles.
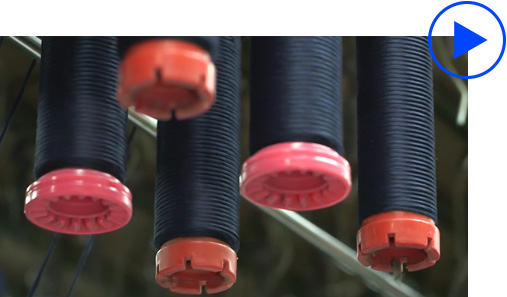
De nouvelles règles de l’UE - ouvrir un nouvel onglet. donnant aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique sont entrées en vigueur en mars. Ainsi, avant d’acheter un produit, les consommateurs recevront de meilleures informations sur sa durabilité et sa réparabilité, ainsi que sur la garantie légale dont ils bénéficient. Les entreprises ne pourront plus déclarer que des produits sont «verts» si elles ne peuvent démontrer une performance environnementale excellente reconnue. En outre, les pratiques commerciales déloyales, telles que celles liées à l’obsolescence précoce ou à de fausses allégations sur la durabilité d’un produit, seront interdites. Les nouvelles règles entreront en application en septembre 2026.
Encourager à réparer les biens contribue à une consommation durable. De nouvelles règles - ouvrir un nouvel onglet. établissant des mesures visant à augmenter le nombre de biens réparés dans le cadre de la garantie légale et en dehors de celle-ci sont entrées en vigueur en juillet. Les fabricants de produits auxquels le droit de l’UE impose des exigences de réparabilité (par exemple, pour les réfrigérateurs et les smartphones) devront réparer les produits dans un délai raisonnable, et à un prix raisonnable. Dans le cadre de la garantie légale, les vendeurs seront tenus de proposer la réparation, sauf si celle-ci est plus coûteuse que le remplacement. En dehors de la garantie légale, les consommateurs disposeront d’un nouvel ensemble de droits et d’instruments, pour que la réparation soit une option facile et accessible. Ils auront en outre droit à une année supplémentaire de garantie légale s’ils choisissent de réparer le produit au lieu de le remplacer. Ces nouvelles règles s’appliqueront à partir de juillet 2026.
Le recyclage permet non seulement d’économiser de l’énergie et de l’argent, mais aussi de constituer une bonne source de matières premières critiques. Un accès fiable et sans entrave à certaines matières premières est en effet une préoccupation croissante. La législation sur les matières premières critiques, entrée en vigueur - ouvrir un nouvel onglet. en mai, fixe des niveaux de référence pour que le recyclage produise au moins 25 % de la consommation annuelle de matières premières de l’UE. Elle comprend également des règles visant à améliorer la durabilité et la circularité des matières premières critiques sur le marché de l’UE.
Les résidents de l’UE produisent en moyenne environ un demi-kilo de déchets d’emballages chaque jour. De nouvelles règles - ouvrir un nouvel onglet. adoptées en décembre rendront les emballages plus durables en réduisant ceux qui sont inutiles, en limitant le suremballage et en augmentant le nombre de systèmes de consigne pour les bouteilles en plastique et les canettes métalliques. Chaque personne pourra ainsi économiser jusqu’à 100 euros par an si les entreprises répercutent leurs économies.
Les exportations de déchets de l’UE vers les pays tiers ont augmenté de 88 % depuis 2004 et atteint 35 millions de tonnes en 2023. De nouvelles règles visant à ce que l’UE assume une plus grande responsabilité pour ses propres déchets sont entrées en vigueur en mai. Le nouveau règlement - ouvrir un nouvel onglet. vise à ce que l’UE n’exporte plus ses déchets vers des pays tiers et qu’elle contribue à une gestion écologiquement rationnelle des déchets.
À l’occasion du festival du nouveau Bauhaus européen, en avril, les visiteurs ont été invités à une journée spéciale consacrée à la mode durable, qui comprenait une exposition de mode circulaire et inclusive rassemblant seize créateurs internationaux originaires de huit pays, qui présentaient leurs créations respectueuses de l’environnement. L’événement mettait l’accent non seulement sur l’attrait esthétique de la mode durable, mais aussi sur son rôle dans la promotion d’un mode de vie en harmonie avec notre environnement.

Environnement et nature
Un examen à mi-parcours du huitième programme d’action pour l’environnement - ouvrir un nouvel onglet., qui guidera la politique environnementale européenne jusqu’en 2030, confirme que les objectifs de l’UE fixés dans le pacte vert pour l’Europe sont réalisables si toutes les mesures prévues sont pleinement mises en œuvre. Il souligne, en outre, l’incidence économique et sociale positive de la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux, notamment en termes de bien-être, de santé, de résilience et de compétitivité, ainsi que de sécurité de l’approvisionnement pour les matières premières et les matériaux.
Le règlement relatif à la restauration de la nature - ouvrir un nouvel onglet., un acte novateur de l’UE qui vise à inverser le grave déclin de la biodiversité et à contribuer à la lutte contre le changement climatique, est entré en vigueur en août. Il s’inscrit dans la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité - ouvrir un nouvel onglet. et fixe des objectifs pour la restauration des écosystèmes dégradés, en particulier ceux qui sont les plus à même de capturer et stocker du carbone et de prévenir et limiter les effets des catastrophes naturelles. Ce nouveau règlement met en place des mesures destinées à restaurer au moins 20 % des zones terrestres et maritimes de l’UE d’ici à 2030. D’ici à 2050, des mesures devraient être en place pour tous les écosystèmes nécessitant une restauration. Les États membres doivent présenter, d’ici au milieu de l’année 2026, des plans nationaux de restauration indiquant comment ils atteindront les objectifs. Le règlement relatif à la restauration de la nature, qui est inédit dans le monde, aidera en outre l’UE et ses États membres à exécuter leurs engagements internationaux en matière de biodiversité prévus par le cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal - ouvrir un nouvel onglet..
Un projet - ouvrir un nouvel onglet. visant à restaurer la rivière allemande Isar et ses plaines inondables, grâce à une collaboration exceptionnelle entre les autorités bavaroises chargées de l’eau et de la nature, a remporté le prix LIFE 2024 pour la nature. Près d’une décennie après le lancement du projet, la rivière s’écoule à nouveau librement et des espèces menacées sont revenues.

Un projet financé par l’UE - ouvrir un nouvel onglet. aide le Danemark, l’Allemagne et les Pays-Bas à surveiller et à protéger les oiseaux d’eau migrateurs sur la voie de migration de l’Atlantique Est.

Le réseau de zones protégées Natura 2000 est au cœur de la politique de conservation de la nature de l’UE depuis trente ans. En 2024, les prix Natura 2000 - ouvrir un nouvel onglet. ont mis en lumière un large éventail de nouvelles initiatives — allant de la conservation et la gestion de la cigogne noire en Pologne à la conservation marine des «forêts bleues» au Portugal.

Le soutien destiné à stimuler les initiatives existantes s’est également poursuivi en 2024 avec, par exemple, la publication d’un nouveau guide - ouvrir un nouvel onglet. pour élaborer de meilleures politiques d’aménagement du territoire. Cela devrait aider tous les acteurs concernés à se familiariser avec la législation urbanistique, le changement d’affectation des sols et la foresterie, ainsi qu’avec les bonnes pratiques. Ce secteur est essentiel pour préserver la nature et lutter contre le changement climatique en éliminant le carbone à grande échelle. Dans la perspective de la Journée internationale des forêts qui aura lieu en mars, la Commission a organisé une conférence - ouvrir un nouvel onglet. pour intensifier les efforts en vue de planter 3 milliards d’arbres - ouvrir un nouvel onglet. d’ici à 2030, pour mieux résister aux menaces climatiques et environnementales.
La criminalité environnementale est une source de préoccupation croissante car elle cause des dommages considérables à l’environnement, à la santé des citoyens et à l’économie, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE. Une législation révisée - ouvrir un nouvel onglet., qui est entrée en vigueur en mai, s’attaquera aux violations les plus graves des obligations environnementales dans l’UE. Plusieurs nouvelles catégories d’infractions ont été introduites, telles que le recyclage de navires illicite et le captage d’eaux. Les nouvelles règles renforceront la chaîne répressive et aideront les défenseurs et les professionnels de l’environnement à lutter contre la criminalité environnementale. Les États membres disposent d’un délai de deux ans pour adapter leur législation nationale.
La criminalité environnementale:
- est la quatrième plus grande activité de criminalité organisée dans le monde;
- croît de 5 à 7 % par an;
- entraîne des pertes mondiales annuelles de 80 à 230 milliards d’euros.
Source: Programme des Nations unies pour l’environnement, The Rise of Environmental Crime — A growing threat to natural resources, peace, development and security - ouvrir un nouvel onglet., 2016.
Aider les agriculteurs européens
Ces dernières années, les agriculteurs européens ont été confrontés à un nombre exceptionnel de problèmes et d’incertitudes — allant d’une pandémie et d’une forte hausse des prix de l’énergie, aggravées par la guerre d’agression injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine, à des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents. En 2024, l’UE a continué de prendre des mesures pour les soutenir et les aider à relever les défis qui ont surgi depuis la réforme de la politique agricole commune - ouvrir un nouvel onglet..
En mars, la Commission a proposé la modification de certaines dispositions de la politique agricole commune, tout en maintenant son rôle dans le soutien à la transition de l’agriculture européenne vers une agriculture durable. Cette initiative était accompagnée de nouvelles mesures visant à alléger la charge administrative pesant sur les agriculteurs, dans le cadre d’une politique plus large de simplification des obligations de déclaration, lancée en 2023. L’avis des agriculteurs de l’UE sur les charges administratives liées à la politique agricole commune, dont les obligations de déclaration, a également été demandé dans le cadre d’une consultation en ligne, qui a recueilli 27 000 réponses.
Aide aux agriculteurs de l’UE
- Réduction d’au moins 50 % des visites liées à la politique agricole commune effectuées dans les exploitations par les administrations nationales.
- 98 milliards d’euros alloués à des mesures volontaires en faveur de l’environnement, du climat et du bien-être animal.
- Exploitations inférieures à 10 hectares exemptées des contrôles et sanctions liés aux exigences de conditionnalité - ouvrir un nouvel onglet..
Source: Commission européenne, «EU actions to address farmers’ concerns - ouvrir un nouvel onglet.», 2024.
La Commission a en outre proposé des mesures pour améliorer la rémunération des agriculteurs. L’Observatoire européen de la chaîne agroalimentaire - ouvrir un nouvel onglet. a été créé en juillet pour examiner les coûts de production, les marges et les pratiques commerciales. Il a pour objectif d’accroître la transparence et la confiance entre les parties prenantes, en publiant des données et en échangeant des informations. Des options pour de nouvelles règles destinées à corriger les déséquilibres dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire ont également été présentées. La Commission a en outre présenté un rapport - ouvrir un nouvel onglet., en avril, sur la mise en œuvre de la directive sur les pratiques commerciales déloyales - ouvrir un nouvel onglet. dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, qui alimentera une évaluation continue de la législation. En décembre, elle a proposé de nouvelles mesures - ouvrir un nouvel onglet. pour renforcer: la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire; et l’application transfrontière des règles contre les pratiques commerciales déloyales.
En 2024, un soutien à hauteur de 233 millions d’euros a été apporté aux agriculteurs touchés par des catastrophes naturelles et des phénomènes météorologiques extrêmes en Bulgarie, Tchéquie, Allemagne, Estonie, Grèce, Italie, Autriche, Pologne, Roumanie et Slovénie. Des mesures de soutien ont également été introduites pour remédier aux perturbations du marché dans le secteur vitivinicole au Portugal, ainsi qu’aux effets négatifs sur les marchés de la volaille et des œufs causés par la grippe aviaire en Italie.

Le dialogue stratégique sur l’avenir de l’agriculture de l’UE - ouvrir un nouvel onglet. a été lancé en janvier, réunissant 29 acteurs clés du secteur agroalimentaire en vue de façonner une vision commune de l’avenir du système agricole et alimentaire de l’UE.
En septembre, le rapport final sur le dialogue a été présenté. Intitulé Une perspective commune pour l’agriculture et l’alimentation en Europe - ouvrir un nouvel onglet., il présente une évaluation des défis et des possibilités, accompagnée de 14 recommandations. Ces suggestions guideront les travaux de la Commission lors de l’élaboration de sa vision pour l’agriculture et l’alimentation, dont la présentation est prévue au cours des 100 premiers jours du nouveau mandat politique (voir le chapitre 0).
Le nouveau règlement concernant les indications géographiques relatives aux vins, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles - ouvrir un nouvel onglet. est entré en vigueur en mai. Il crée un ensemble unique de règles et procédures de protection pour toutes les indications géographiques agricoles. Il renforce aussi leur protection, notamment en ligne et dans les noms de domaine internet.

En 2024, l’UE a négocié la suppression des barrières commerciales aux exportations irlandaises et françaises de viande bovine vers la Corée du Sud, permettant aux producteurs de ces États membres d’accéder à l’un des plus grands marchés d’importation de viande bovine au monde.

Pêche et aquaculture durables
Le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution des océans et des eaux douces menacent la durabilité des ressources halieutiques et aquacoles. Avec le paquet «pêche et océans» - ouvrir un nouvel onglet. de 2023, la Commission a présenté une série de mesures visant à relever ces défis grâce à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche - ouvrir un nouvel onglet.. Une consultation - ouvrir un nouvel onglet. destinée à évaluer le règlement relatif à la politique commune de la pêche a été lancée, et un rapport est attendu pour la fin de l’année 2025.
Les règles de contrôle sont fondamentales pour la mise en œuvre de la politique commune de la pêche, notamment pour surveiller l’utilisation des quotas de pêche et pour que les captures indésirées ne soient pas rejetées illégalement en mer. De nouvelles règles - ouvrir un nouvel onglet. adoptées pour moderniser le contrôle des activités de pêche, tant pour les navires de l’UE que pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l’UE, sont entrées en vigueur en janvier. Elles permettront d’empêcher la surpêche, de créer un système de contrôle de la pêche plus efficace et harmonisé, et d’assurer des conditions de concurrence équitables entre les différents bassins maritimes et les flottes. Elles allégeront également la charge administrative, grâce à la numérisation, et encourageront le recours aux technologies.
En décembre, les ministres de la pêche de l’UE sont parvenus à un accord - ouvrir un nouvel onglet. sur les possibilités de pêche pour 2025. L’accord comprend 12 mesures de durabilité - ouvrir un nouvel onglet. qui, si elles sont appliquées, offriront beaucoup de jours de pêche supplémentaires.
La Commission a également répondu aux demandes de réduire la charge administrative liée à la création et à l’exploitation de sites aquacoles dans l’UE. Elle a ainsi aidé les États membres à mettre en œuvre les orientations stratégiques visant à rendre l’aquaculture plus durable et plus compétitive.
Pour un océan durable
L’UE a réaffirmé son engagement en faveur de la gouvernance internationale des océans, en annonçant 40 engagements pour les actions de 2024 - ouvrir un nouvel onglet. lors de la conférence «Our Ocean» - ouvrir un nouvel onglet. en Grèce, financés par 3,5 milliards d’euros de fonds de l’UE. Les engagements sont axés sur des domaines tels que la pêche durable, les zones marines protégées, les océans et le changement climatique, les économies bleues durables et la pollution marine.

La pêche illicite, non déclarée et non réglementée constitue l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur l’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes, mettant en péril les efforts mondiaux visant à promouvoir une meilleure gouvernance des océans ainsi que la politique commune de la pêche de l’UE. En mai, l’UE a émis un «carton jaune - ouvrir un nouvel onglet.» à l’encontre du Sénégal pour lui signifier la nécessité d’intensifier la lutte contre ce type de pêche. La valeur totale estimée de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est de l’ordre de 10 à 20 milliards d’euros par an. Chaque année, entre 11 et 26 millions de tonnes de poissons sont capturés de manière illicite, ce qui correspond à au moins 15 % des captures mondiales.
Des décisions importantes - ouvrir un nouvel onglet., notamment en ce qui concerne la gestion des dispositifs flottants utilisés pour capturer le thon et d’autres poissons, contribueront à rendre la pêche dans l’océan Indien plus durable. Sur la base d’une proposition de l’UE, une résolution mettant progressivement en œuvre la biodégradabilité complète des dispositifs de concentration de poissons dérivants d’ici à 2030 a été adoptée lors de la 28e réunion annuelle de la Commission des thons de l’océan Indien, qui a eu lieu en mai. Le cadre réglementaire qui régit ces dispositifs a également été amélioré, afin d’accroître la traçabilité et la conformité.
L’UE est prête à ratifier le traité sur la haute mer - ouvrir un nouvel onglet., également connu sous le nom d’«accord sur la biodiversité des zones ne relevant pas de la juridiction nationale». Elle le fera conjointement avec plusieurs États membres avant la troisième conférence des Nations unies sur les océans, qui se tiendra en juin 2025. Le traité vise à protéger les océans, à promouvoir l’équité et la justice, à remédier à la dégradation de l’environnement, à lutter contre le changement climatique et à prévenir la perte de biodiversité en haute mer. Le traité entrera en vigueur dès que les 60 parties l’auront ratifié. L’UE prépare activement sa mise en œuvre et soutient d’autres pays dans leurs préparatifs pour le ratifier et le mettre en œuvre.
Les transports représentent près d’un quart des émissions de gaz à effet de serre de l’UE. Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, l’UE ambitionne de réduire les émissions liées aux transports de 90 % d’ici à 2050. La stratégie de mobilité durable et intelligente - ouvrir un nouvel onglet. est une feuille de route pour parvenir à ces réductions ambitieuses des émissions. Au cours des cinq dernières années, des progrès considérables ont été accomplis pour rendre le secteur des transports de l’UE plus durable.
Plus de 90 % des 82 initiatives prévues par la stratégie de mobilité durable et intelligente ont été menées à bien ou sont en cours de réalisation.
Plus de 21,2 milliards d’euros ont été alloués à 630 projets d’infrastructures de transport dans l’ensemble de l’UE au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe 2021-2027.
Près de 100 milliards d’euros ont été alloués aux transports par les États membres dans leurs plans de relance nationaux.
4 milliards d’euros ont été investis dans la recherche et l’innovation dans le domaine des transports.
Le règlement ReFuelEU Aviation - ouvrir un nouvel onglet. promeut l’utilisation de carburants d’aviation durables et permettra une réduction substantielle des émissions de dioxyde de carbone, supérieure à 60 % d’ici à 2050 par rapport aux niveaux de 1990. Il est entré en vigueur en janvier 2024.
Un système d’étiquetage facultatif - ouvrir un nouvel onglet. pour calculer les émissions des vols, créé par le règlement, permettra aux passagers de faire un choix éclairé lorsqu’ils compareront différentes options de vol.

Le règlement FuelEU Maritime - ouvrir un nouvel onglet. contribuera à réduire les émissions du transport maritime en encourageant l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone ainsi que de technologies énergétiques propres pour les navires. Il est applicable à partir de janvier 2025.

Le règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs - ouvrir un nouvel onglet. augmentera le nombre de stations de recharge électrique et de ravitaillement en hydrogène. Il est entré en application en avril.
42 nouveaux projets ont été sélectionnés au cours de l’année pour recevoir plus de 424 millions d’euros de financement de l’UE - ouvrir un nouvel onglet. en vue du déploiement d’infrastructures pour carburants alternatifs (installation de points de recharge électrique et de stations de ravitaillement en hydrogène; électrification des opérations au sol dans les aéroports).

RÉDUIRE
LES ÉMISSIONS
DUES AUX TRANSPORTS
Les objectifs révisés de réduction des émissions de dioxyde de carbone pour les véhicules utilitaires lourds (camions, autobus et autocars), qui sont entrés en vigueur en juillet, réduiront les émissions de 45 % d’ici à 2030, de 65 % d’ici à 2035 et de 90 % d’ici à 2040.

De nouvelles règles - ouvrir un nouvel onglet. fixant des limites d’émission applicables aux véhicules routiers et des exigences en matière de durabilité des batteries réglementeront le niveau de particules émanant des freins et des pneus de tous les véhicules, et réduiront ainsi les émissions et les microplastiques.

Le transport par voies navigables intérieures est économe en énergie et ne connaît quasiment pas de problèmes d’encombrement. Une nouvelle proposition - ouvrir un nouvel onglet. visant à améliorer la gestion du trafic sur les rivières et les canaux de l’UE augmentera l’efficacité et la fiabilité de la navigation intérieure, et contribuera à l’objectif de l’UE de transférer davantage de marchandises vers les rivières et les canaux européens.

L’UE a également fait des avancées considérables pour réduire les émissions dues aux transports en adoptant la déclaration européenne sur l’utilisation du vélo - ouvrir un nouvel onglet., qui reconnaît officiellement ce dernier comme un mode de transport durable, accessible et abordable.

Les membres de l’Alliance pour une aviation à émissions nulles - ouvrir un nouvel onglet. ont présenté l’objectif ambitieux d’exploiter, d’ici à 2050, entre 36 % et 68 % des vols intra-UE avec des aéronefs fonctionnant à l’hydrogène et à l’électricité. Cela permettrait de réduire les émissions de dioxyde de carbone sur ces routes de 12 % et 31 %. L’UE a créé l’Alliance sous la forme d’une initiative volontaire pour permettre aux partenaires privés et publics de collaborer en vue de faire des formes nouvelles de transport durable une réalité pour les voyageurs en Europe.

Un réseau de transport durable et résilient
Pour améliorer les liaisons de transport dans toute l’Europe, l’UE investit un montant record de 7 milliards d’euros - ouvrir un nouvel onglet. dans des infrastructures de transport durables, sûres et intelligentes. Plus de 80 % des fonds financeront des projets permettant d’atteindre les objectifs climatiques de l’UE, en améliorant et modernisant le réseau européen de chemins de fer, de voies navigables intérieures et de routes maritimes. Les financements seront alloués à de grands projets destinés à améliorer les liaisons ferroviaires transfrontalières. Il s’agit notamment du projet Rail Baltica qui reliera les trois États baltes, à savoir l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie - ouvrir un nouvel onglet., et du projet de tunnel du Fehmarnbelt - ouvrir un nouvel onglet., qui reliera l’Allemagne au Danemark.
Des vitesses ferroviaires plus rapides sont en vue, grâce à de nouvelles règles - ouvrir un nouvel onglet. fixant des objectifs ambitieux pour les infrastructures de transport européennes. D’ici à 2040, les lignes ferroviaires de transport de voyageurs sur les principales liaisons ferroviaires de l’UE devront permettre aux trains de circuler à des vitesses de 160 kilomètres par heure ou plus.
Rendre nos routes plus sûres
La sécurité routière dans l’UE s’est considérablement améliorée au cours des dernières décennies, le nombre de décès sur les routes européennes étant passé d’environ 50 000 il y a vingt ans à environ 20 400 aujourd’hui. Des mesures supplémentaires - ouvrir un nouvel onglet. sont néanmoins nécessaires aux niveaux européen, national et local pour atteindre l’objectif de l’UE de zéro décès d’ici à 2050.
De nouvelles règles - ouvrir un nouvel onglet. visant à améliorer la sécurité générale des véhicules sont entrées en vigueur pour tous les véhicules à moteur vendus dans l’UE. Elles imposent une série de nouvelles technologies et de systèmes avancés d’aide à la conduite dans tous les nouveaux véhicules. Depuis qu’elles ont commencé à s’appliquer aux nouveaux modèles de véhicules en 2022, les mesures ont considérablement amélioré la protection des passagers, des piétons et des cyclistes dans toute l’UE. D’ici à 2038, elles devraient avoir sauvé plus de 25 000 vies et permis d’éviter au moins 140 000 blessures graves.
La mobilité coopérative, connectée et automatisée - ouvrir un nouvel onglet. est essentielle pour rendre les transports européens plus écologiques, plus sûrs et plus compétitifs. En coopération avec des partenaires privés, l’UE investit 500 millions d’euros, par le programme Horizon Europe, pour faire avancer la recherche sur ces technologies.
La collaboration de l’UE avec ses principaux partenaires internationaux, pour faire face à la triple crise du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution, s’est poursuivie en 2024. Trois négociations multilatérales majeures ont eu lieu: la conférence des Nations unies sur les changements climatiques en Azerbaïdjan, la conférence des Nations unies sur la biodiversité en Colombie et la conférence des Nations unies sur la désertification en Arabie saoudite.
La conférence des Nations unies sur les changements climatiques
La 29e conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP29) s’est tenue du 11 au 24 novembre à Bakou (Azerbaïdjan). Le sommet a réuni les parties pour accélérer l’action visant à atteindre l’objectif de l’accord de Paris consistant à limiter l’augmentation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

La conférence s’est concentrée sur l’obtention des investissements financiers élevés qui sont nécessaires pour réduire les émissions et protéger les populations vulnérables. L’UE a joué un rôle essentiel - ouvrir un nouvel onglet. dans la conclusion d’un accord sur un nouvel objectif de financement de l’action en faveur du climat, pour soutenir l’action climatique des pays en développement.
Les parties se sont fixé un nouvel objectif collectif quantifié ambitieux, consistant à porter le financement combiné provenant de toutes les sources à 1 300 milliards de dollars par an d’ici à 2035. Dans le cadre de cet objectif plus large, les pays développés se sont engagés à prendre l’initiative de mobiliser au moins 300 milliards de dollars par an d’ici à 2035. L’objectif a également permis d’élargir avec succès la base des contributeurs mondiaux, un plus grand nombre de pays étant encouragés à y contribuer, pour tenir compte de l’augmentation de leurs émissions et de leur poids économique. Il a également souligné le rôle transformateur des banques multilatérales dans l’intensification de l’action pour le climat.
En outre, l’UE a joué un rôle important dans l’achèvement des règles d’application de l’accord de Paris pour les marchés du carbone. Cet accord, dont l’élaboration a duré neuf ans, lancera les activités des marchés internationaux du carbone - ouvrir un nouvel onglet. et constituera un cadre solide pour la transparence, la responsabilisation et une plus grande intégrité environnementale. Une autre réalisation majeure a été l’élargissement réussi du programme de travail de Lima renforcé relatif au genre, qui souligne l’importance d’une action climatique sensible au genre parmi les parties.
À la COP29, l’UE a publié son tout premier rapport biennal sur la transparence, avant l’échéance qui était fixée à la fin de l’année. Il s’agit d’une étape importante dans la mise en œuvre de l’accord de Paris, qui marque le début d’une nouvelle ère de responsabilité et de collaboration dans la lutte mondiale contre le changement climatique.

La conférence des Nations unies sur la biodiversité
La 16e conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, qui s’est tenue en octobre à Cali (Colombie), a montré une dynamique encourageante en faveur de l’application du cadre mondial de la biodiversité - ouvrir un nouvel onglet., afin d’arrêter et d’inverser la perte de biodiversité d’ici à 2030. Surnommée la «COP du peuple», plusieurs décisions importantes y ont été prises - ouvrir un nouvel onglet., dont un accord visant à accroître le rôle des peuples autochtones et des communautés locales dans la sauvegarde de la biodiversité, ainsi qu’un accord novateur sur la manière de partager les avantages offerts par les informations génétiques numériques. L’UE a dévoilé un ensemble de nouvelles initiatives d’une valeur de près de 160 millions d’euros, destinées à soutenir les pays partenaires et à préserver la biodiversité à l’échelle mondiale, qui témoignent d’une volonté manifeste d’atteindre les objectifs de financement mondiaux visant à protéger la nature.
La conférence des Nations unies sur la désertification
Lors de la 16e conférence des parties à la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, l’UE a étroitement collaboré avec ses partenaires internationaux pour honorer les engagements pris au niveau mondial pour lutter contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. Le premier Atlas mondial des sécheresses - ouvrir un nouvel onglet., établi par le Centre commun de recherche de la Commission et la convention, a été présenté à la conférence. L’Atlas illustre toutes les dimensions de la sécheresse et ses risques croissants à l’échelle mondiale. Après avoir exposé les défis à relever, il propose des réponses pour permettre aux décideurs politiques de prendre des mesures afin de mieux affronter les sécheresses.
Épisodes de sécheresse majeurs avec exemples de systèmes touchés (2022-2024)

En 2022, les écosystèmes, l’agriculture, l’hydroélectricité et l’approvisionnement en eau ont été touchés dans l’ouest des États-Unis. En Asie centrale, l’agriculture et l’approvisionnement en eau ont été perturbés, tandis qu’en Asie de l’Est, l’agriculture, la navigation intérieure et les activités industrielles et manufacturières ont été touchées. La même année, l’agriculture a également été perturbée en Asie du Sud-Est. Entre 2022 et 2023, la navigation intérieure, l’hydroélectricité, l’agriculture, l’approvisionnement en eau, les écosystèmes et la santé ont été touchés en Europe. En Afrique de l’Ouest, il y a eu des difficultés dans les domaines de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, tandis qu’en Afrique de l’Est, l’agriculture, la sécurité alimentaire et le déplacement de personnes ont été des problèmes majeurs. Dans les Andes extratropicales et le bassin de La Plata, il y a eu des pénuries d’eau, des perturbations de la navigation intérieure et des incidences sur l’agriculture. Entre 2023 et 2024, l’agriculture et l’approvisionnement en eau ont été touchés en Amérique centrale et dans le nord de l’Amérique du Sud. Le bassin de l’Amazone brésilien a subi des effets négatifs sur les écosystèmes, la navigation intérieure et l’hydroélectricité. En 2024, la région méditerranéenne était confrontée à une pénurie d’eau et à des défis agricoles, tandis que l’agriculture, la sécurité alimentaire, l’hydroélectricité et les écosystèmes étaient touchés en Afrique australe et dans le bassin du Zambèze. En Afghanistan, l’agriculture et l’approvisionnement en eau ont été perturbés.