
Coopération Interreg: la libération du potentiel des régions transfrontalières de l'Union européenne doit être parachevée
À propos du rapportLa coopération transfrontalière vise à résoudre des problèmes communs recensés conjointement par les États membres dans les régions frontalières et à exploiter le potentiel de croissance inutilisé. Beaucoup de ces régions s'en sortent économiquement moins bien que les autres régions dans un même État membre.
Nous avons constaté que les programmes de coopération examinés comportaient des stratégies claires pour répondre aux défis des régions transfrontalières couvertes. Toutefois, en raison de faiblesses dans la mise en œuvre et d'insuffisances dans les informations de suivi, ces programmes n'étaient que peu susceptibles de libérer le potentiel de ces régions.
Nous adressons aux autorités responsables des programmes et à la Commission un certain nombre de recommandations les invitant à mieux cibler les programmes de coopération, à hiérarchiser et à financer les projets en fonction de leurs mérites, ainsi qu'à définir des indicateurs qui rendent compte des effets transfrontaliers des projets.
Rapport spécial de la Cour des comptes européenne présenté en vertu de l'article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du TFUE.
Synthèse
ILa coopération transfrontalière est l'un des deux objectifs de la politique de cohésion. Elle vise à résoudre des problèmes communs recensés conjointement par les États membres dans les régions frontalières et à exploiter le potentiel de croissance inutilisé de ces régions. Beaucoup de celles-ci s'en sortent économiquement moins bien que les autres régions dans un même État membre.
IILes programmes Interreg visent à lutter contre les difficultés transfrontalières. Durant leur cinquième période de programmation, à savoir 2014‑2020, ils ont été dotés d'un budget de 10,1 milliards d'euros consacré, en grande partie, aux frontières intérieures. Ces dernières ont en effet disposé d'une enveloppe de 6,3 milliards d'euros qui a permis de financer 24 000 projets dans le cadre de 53 programmes de coopération, couvrant ainsi 59 % du territoire terrestre et 48 % de la population de l'UE.
IIILors du présent audit, nous avons cherché à déterminer si la Commission et les États membres avaient réellement tenu compte, dans les programmes de coopération relative aux frontières intérieures financés au titre d'Interreg, des défis des régions transfrontalières. La publication de ce rapport contribuera utilement à la mise en œuvre de la période de programmation 2021‑2027. Le rapport pourra également alimenter les discussions en cours entre les colégislateurs concernant la création éventuelle d'un mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans les régions transfrontalières.
IVNous avons constaté que tous les programmes de coopération examinés, sauf un, reposaient sur une analyse des besoins des régions concernées. Cependant, compte tenu des ressources financières qui leur étaient allouées, ils n'ont permis de répondre que partiellement aux difficultés transfrontalières. Étant donné le manque de ressources, le financement doit être affecté aux domaines dans lesquels il permettra probablement d'apporter la plus forte valeur ajoutée.
VÀ quelques exceptions près, il existait, dans les programmes examinés, des liens manifestes entre les objectifs envisagés, les intrants et activités prévus ainsi que les résultats et l'impact escomptés. Les programmes de coopération se distinguent des programmes principaux de l'UE en ce qu'ils exigent que les projets aient un caractère transfrontalier et que plusieurs partenaires basés dans des pays différents y participent. Toutefois, une délimitation claire entre programmes de coopération et programmes principaux faisant fréquemment défaut, le même type d'opérations pouvaient être financées par les deux types de programmes.
VIEn outre, nous avons relevé plusieurs faiblesses dans la mise en œuvre et le suivi des programmes:
- pour la moitié des projets que nous avons examinés, la coopération entre les partenaires s'est limitée à la présentation d'une proposition commune afin d'obtenir un financement pour les interventions; de plus, les projets concernés étaient dépourvus de critères communs et ne pouvaient donc être qualifiés de projets transfrontaliers;
- les procédures de sélection de projets ne débouchaient pas toujours sur le choix des meilleurs d'entre eux;
- les indicateurs ne rendaient généralement pas compte des effets transfrontaliers, ce qui empêchait de suivre la mise en œuvre des programmes par rapport à leurs objectifs;
- les insuffisances des données statistiques se répercutaient sur l'évaluation des projets cofinancés.
Les autorités responsables des programmes se sont efforcées de limiter l'impact de la crise liée à la COVID-19 sur les projets en reportant la date d'achèvement de ces derniers. Elles ont également recouru aux mesures de flexibilité et de simplification visant à atténuer les effets de la crise liée à la COVID-19 proposées par l'UE, en particulier en ce qui concerne la possibilité de différer la transmission des documents clés.
VIIIEnfin, le retard dans l'adoption du cadre juridique de la période de programmation 2021‑2027 (joint à la nécessité d'achever les travaux relevant de la période de programmation 2014‑2020) a empêché un démarrage en douceur de celle-ci au niveau des États membres.
IXÀ la suite de notre audit, nous recommandons:
- de mieux cibler les programmes de coopération, afin que les projets soient complémentaires de ceux des programmes principaux;
- de hiérarchiser les projets et de leur accorder un soutien en fonction de leurs mérites;
- d'utiliser des indicateurs qui visent à rendre compte des effets transfrontaliers.
Introduction
Les défis des régions transfrontalières de l'UE
01En vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'UE vise à réduire l'écart, du point de vue de la richesse et du développement, entre ses régions, les régions transfrontalières figurant parmi les principales concernées1. Elle soutient ainsi des programmes relevant de la coopération territoriale européenne (CTE), ou programmes «Interreg», dans le cadre de sa politique de cohésion, en apportant des financements au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER). Depuis 30 ans, Interreg permet de soutenir des actions menées conjointement par plusieurs États membres, ou par des États membres et des pays tiers.
02Interreg vise essentiellement à contribuer à soutenir un développement harmonieux du territoire de l'UE2, afin de décupler la coopération, de créer des possibilités de développement et de favoriser la solidarité entre les citoyens de différents pays qui sont confrontés aux mêmes défis. Cet objectif, l'un des deux de la politique de cohésion (l'autre étant l'«investissement pour la croissance et l'emploi»), permet de «soutenir le partage d'installations et de ressources humaines, et tous les types d'infrastructures par-delà les frontières dans toutes les régions»3.
03La coopération transfrontalière vise à résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières et à exploiter le potentiel de croissance inutilisé. Parmi les principaux défis figurent notamment «[les] difficultés d'accès, en particulier en ce qui concerne la connectivité des technologies de l'information et de la communication et l'infrastructure des transports, le déclin des industries locales, [un] environnement peu propice aux entreprises, l'absence de réseaux entre les administrations locales et régionales, les faibles niveaux de recherche [et] d'innovation […], la pollution de l'environnement, la prévention des risques [et] les attitudes négatives vis-à-vis des ressortissants des pays voisins»4.
04La figure 1 présente de façon synthétique les principaux aspects des défis auxquels sont confrontées les régions transfrontalières de l'UE, ainsi que leur impact estimatif. Si 20 % des obstacles existants dans le domaine de la coopération transfrontalière étaient levés, le PIB de ces régions augmenterait de 2 % et plus de 1 million d'emplois supplémentaires y seraient créés5.
Figure 1
Les défis des régions transfrontalières de l'UE et leur impact estimatif

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données provenant de plusieurs études menées à la demande de la Commission6.
Interreg A, le principal volet du programme
05La période de programmation 2014‑2020 était la cinquième période de mise en œuvre d'Interreg. Le budget correspondant s'est élevé à 10,1 milliards d'euros, soit environ 2,75 % du montant total du budget destiné à la politique de cohésion7, et la coopération au titre d'Interreg a comporté trois volets8 (voir encadré 1).
Encadré 1
Les trois volets de la coopération au titre d'Interreg V (période 2014‑2020)
Coopération transfrontalière (Interreg V-A): programmes de coopération entre régions limitrophes (la liste des programmes couvrant les frontières intérieures de l'UE est fournie dans l'annexe I). Beaucoup de ces programmes sont bilatéraux mais, pour certains d'entre eux, le nombre d'États membres participants peut aller jusqu'à cinq. Les opérations sélectionnées au titre de ces programmes doivent associer des bénéficiaires d'au minimum deux pays participants, dont au moins un État membre9. Les zones éligibles sont celles qui se classent au niveau NUTS 3 du point de vue démographique10 et peuvent également comprendre des régions de niveau NUTS 3 situées en Norvège ou en Suisse, ainsi que le Liechtenstein, l'Andorre, Monaco et Saint-Marin11.
Coopération transnationale (Interreg V-B): programmes de coopération couvrant des zones plus étendues (voir annexe II) et centrés sur des questions transnationales telles que la gestion des inondations, les corridors de transport, les couloirs de communication, le commerce international, la coordination dans le domaine de la recherche et le développement urbain. Les zones qui peuvent en bénéficier sont les régions de niveau NUTS 2.
Coopération interrégionale (Interreg V-C): quatre programmes d'échange à l'échelle de l'UE et portant, respectivement, sur l'aménagement du territoire (ESPON), sur le développement urbain intégré (URBACT), sur la mise en valeur des activités relevant de la politique de cohésion (Interreg Europe) et sur l'assistance technique à l'ensemble des programmes Interreg (INTERACT).
La figure 2 présente l'évolution d'Interreg, du point de vue du financement alloué ainsi que du nombre d'États membres participants, de 1989 à 2020, des informations plus détaillées étant fournies pour la période 2014‑2020. Interreg V-A, qui finance 88 programmes de coopération grâce à une dotation de près de 7,4 milliards d'euros, est le principal volet d'Interreg. Sa part dans le budget total de l'instrument s'élève à 73 %. Composante la plus importante d'Interreg V-A, la coopération transfrontalière intérieure, exclusion faite des régions ultrapériphériques, couvre 53 programmes de coopération et est dotée d'un budget de 6,3 milliards d'euros.
Figure 2
Interreg: évolution de 1989 à 2020 et budget détaillé pour la période 2014‑2020

Source: Cour des comptes européenne.
Pour la période 2021‑2027, en raison d'une révision à la baisse aussi bien du budget total dédié à la politique de cohésion que de la part de celui-ci dévolue à Interreg12 – qui est passée de 2,75 % à 2,4 % –, le budget total d'Interreg a été réduit à 8 milliards d'euros. Pour cette période, un quatrième volet, destiné aux régions ultrapériphériques, sera ajouté13. La majeure partie des fonds Interreg continuera à être allouée au volet VI-A, qui concerne la coopération transfrontalière et qui disposera d'une enveloppe de 5,8 milliards d'euros pour l'ensemble de la période14.
08Les régions frontalières intérieures éligibles à un cofinancement au titre d'Interreg A comprennent les régions de niveau NUTS 3 situées le long des frontières terrestres intérieures de l'UE ainsi que de certaines frontières terrestres extérieures15 et les régions situées le long de frontières maritimes séparées par 150 km au maximum16. Les États membres ont leur mot à dire sur la décision de la Commission établissant la liste des régions éligibles17. Pour toutes les régions, le soutien au titre d'Interreg s'ajoute aux programmes principaux, de niveau national ou régional, du FEDER.
09La figure 3 illustre l'agrandissement graduel des zones ayant vocation à bénéficier d'Interreg A. Cet agrandissement s'explique principalement par l'élargissement de l'UE et par la possibilité offerte aux États membres, depuis la période 2007‑2013, d'affecter une partie de leur dotation au titre d'Interreg à des régions non couvertes par les programmes de coopération; cette possibilité a d'abord visé les régions jouxtant celles éligibles aux programmes18, puis a été étendue à l'ensemble des régions19. Pour la période 2014‑2020, l'éligibilité à Interreg V-A concerne 66 % du territoire de l'UE et 51 % de sa population (59 % et 48 %, respectivement, si l'on ne tient compte que des régions frontalières intérieures).
10D'après la Commission, les régions éligibles à Interreg V-A voient transiter près de 2 millions de navetteurs transfrontaliers, dont 1,3 million passent la frontière pour travailler, les autres le faisant pour étudier. Par exemple, 450 000 résidents français travaillent dans un pays voisin; tel est également le cas de 270 000 résidents allemands et de 140 000 résidents polonais. De nombreuses régions frontalières s'en sortent économiquement moins bien que les autres régions dans un même État membre. L'accès aux services publics tels que les hôpitaux et les universités s'avère souvent complexe et coûteux, de même que la navigation entre les différents systèmes administratifs et juridiques20.
Figure 3
Évolution de la composante d'Interreg destinée aux régions frontalières, tant intérieures qu'extérieures, de 1989 à 2020

Source: Commission européenne, direction générale de la politique régionale et urbaine (DG REGIO).
Gouvernance d'Interreg et domaines de financement couverts par la composante d'Interreg V-A relative aux frontières intérieures au cours de la période 2014-2020
11À l'instar des programmes principaux du FEDER, les programmes de coopération font l'objet d'une gestion partagée. Dans ce contexte, le rôle de la Commission consiste à approuver les programmes élaborés par les États membres, à en faciliter la mise en œuvre, et à en assurer le suivi ainsi que l'évaluation.
12Pour chaque programme de coopération, une autorité de gestion, une autorité de certification et une autorité d'audit sont désignées. Spécificité d'Interreg, il est établi un secrétariat conjoint21 qui joue le rôle de centre d'information, aide les candidats à présenter leurs demandes et évalue les dossiers de projets. Le secrétariat conjoint et l'autorité de gestion sont les principales autorités responsables des programmes de coopération. Enfin, le comité de suivi du programme sélectionne les opérations à cofinancer.
13Le processus de programmation relatif aux programmes de coopération est très similaire aux dispositions existantes applicables aux programmes principaux. La législation définit des exigences détaillées en ce qui concerne le contenu des programmes. Elle vise à favoriser une logique d'intervention cohérente, c'est-à-dire l'existence de liens manifestes entre les objectifs envisagés, les intrants et activités prévus ainsi que les résultats et l'impact escomptés. L'objectif ultime consiste à mettre en œuvre les fonds avec efficacité et efficience22:
- la programmation doit s'articuler autour de 11 objectifs thématiques prédéfinis23, avec une concentration d'au moins 80 % des fonds sur quatre de ces objectifs au maximum24;
- chaque axe prioritaire doit, de préférence, correspondre à un objectif thématique, et des priorités d'investissement ainsi que des objectifs spécifiques doivent être définis au sein de chacun de ces axes25;
- une justification du choix des objectifs thématiques, des priorités d'investissement et des dotations financières, fondée sur une analyse des besoins régionaux et nationaux, doit être fournie26.
Tous les ans, au printemps, les autorités de gestion transmettent à la Commission un rapport annuel de mise en œuvre pour chaque programme de coopération27. Ces rapports comportent des données sur l'évolution des indicateurs de réalisation communs28, sur les indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques aux programmes examinés et sur les valeurs intermédiaires, ainsi que des données financières.
15La figure 4 et l'annexe III présentent la répartition des fonds entre les différents objectifs thématiques ciblés par le financement au titre de la composante d'Interreg V-A relative aux frontières intérieures au cours de la période 2014‑2020. Fin 2020, la majeure partie du financement avait été consacrée aux objectifs «préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources» et «renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation».
Figure 4
Objectifs thématiques (OT) financés au titre de la composante d'Interreg V-A relative aux frontières intérieures
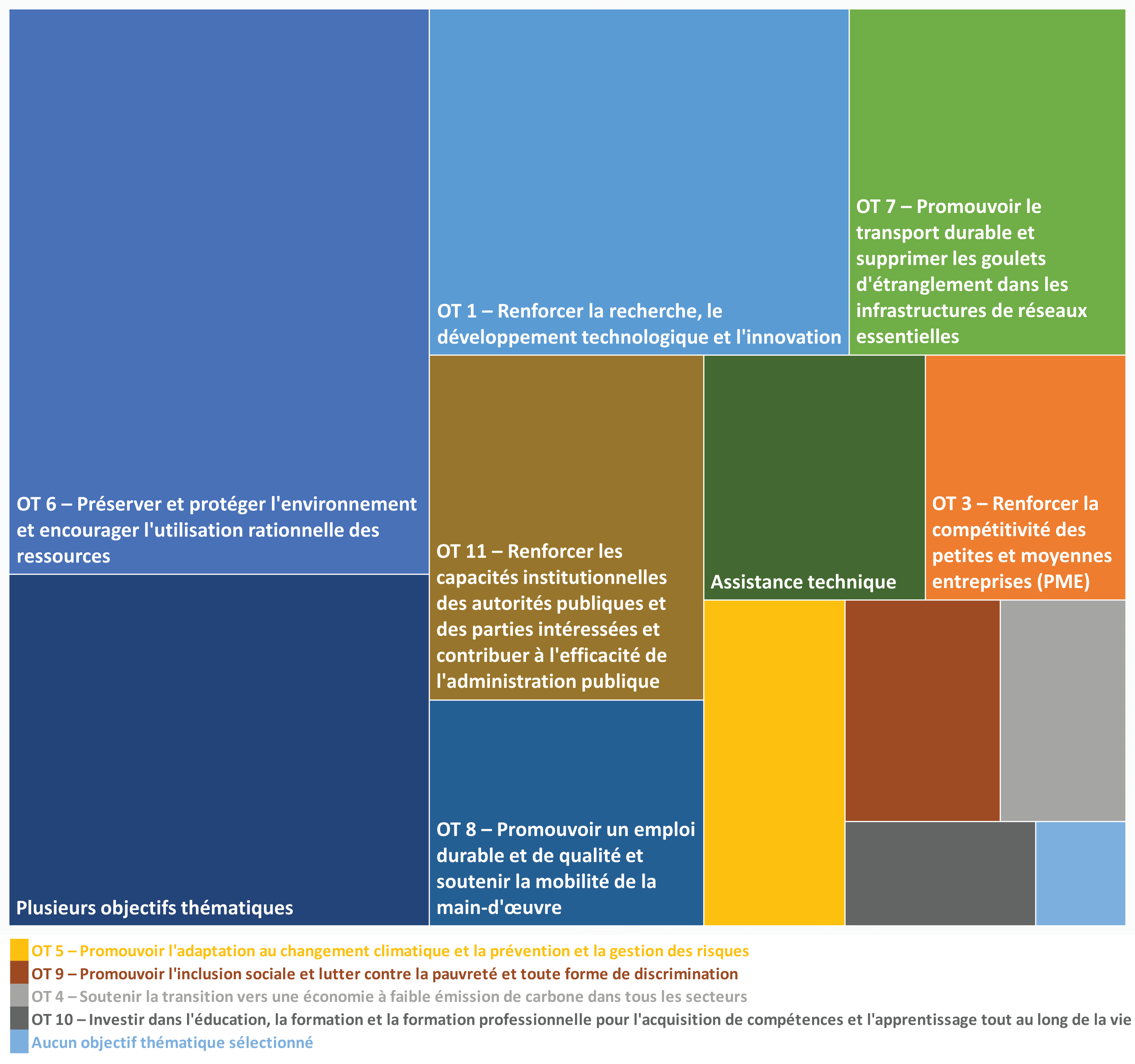
Source: Plateforme de données ouvertes dédiée aux Fonds ESI, dotations à la fin 2020.
Comme on peut le voir à l'annexe IV, exception faite de l'assistance technique, les types de projets qui ont bénéficié des montants de financement les plus élevés avaient trait à la culture et au patrimoine, à l'adaptation au changement climatique, aux capacités institutionnelles, au transfert de technologies au profit des PME, à l'amélioration du réseau routier, à la protection de la biodiversité et de la nature, au tourisme dans les espaces naturels, aux soins de santé et services sociaux, ainsi qu'aux activités de recherche et d'innovation dans les centres publics.
17À la fin décembre 2020, les autorités responsables des programmes de coopération avaient engagé 102 % des fonds disponibles au titre de la période 2014‑2020 (contre 110 % pour les programmes principaux soutenus par le FEDER) et avaient sélectionné quelque 24 000 projets à cofinancer. Les autorités responsables d'un programme peuvent en effet engager des montants plus élevés que celui du budget alloué au programme, afin de garantir qu'à la fin de la période de programmation, les fonds disponibles auront été utilisés dans leur totalité.
Préparation en vue de la période 2021-2027
18Au cours de la période de programmation 2007‑2013, 5,6 milliards d'euros de financement ont été fournis au titre d'Interreg. D'après l'évaluation ex post29, les projets ont conduit à des réalisations et à des résultats qui se sont avérés conformes aux objectifs spécifiques d'Interreg et étaient axés sur les principales priorités de la stratégie de Lisbonne.
19Les principales faiblesses relevées lors de l'évaluation étaient les suivantes:
- les programmes demeuraient très étendus, et le développement de la coopération ainsi que l'établissement de liens en étaient souvent les objectifs ultimes plutôt que des facteurs d'intégration économique plus large;
- pour la plupart des programmes, les décisions relatives aux projets à soutenir étaient prises selon une approche ascendante. Il était dès lors difficile de mettre en œuvre une stratégie cohérente en vue de promouvoir le développement et l'intégration territoriale et socioéconomique des régions concernées, même si la plupart des projets apportaient une contribution;
- les programmes Interreg étaient très peu coordonnés avec les programmes principaux.
Lors de l'élaboration des accords de partenariat et des programmes de la période 2014‑2020, la Commission a établi, pour chaque État membre, un document de prise de position énonçant les priorités les plus pertinentes en ce qui concerne les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) et contenant une très courte section consacrée à la coopération territoriale.
21La Commission a fourni des documents d'orientation relatifs aux frontières, destinés à faciliter l'élaboration des programmes de coopération des États membres pour la période 2021‑2027. Il s'agit de documents détaillés spécifiques des régions transfrontalières.
22Pour la période 2021‑2027 également, la législation30 dispose que:
- pour les frontières terrestres intérieures, les autorités responsables des programmes doivent allouer, au maximum, 60 % des fonds à quatre des sept objectifs stratégiques (dont cinq sont définis dans le règlement portant dispositions communes et deux, dans le règlement CTE), y compris «une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone» et «une Europe plus sociale»;
- pour les frontières maritimes, 60 % du financement doivent être consacrés à trois des objectifs stratégiques, dont «une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone»;
- il est possible d'allouer, respectivement, jusqu'à 20 % et jusqu'à 5 % du financement aux objectifs spécifiques d'Interreg «une meilleure gouvernance de la coopération» et «une Europe plus sûre et mieux sécurisée».
Mesures relatives aux Fonds ESI prises en riposte à la crise de la COVID-19
23La pandémie de COVID-19 a durement frappé les régions transfrontalières et a mis les structures socioéconomiques sous pression, à l'intérieur comme autour des frontières de l'UE. Les mesures visant à assouplir l'utilisation des Fonds ESI afin d'atténuer les effets de la pandémie de COVID-19, prises au titre de l'initiative d'investissement en réaction au coronavirus31 (CRII) et de l'initiative d'investissement+ en réaction au coronavirus32 (CRII+), concernent également les programmes de coopération.
24La figure 5 présente les plus importantes de ces mesures. Toutes supposent une modification des programmes et, hormis la possibilité de transférer des ressources entre catégories de régions pour l'exercice 2020, peuvent s'appliquer aux programmes de coopération. Les autorités responsables des programmes peuvent recourir à plusieurs de ces mesures.
Figure 5
Principales mesures relatives aux Fonds ESI prises en riposte à la crise de la COVID-19

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de l'article 2 du règlement CRII+ et de l'article 2 du règlement CRII.
Étendue et approche de l'audit
25L'objectif de notre audit a consisté à déterminer si la Commission et les États membres avaient réellement tenu compte, dans les programmes de coopération transfrontalière intérieure relevant d'Interreg V-A, des défis des régions transfrontalières (voir annexe I). À cette fin, nous avons examiné:
- si, étant donné l'insuffisance des ressources disponibles, les autorités responsables des programmes avaient analysé les difficultés transfrontalières et les avaient hiérarchisées en fonction de leur importance, afin de concentrer les programmes de coopération sur les domaines où leur incidence serait le plus sensible;
- si les programmes de coopération étaient conçus selon une logique d'intervention cohérente et en synergie avec les programmes principaux couvrant les régions limitrophes, et si la logique d'intervention englobait un système d'évaluation permettant de mesurer les effets transfrontaliers;
- si les orientations de la Commission avaient aidé les régions transfrontalières à recenser leurs défis, et si les suggestions et l'assistance qu'elles contiennent leur avaient été utiles, en particulier pour ce qui est d'atténuer les effets de la crise liée à la COVID-19 et en vue d'un démarrage en douceur de la nouvelle période de programmation (2021‑2027).
Nos constatations et conclusions portent sur les programmes de coopération relevant de la composante d'Interreg V-A relative aux frontières intérieures pour la période de programmation 2014‑2020, et nous pensons que nos recommandations contribueront utilement à la préparation et à la mise en œuvre de la période de programmation 2021‑2027. Notre rapport pourra également alimenter les discussions en cours entre les colégislateurs concernant la création éventuelle d'un mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans les régions transfrontalières33.
27Au niveau de l'UE, nous avons examiné les travaux de la direction générale de la politique régionale et urbaine (DG REGIO) de la Commission.
28Notre approche s'est traduite par une très forte couverture des programmes de coopération. Nous avons examiné, pour chacun des 28 États membres, au moins un programme de coopération auquel il avait participé, soit, au total, 23 programmes de coopération (voir la liste dans l'annexe V). Ces 23 programmes représentent 43 % du financement de l'UE affecté à la composante d'Interreg V-A relative aux frontières intérieures et 27 % de l'ensemble du budget dédié à Interreg pour la période 2014‑2020.
29Pour ces programmes de coopération, nous avons effectué dix contrôles documentaires de base, dix contrôles documentaires approfondis et trois visites sur place. L'annexe V fournit des informations détaillées, y compris sur les différences entre ces types d'examens.
30Pour chacun de ces 23 programmes de coopération, nous avons en outre sélectionné deux programmes principaux (également répertoriés dans la liste de l'annexe V) couvrant les régions limitrophes, afin de comparer le ciblage de ces différents programmes et d'évaluer le niveau de synergie entre ceux-ci, du point de vue de la lutte contre les difficultés transfrontalières. Les principaux critères de sélection des deux programmes examinés pour chaque programme de coopération ont été la taille de la population, le niveau de soutien financier, la superficie de la région couverte et, surtout, l'importance des priorités d'investissement communes. Au total, nous avons examiné 39 programmes principaux, sept d'entre eux ayant été utilisés pour plusieurs comparaisons.
31Pour les programmes de coopération ayant fait l'objet d'examens sur place, nous avons visité 12 projets soutenus par l'UE. Les critères employés pour sélectionner ces projets étaient l'importance relative et la diversité des types d'actions cofinancées. Par ailleurs, pour le programme de coopération Roumanie – Bulgarie, nous avons effectué un contrôle documentaire de quatre projets supplémentaires. Nous avions initialement prévu un examen sur place pour ce programme, mais les restrictions de déplacement liées à la pandémie de COVID-19 s'y sont opposées. Il nous a donc été impossible de procéder nous-mêmes à une inspection physique des résultats des projets.
32Les 16 projets que nous avons examinés comportaient la mise en œuvre d'actions dans les domaines de soutien suivants: patrimoine culturel, tourisme, PME et entrepreneuriat, marché du travail et emploi, gestion des risques et coopération entre services d'urgence, éducation et formation, coopération institutionnelle, santé et inclusion sociale, et transport multimodal.
33Enfin, pour chacun des 53 programmes de coopération transfrontalière intérieure, nous avons déterminé dans quelle mesure les autorités responsables avaient tiré parti de la flexibilité et des possibilités de simplification offertes par les initiatives CRII et CRII+. Dans le cas des trois programmes de coopération ayant donné lieu à des visites sur place ainsi que du programme Roumanie – Bulgarie, pour lequel un examen sur place était prévu, nous avons évalué les incidences de la crise liée à la COVID-19 sur la mise en œuvre des projets.
Observations
Les programmes transfrontaliers reposaient sur des analyses approfondies, mais ne permettaient pas de répondre à tous les défis
34Nous avons examiné les documents relatifs à 23 programmes de coopération afin d'apprécier si la planification stratégique de la période de programmation 2014‑2020 avait reposé sur une analyse des difficultés transfrontalières auxquelles se heurtaient les régions couvertes. Nous nous sommes également attachés à déterminer dans quelle mesure les programmes de coopération avaient permis de lutter contre ces difficultés, étant donné le manque de ressources financières.
Une analyse des défis des régions transfrontalières avait été effectuée pour chacun des 23 programmes de coopération examinés
35Tout programme de coopération doit reposer sur une analyse des besoins de l'ensemble de la zone qu'il couvre34. Cela suppose d'adapter les exigences relatives au contenu des programmes aux besoins spécifiques des régions transfrontalières35.
36Tous les programmes de coopération examinés décrivaient les besoins des régions, en s'appuyant sur une analyse des atouts, des faiblesses, des opportunités et des menaces (analyse SWOT) ou des caractéristiques sociales et économiques des régions transfrontalières (analyse socioéconomique). Toutefois, dans le cas du programme de coopération Suède – Finlande – Norvège, l'analyse SWOT n'était pas suffisamment poussée pour apporter les éléments nécessaires à la prise de décisions stratégiques: l'examen des menaces était incomplet, aucune séparation n'était établie entre les atouts et les opportunités, aucune information générale n'était fournie pour certains défis mentionnés et des données obsolètes, remontant à plus de dix ans, étaient utilisées.
37La figure 6 présente, en les groupant en sept catégories, les principaux défis mis en évidence dans les programmes de coopération. La plupart d'entre eux se posent également pour les programmes principaux qui couvrent les mêmes zones géographiques. Les insuffisances en matière de coopération administrative et la barrière linguistique sont toutefois spécifiques des contextes transfrontaliers.
Figure 6
Principaux défis des régions transfrontalières
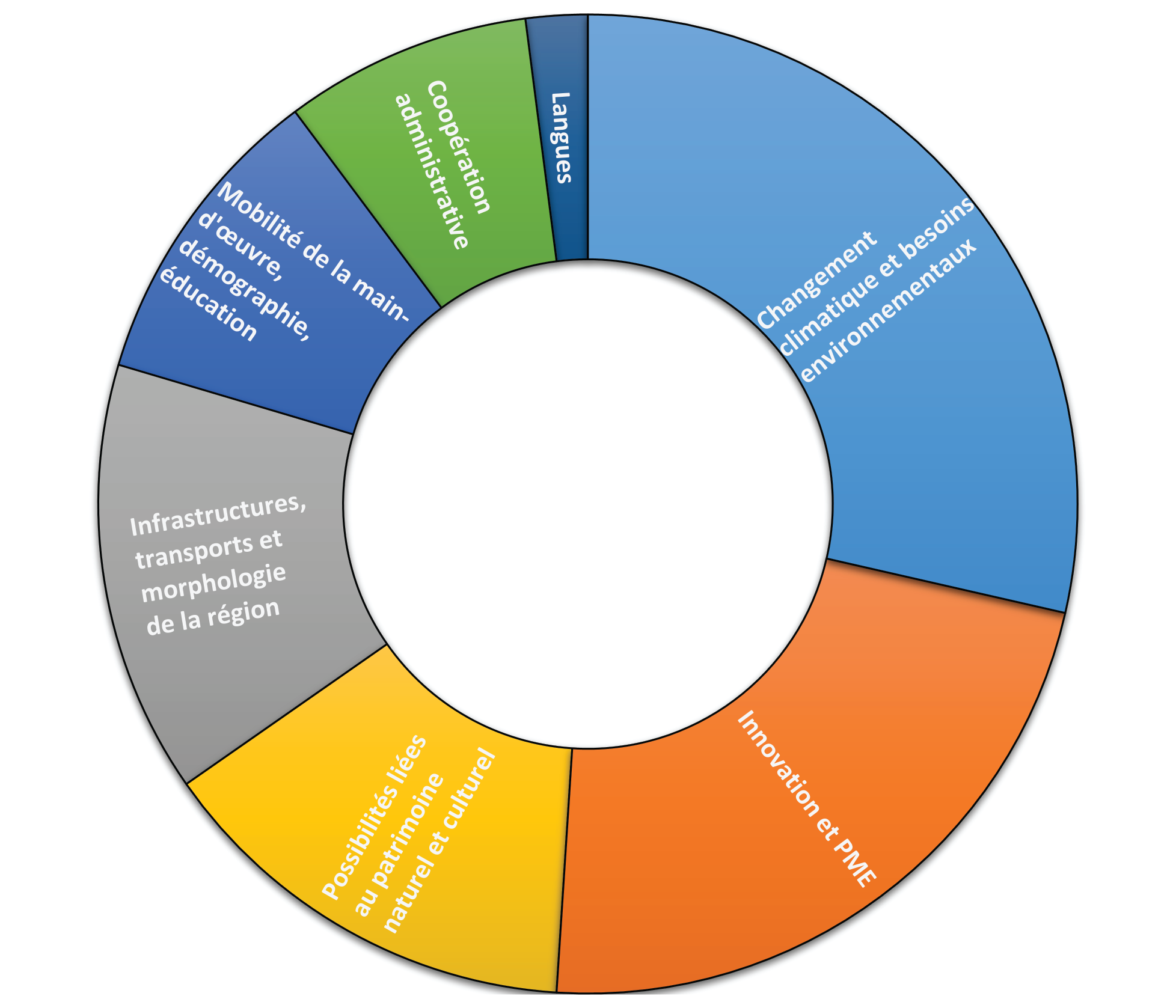
Source: Cour des comptes européenne, sur la base des 23 programmes de coopération énumérés dans l'annexe V.
Les programmes de coopération à eux seuls ne permettent pas de répondre aux défis, qui doivent donc être hiérarchisés
38Concrètement, compte tenu des ressources financières allouées à ces programmes, ceux-ci n'ont permis de répondre que partiellement aux difficultés transfrontalières. Le budget consacré à chacun des 53 programmes de coopération relatifs aux frontières intérieures s'élevait, en moyenne, à 162 millions d'euros, et s'échelonnait entre 19 millions d'euros, pour le programme Slovénie – Hongrie, et 485 millions d'euros, pour le programme Espagne – Portugal (POCTEP) (voir annexe I). Or, lutter contre de nombreuses difficultés transfrontalières suppose des moyens financiers importants. Par exemple, les grands projets d'infrastructures routières ou ferroviaires de nature à faciliter les transports, le commerce et les déplacements des citoyens mobilisent habituellement plusieurs milliards d'euros.
39Les programmes principaux, par contre, sont généralement dotés de budgets beaucoup plus importants. Parmi les 39 programmes principaux que nous avons examinés, les programmes régionaux avaient un budget variant entre 231 millions d'euros et 7 milliards d'euros, soit un budget moyen de 2 milliards d'euros, tandis que les programmes nationaux avaient une dotation plus de deux fois supérieure, qui allait de 700 millions d'euros à près de 9 milliards d'euros (voir annexe V).
40Dans certains cas, les autorités responsables des programmes avaient alloué un faible montant à un axe prioritaire ou à une priorité d'investissement, si bien que les fonds ne pouvaient guère produire d'effets pour la région transfrontalière. Ainsi, les autorités responsables du programme de coopération Estonie – Lettonie avaient affecté moins de 1 million d'euros à l'axe prioritaire relatif à l'intégration des marchés du travail et à l'amélioration des conditions d'accès à l'emploi transfrontalier. Il n'est pas certain que des montants de soutien relativement modiques, comme celui-ci, puissent produire des effets appréciables.
41La figure 7 illustre la différence de dotation budgétaire entre les 23 programmes de coopération de notre échantillon et les programmes principaux relatifs aux régions limitrophes examinés.
Figure 7
Comparaison entre les budgets des programmes de coopération et ceux des programmes principaux relatifs aux régions limitrophes examinés

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des programmes de coopération et des programmes principaux examinés, énumérés dans l'annexe V.
Étant donné le manque de ressources financières, il convient d'affecter le financement aux domaines dans lesquels il permettra probablement d'apporter la plus forte valeur ajoutée. Nous avons toutefois observé que la plupart des autorités responsables des programmes ne hiérarchisaient pas les besoins recensés et s'exposaient ainsi au risque de ne pas sélectionner les priorités d'investissement susceptibles de produire le plus fort impact.
43Notre examen a montré que la réponse à beaucoup de défis importants rencontrés par les régions transfrontalières n'était pas du ressort des autorités responsables des programmes, mais supposait que des décisions soient prises au niveau étatique, puis intégrées dans la législation nationale. Ainsi, la coopération entre autorités nationales en matière de sécurité ou de soins de santé requiert des accords bilatéraux ou trilatéraux entre les États membres, comme l'illustre l'exemple de l'encadré 2.
Encadré 2
Les défis relatifs aux soins de santé dans la Grande Région
Le programme de coopération de la Grande Région couvre cinq régions situées dans trois États membres de l'UE (la France, la Belgique et l'Allemagne) ainsi que le Luxembourg. La Grande Région est une zone densément peuplée, qui compte 11,4 millions d'habitants pour une superficie de 65 401 km2.
D'après l'analyse SWOT effectuée en vue de l'établissement du programme 2014‑2020, l'un des défis de la région réside dans le manque de volonté et les difficultés réglementaires en matière de circulation des informations, en particulier dans le domaine de la santé. Les différences entre les quatre systèmes de soins de santé empêchent l'accès à des services de soins transfrontaliers, avec des conséquences potentiellement fatales lorsque des soins urgents pourraient être fournis plus rapidement par un hôpital proche situé dans un pays voisin. En outre, l'absence de système d'assurance maladie coordonné au niveau transfrontalier dissuade les patients de chercher à recevoir des soins dans les pays voisins, de crainte de ne pas pouvoir régler d'avance le coût du traitement en attendant que leur assurance maladie les rembourse.
Les autorités responsables du programme ont sélectionné, en vue d'un financement, une priorité d'investissement relative aux infrastructures sanitaires et sociales36. Elles ont choisi, comme valeur cible de l'indicateur de résultat, la conclusion de six accords d'accès aux soins de santé transfrontaliers avant la fin 2023. Fin 2019, 14 accords de ce type avaient été signés.
L'existence d'une stratégie cohérente visant à répondre aux défis s'est rarement traduite par une mise en œuvre ciblée
44Nous avons évalué les principaux éléments stratégiques des programmes de coopération ainsi que leur mise en œuvre concrète dans le cadre des appels à propositions et de la sélection des projets.
Dans la quasi-totalité des cas, les documents stratégiques relatifs aux programmes satisfaisaient aux exigences juridiques et cadraient avec les analyses des besoins
45Le règlement portant dispositions communes établit la nécessité d'une «logique d'intervention»37 solide, c'est-à-dire de liens manifestes entre les objectifs du programme et ses résultats escomptés. Puisque plusieurs Fonds de l'UE apportent un soutien dans la même zone géographique, il importe que ces Fonds et les instruments de financement nationaux soient efficacement coordonnés38. Pour Interreg, les opérations doivent associer des bénéficiaires d'au moins deux pays participants39.
46Nous avons donc examiné:
- la solidité de la logique d'intervention qui lie les défis recensés aux autres éléments de la procédure de sélection des projets, y compris le choix de l'axe prioritaire, des objectifs thématiques et spécifiques, des priorités d'investissement, des réalisations et des résultats ainsi que des valeurs cibles correspondantes;
- la question de savoir si les autorités responsables des programmes avaient pris des dispositions pour coordonner le financement avec d'autres sources;
- l'importance accordée au caractère transfrontalier, lors de la sélection des projets.
À quelques exceptions près, les programmes examinés reposaient sur une logique d'intervention solide
47Dans la quasi-totalité des cas, nous avons constaté qu'il existait bel et bien une logique d'intervention solide liant l'analyse des défis à la sélection, par les autorités responsables des programmes, des axes prioritaires, des objectifs thématiques et spécifiques ainsi que des priorités d'investissement, et que cette logique couvrait également les appels à propositions. Lorsque l'analyse SWOT n'était pas suffisamment poussée pour apporter les éléments nécessaires à la prise de décisions stratégiques (voir point 36), la cohérence de la logique d'intervention du programme s'en est ressentie.
48Les autorités responsables des programmes se sont également conformées à l'obligation de concentrer l'essentiel des fonds sur quatre objectifs thématiques au maximum. Parfois, elles ont opté pour un ciblage encore plus précis des programmes, qu'elles ont centrés sur des secteurs d'activité spécifiques. Tel est le cas, par exemple, du programme relatif au sud de la Baltique, qui englobe des régions de Pologne, du Danemark, d'Allemagne, de Lituanie ainsi que de Suède, et qui vise à accroître le potentiel de croissance «bleue» (maritime) et «verte» (environnementale) de la région du sud de la Baltique, bien que plusieurs autres défis aient été mis en évidence dans cette région.
49Rares étaient cependant les programmes de coopération qui soutenaient le financement de projets relevant de domaines qui n'avaient pas été recensés dans l'analyse SWOT ou dans l'analyse socioéconomique. Dans le cas du programme Slovaquie – Tchéquie, par exemple, les autorités ont décidé d'investir dans des opérations conçues pour améliorer la qualité de la coopération transfrontalière entre les administrations locales et régionales. Bien qu'il s'agisse de l'un des principaux problèmes auxquels sont confrontées les régions transfrontalières en général, le manque de capacités institutionnelles n'était pas mentionné dans l'analyse socioéconomique relative à ce programme.
50Dans le cas du programme de coopération relatif à la Baltique centrale, les autorités responsables ont décidé de centrer leur action sur les opportunités offertes aux régions transfrontalières plutôt que sur les défis auxquels celles-ci sont confrontées. Elles ont investi dans des opérations destinées à maintenir ou créer des emplois, à soutenir les PME et à renforcer l'attractivité touristique de la région. En l'occurrence, la logique d'intervention du programme de coopération était claire et satisfaisait aux autres exigences juridiques. Il s'en est toutefois suivi qu'aucune action visant à répondre aux défis des régions transfrontalières n'a été engagée, comme l'a corroboré notre examen de l'un des quatre projets relevant de ce programme de coopération.
Les programmes comportaient des informations sur la coordination avec les autres sources de financement, et une procédure d'évaluation du caractère transfrontalier avait été mise en place
51Nous avons constaté que tous les programmes de coopération comportaient des informations sur des mécanismes destinés à coordonner le financement avec d'autres sources de financement national ou de l'UE, comme les Fonds ESI. Ils contenaient par exemple des informations détaillées sur la participation d'agents clés de diverses autorités à des réunions au cours desquelles ont été étudiées les possibilités de synergies entre les fonds, et sur la marche à suivre pour éviter que deux sources différentes financent la même opération.
52Enfin, nous avons observé que toutes les procédures de sélection permettaient de s'assurer du caractère transfrontalier des projets, et notamment de la détermination des partenaires situés de part et d'autre de la frontière à y participer activement.
En pratique, nous avons relevé plusieurs faiblesses dans la mise en œuvre de la stratégie et son suivi
53Nous avons examiné la mise en œuvre des stratégies relatives aux programmes dans le cadre des appels à propositions et de la sélection des projets, et son suivi ainsi que sa coordination avec les autres mécanismes de financement dans les mêmes zones géographiques. Pour ce qui a trait à la mise en œuvre et au suivi, nous avons relevé plusieurs faiblesses concernant la délimitation entre programmes de coopération et programmes principaux, le caractère transfrontalier des projets, la procédure de sélection de ceux-ci, les indicateurs utilisés et la qualité des données statistiques ainsi que leur disponibilité.
Absence fréquente d'une délimitation claire entre programmes de coopération et programmes principaux
54Au niveau de l'UE, 66 % de la superficie terrestre totale sont éligibles à un financement au titre de l'objectif Interreg relatif aux frontières intérieures et extérieures. Pour 17 États membres, la part du territoire éligible dépasse les 80 % (voir encadré 3 et figure 8).
Encadré 3
Augmentation de l'étendue des régions éligibles au financement Interreg relatif aux frontières intérieures et extérieures
Pour la période de programmation 2014‑2020, la part de la surface terrestre des États membres ayant vocation à bénéficier d'un financement au titre d'Interreg, que ce soit dans le cadre de programmes de coopération intérieure ou extérieure, a fortement augmenté, de sorte qu'actuellement, la part du territoire éligible à un financement au titre de la coopération transfrontalière est de:
- plus de 80 % pour 17 États membres (Belgique, Tchéquie, Danemark, Estonie, Croatie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Autriche, Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande et Suède);
- plus de 60 % pour trois États membres (Bulgarie, Pays-Bas et Pologne);
- plus de 40 % pour les sept États membres restants (Allemagne, Irlande, Grèce, Espagne, France, Italie et Roumanie).
Figure 8
Superficie terrestre des États membres éligible à un financement au titre des programmes de coopération relatifs aux frontières intérieures et extérieures

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données fournies par Eurostat.
Les programmes principaux et les programmes de coopération permettent de cofinancer des projets de l'UE dans les mêmes zones géographiques (voir point 08). Nous avons comparé le ciblage de chacun des 23 programmes de coopération de notre échantillon avec celui de deux programmes principaux couvrant les régions limitrophes (voir point 30), en nous focalisant sur les priorités d'investissement communes à ces programmes (la réglementation applicable permet en effet que les programmes aient des priorités d'investissement en commun). Pour ces priorités communes, nous avons comparé les domaines de soutien et les types d'opérations que les programmes visaient à cofinancer, et nous avons examiné si les programmes étaient clairement délimités et si leur complémentarité était attestée.
56Nous avons constaté que, dans 14 cas, il n'existait pas de délimitation claire entre les domaines de soutien et entre les types d'opérations à cofinancer. En d'autres termes, les programmes principaux pouvaient financer le même type d'opérations que les programmes de coopération, à la différence que, pour le soutien au titre de ces derniers, un caractère transfrontalier et la participation de deux partenaires situés de part et d'autre de la frontière étaient exigés. Les cas concernés relevaient principalement de domaines de soutien tels que l'environnement, la culture, le tourisme, la compétitivité et la création d'emplois.
57La région du sud de la Baltique offre un bon exemple de distinction claire entre les types de projets: la construction d'une piste cyclable a été financée dans le cadre d'un des programmes principaux, celle d'aires de repos situées le long de cette piste l'ayant été au titre du programme de coopération. Ce type d'approche nécessite une bonne coopération, lors de la phase de programmation, entre les autorités responsables des programmes.
58Pour maximiser la valeur ajoutée dans les cas où plusieurs programmes de soutien permettent de financer la même priorité d'investissement, il importe de coordonner les domaines de soutien et de différencier les types de projets cofinancés. Durant la période 2014‑2020, la réglementation relative à la coopération territoriale européenne exigeait que 80 % du financement soient concentrés sur quatre, au maximum, des 11 objectifs thématiques (voir point 13). Pour la période 2021‑2027, toutefois, la concentration thématique est moindre, car les autorités responsables des programmes de coopération relatifs aux frontières terrestres intérieures ont par exemple la possibilité d'affecter des fonds aux sept objectifs stratégiques (à savoir les cinq objectifs stratégiques généraux et les deux objectifs spécifiques d'Interreg; voir point 22).
59Avec le chevauchement entre les régions éligibles au bénéfice d'Interreg et des programmes principaux du FEDER (voir point 54), la réduction du budget dévolu à Interreg (voir point 07) et l'élargissement du ciblage des programmes pour la période 2021‑2027 (voir point 22), la nécessité d'une délimitation claire entre les programmes principaux et les programmes de coopération devient plus impérieuse. Une séparation plus nette pourrait avoir pour effets de renforcer les synergies, de réduire le risque de double financement et d'augmenter la valeur ajoutée des projets. L'évaluation ex post relative à la période 2007‑2013 a également épinglé l'étendue des programmes, de même que la faiblesse de la coordination entre les programmes de coopération et les programmes principaux (voir point 19).
Le caractère transfrontalier de certains projets était discutable
60Les projets de coopération doivent associer des bénéficiaires d'au moins deux pays participants, même si, d'après la législation, un projet peut être mis en œuvre dans un seul pays pour autant que «les incidences et les avantages transfrontaliers ou transnationaux soient identifiés»40.
61Pour les 16 projets de notre échantillon, nous avons examiné:
- s'ils visaient à remédier à au moins un type de difficulté transfrontalière;
- si certains d'entre eux étaient mis en œuvre dans un seul État membre;
- si la contribution de chaque partenaire et la contribution collective du projet transfrontalier généraient des avantages visibles dans tous les États membres participants;
- si ces avantages transfrontaliers justifiaient le financement de l'opération au titre du programme de coopération.
Nous avons vérifié qu'à une exception près (voir point 50), tous les projets visaient à remédier à au moins une difficulté transfrontalière. Tous étaient mis en œuvre dans au moins deux États membres participants, et leurs avantages étaient visibles dans tous les États concernés. Cependant, dans huit cas, la coopération entre les partenaires s'est limitée à la présentation d'une proposition commune afin d'obtenir un financement pour les interventions; en outre, les projets concernés étaient dépourvus de critères communs et ne pouvaient donc être qualifiés de projets transfrontaliers. Les quatre projets examinés relevant du secteur du tourisme, l'un des principaux domaines de soutien au titre d'Interreg au cours de la période 2014‑2020 (voir point 17), présentaient tous cette faiblesse.
63L'encadré 4 fournit des exemples de projets à fort et à faible caractère transfrontalier, relevant du même programme.
Encadré 4
Deux exemples de projets relevant du programme Tchéquie – Pologne, l'un présentant un caractère transfrontalier discutable, l'autre un caractère transfrontalier manifeste
Modernisation des pavillons d'un zoo et des installations d'un site touristique: une demande de financement a été déposée en vue de la modernisation des installations de deux attractions touristiques situées chacune dans un pays, à environ 75 km l'une de l'autre, et de la conception d'une campagne marketing commune. Cependant, les partenaires ne faisaient pas de publicité l'un pour l'autre sur leurs sites internet et un système de billetterie commun n'a pas été mis en place. Le projet n'avait donc pas de caractère transfrontalier.
Coopération transfrontalière des unités de police: les huit unités de police des deux régions couvertes par le programme de coopération ont introduit une demande de financement afin de renforcer la coordination dans la lutte contre la criminalité liée aux stupéfiants. Les activités relevant du projet comprenaient l'achat d'équipements permettant de révéler la présence de stupéfiants (spectromètres, par exemple), des patrouilles de police communes, des formations communes pour les policiers, y compris des cours de langues, et des campagnes d'information, à destination des enseignants et des parents, sur les stupéfiants et le matériel utilisé. Ce projet a permis de resserrer la coopération entre les huit unités de police et présentait un réel caractère transfrontalier.
En raison de plusieurs faiblesses dans la sélection des projets, les meilleurs d'entre eux n'ont pas toujours été retenus
64L'appel à propositions et la sélection des projets sont des phases cruciales du processus de mise en œuvre des programmes, en particulier eu égard au montant des ressources disponibles pour les programmes de coopération (voir point 38) et parce que le taux d'engagement au titre d'Interreg n'a pas été source de préoccupation majeure ces dernières années (voir point 17). Pour pouvoir atteindre les objectifs des programmes de coopération et répondre aux besoins les plus urgents des régions transfrontalières, il est d'autant plus important que les projets soient sélectionnés sur la base de leurs mérites.
65Pour les 10 programmes de coopération pour lesquels nous avons effectué des contrôles documentaires approfondis et les trois programmes ayant donné lieu à des visites sur place, nous avons donc examiné la manière dont les autorités responsables:
- ont informé le public des domaines et des types de projets éligibles à un soutien dans le cadre de chaque programme, en vue d'attirer des propositions de projets conformes aux objectifs de celui-ci;
- ont évalué les propositions de projets;
- ont sélectionné les projets répondant le mieux aux défis de leur région.
Pour ces programmes de coopération, les documents de programmation satisfaisaient aux exigences juridiques41 et comportaient des informations de base sur les programmes: description du type d'actions devant bénéficier d'un soutien au titre de chaque priorité d'investissement, contribution escomptée de ces actions aux objectifs spécifiques, principes directeurs régissant la sélection des opérations, recensement des principaux groupes cibles, types de bénéficiaires, etc. Nous avons toutefois relevé des faiblesses à chacune des trois phases de la sélection des projets.
67Pour cinq de ces 13 programmes de coopération, le repérage des projets potentiels a reposé sur une approche «ascendante»: les candidats à un financement ont présenté leurs dossiers de projets sans avoir guère reçu d'indications des autorités responsables concernant la manière dont les projets devaient répondre directement aux besoins de la région (voir encadré 5). L'évaluation ex post relative à la période 2007‑2013 a également fait état de ce problème, alors bien plus répandu (voir point 19).
Encadré 5
Deux approches possibles pour attirer des projets
Les autorités responsables des programmes sélectionnent la majorité des projets en passant des appels ouverts à propositions de projets invitant les candidats à déposer des demandes de financement. Ces appels doivent tenir compte des axes prioritaires, des objectifs thématiques, des objectifs spécifiques et des priorités d'investissement des programmes. Chaque procédure de sélection doit déboucher sur le choix des projets qui permettent le mieux de répondre aux défis auxquels le programme vise à remédier.
Les idées de projets peuvent être présentées:
dans le cadre d'une approche «ascendante» (appels à propositions génériques), c'est-à-dire par le bénéficiaire potentiel lui-même, qui essaie alors d'adapter la proposition de projet aux exigences de l'appel;
dans le cadre d'une approche «descendante» (appels à propositions ciblés), où les autorités responsables du programme fournissent d'abord des indications sur les attentes en matière de ciblage des projets potentiels.
Pour dix des programmes, les autorités ont évalué les dossiers au moyen d'un système de points en vertu duquel les projets devaient obtenir une note minimale pour avoir une chance d'être sélectionnés. Ce système non seulement contribue à la transparence de la procédure de sélection, mais facilite également les travaux ultérieurs du comité de suivi (qui a pour mission de choisir les projets à cofinancer). Pour les trois autres programmes, il n'existait pas de système de points, et les autorités responsables ont fondé la sélection sur une évaluation qualitative, qui ne permet pas une hiérarchisation claire des projets.
69Pour trois programmes, les autorités responsables ont communiqué une liste des projets, classés en fonction de leurs mérites, au comité de suivi. Pour les dix autres programmes de coopération, par contre, même dans les cas où un système de points avait été utilisé, les dossiers de projets transmis au comité de suivi n'avaient pas été classés par les autorités responsables. L'encadré 6 fournit un exemple de bonne pratique et un autre de pratique non satisfaisante en matière de sélection des projets.
Encadré 6
Procédure de sélection relative à Interreg: exemples de bonne pratique et de pratique non satisfaisante
Les autorités responsables du programme de coopération Tchéquie – Pologne ont appliqué la procédure de sélection suivante, conçue pour permettre de choisir, en toute transparence, les projets répondant le mieux aux défis recensés dans le programme de coopération:
- les régions participantes dressent une liste d'experts dans chaque domaine de soutien couvert par le programme;
- chaque projet est évalué par quatre experts externes (deux de chaque État membre): deux issus des régions où sont basés les partenaires du projet et les deux autres, d'autres régions couvertes par le programme;
- l'évaluation des effets transfrontaliers est assurée par les deux experts externes issus des régions où sont basés les partenaires du projet et par un membre du personnel du secrétariat conjoint;
- l'évaluation de la coopération transfrontalière est effectuée par deux membres du personnel du secrétariat conjoint (un de chaque État membre);
- pour pouvoir être éventuellement éligibles à un cofinancement, les projets doivent obtenir une note globale supérieure ou égale à 70 %, ainsi qu'une note minimale de 70 % dans certains domaines spécifiques;
- le secrétariat conjoint classe les projets en fonction des notes obtenues et les transmet au comité de suivi, qui procède à la sélection proprement dite.
À l'opposé, les autorités responsables du programme Royaume-Uni/Pays de Galles – Irlande ont établi une procédure de sélection mal définie, menée en continu, sans appels à propositions concurrentiels. Elles n'ont pas attribué de notes aux dossiers de projets, mais ont apprécié leur «caractère approprié» selon quelques critères qualitatifs. Les propositions de projets étaient écartées comme «non appropriées» lorsque le candidat avait fourni des réponses incomplètes ou insatisfaisantes au regard d'un grand nombre des exigences en matière de preuve formulées, ce qui attestait d'un niveau de risque inacceptable. Ce système ne permettait donc pas de classer les projets en fonction de leurs mérites et de leur degré de priorité. Il n'existait aucune assurance que les autorités seraient en mesure de sélectionner de façon transparente les meilleurs projets.
Les indicateurs ne rendaient généralement pas compte des effets transfrontaliers, et la quantité limitée de données statistiques régionales disponibles entravait le suivi et l'évaluation
70Afin d'axer davantage les programmes sur les résultats, les autorités étaient tenues de définir, pour chaque axe prioritaire, les résultats attendus relatifs aux objectifs spécifiques, les indicateurs de réalisation et de résultat, ainsi qu'une valeur de référence et une valeur cible pour l'ensemble de la période de programmation42. Le règlement CTE comprend une liste d'indicateurs de réalisation communs que les autorités responsables des programmes peuvent décider d'utiliser43. Les valeurs cibles peuvent être exprimées en termes quantitatifs ou, pour les indicateurs de résultat uniquement, qualitatifs44. Pour pouvoir effectuer un suivi fiable de ces valeurs cibles, les autorités responsables des programmes doivent collecter des données statistiques solides.
71Pour l'ensemble des 23 programmes de coopération, nous avons examiné si les objectifs spécifiques répondant aux besoins recensés dans les régions transfrontalières étaient conformes aux critères SMART (c'est-à-dire s'ils étaient spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés).
72Nous nous sommes en outre attachés à déterminer si les indicateurs de réalisation et de résultat définis pour chaque programme étaient:
- pertinents au regard des objectifs spécifiques du programme;
- propres à mesurer l'impact des opérations soutenues;
- susceptibles d'atteindre leurs valeurs cibles pour la fin de la période de programmation. Pour ce faire, nous avons également utilisé les conclusions des derniers rapports annuels de mise en œuvre disponibles.
Nous avons constaté que, de manière générale, les objectifs spécifiques des programmes étaient conformes aux critères SMART. Ils suivaient la logique d'intervention du programme, étaient liés aux axes prioritaires, objectifs thématiques et priorités d'investissement sélectionnés, et jetaient un pont entre la stratégie, d'une part, et les actions et opérations soutenues, d'autre part.
74En outre, d'après nos constatations, les indicateurs de réalisation communs, de même que les indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques des programmes, étaient généralement mesurables et, dans tous les cas, une valeur de référence ainsi qu'une valeur cible avaient été établies. L'utilisation des indicateurs de réalisation communs facilite l'agrégation des données relatives aux Fonds ESI.
75Sept autorités responsables de programmes ont mis à profit la possibilité, offerte par la législation, de mesurer certains indicateurs de résultat moyennant une évaluation qualitative, c'est-à-dire une enquête. Nous avons découvert que, dans trois cas, les autorités responsables des programmes avaient envoyé le questionnaire aux bénéficiaires et autres parties prenantes auxquels elles avaient octroyé un financement. Cela peut donner à penser que les résultats ne sont pas recueillis de manière objective, dans la mesure où les bénéficiaires ont peut-être fourni des réponses plus positives qu'ils ne l'auraient fait en l'absence de tout lien de dépendance.
76Dans tous les programmes de coopération examinés, hormis celui relatif au sud de la Baltique, nous avons également relevé des problèmes liés à la pertinence des indicateurs et au caractère réalisable de leurs valeurs cibles. Ces problèmes concernaient aussi bien les indicateurs de réalisation communs que les indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques des programmes.
77Pour ce qui est de la pertinence, bon nombre des indicateurs de réalisation communs et des indicateurs spécifiques des programmes étaient impropres à rendre compte des effets transfrontaliers des opérations financées au titre d'Interreg. De plus, nous avons recensé des cas où les indicateurs définis ne mesuraient pas l'effet des opérations soutenues sur l'objectif spécifique, et d'autres dans lesquels l'effet ne pouvait pas être imputé directement et exclusivement à un projet en particulier. Dans de nombreux programmes, par exemple, l'«augmentation du nombre de séjours à l'hôtel dans la région» était utilisée comme indicateur de résultat pour une opération culturelle/touristique, bien que le nombre de séjours à l'hôtel dans une région soit lié à plusieurs facteurs socioéconomiques, et pas uniquement au projet Interreg.
78En ce qui concerne le caractère réalisable des valeurs cibles, nous avons relevé des exemples diamétralement opposés. Dans certains cas, les valeurs cibles n'étaient pas réalistes et, selon toute vraisemblance, ne seront pas atteintes pour la fin de la période de programmation, ce qui indique que les autorités responsables des programmes:
- n'avaient pas lancé suffisamment d'appels à manifestation d'intérêt concernant les objectifs spécifiques pertinents du programme, ou
- n'avaient pas invité les bénéficiaires à solliciter des financements pour des projets répondant aux objectifs du programme (voir encadré 5), ou
- avaient établi une valeur cible inappropriée au départ.
Dans d'autres cas, les valeurs cibles n'étaient pas suffisamment ambitieuses et avaient été atteintes dès les premières années de la période de programmation, ce qui indique que les autorités responsables des programmes avaient conclu des conventions de subvention pour un plus grand nombre de projets que ce qui était nécessaire. Cela montre que les précédents appels à propositions de projets n'ont pas été pris en considération lors du lancement des nouveaux appels à propositions.
79Pour que les valeurs des indicateurs soient pertinentes et fiables, des données régionales sont nécessaires. Pour les 23 programmes de coopération de notre échantillon, nous avons constaté que peu de ces données étaient disponibles. Dans un cas, l'autorité responsable du programme ne disposait d'aucune donnée régionale pour calculer l'effet d'un objectif spécifique. La Commission a confirmé que la disponibilité de statistiques régionales transfrontalières était insuffisante, ce qui était principalement dû aux différences de méthodes et au manque de coordination statistique au niveau transfrontalier.
Les orientations de la Commission ont été améliorées, mais la mise en œuvre des programmes a pâti de l'adoption tardive du cadre juridique
80Nous avons examiné les orientations fournies par la Commission aux autorités responsables des programmes aux fins du recensement de leurs difficultés transfrontalières pour la période 2014‑2020 ainsi que pour la période 2021‑2027. Nous avons également évalué l'ampleur du recours aux mesures liées à la COVID-19 dans la mise en œuvre des programmes de coopération de la période 2014‑2020, de même que le degré de préparation en vue de la période 2021‑2027.
La Commission a apporté davantage d'orientations et de soutien pour la période 2021-2027
81Pour la période 2014‑2020, la Commission a communiqué des orientations sur ce qu'elle considérait comme des priorités en matière de financement à chaque État membre dans un document de prise de position de 2012 consacré à l'élaboration de l'accord de partenariat.
82Dans la quasi-totalité des cas, ces orientations se limitaient à quelques paragraphes de généralités et à des titres sur les domaines de dépenses potentielles pour les régions transfrontalières. Elles comportaient très peu de messages spécifiques relatifs à la coopération transfrontalière susceptibles d'être utilisés pour guider l'élaboration des programmes.
83La période 2021‑2027 est la sixième période de programmation d'Interreg. Nous avons examiné si la Commission avait tiré parti des connaissances acquises au cours des périodes précédentes et pris des mesures concrètes pour aider les États membres à établir et à mettre en œuvre leurs programmes de coopération.
84La Commission a participé plus activement à la préparation de la période 2021‑2027 et a mené une série d'initiatives pour aider les États membres à recenser les difficultés transfrontalières, entre autres:
- l'initiative de réexamen de la politique transfrontalière, qui a consisté à mener de manière intensive, durant deux années, des activités de recherche et de dialogue avec les parties prenantes frontalières ainsi qu'avec les autorités nationales et régionales. Ce réexamen a comporté des études sur les obstacles juridiques et administratifs rencontrés aux frontières des États membres de l'UE;
- la création, au sein de la DG REGIO, du service de «point de contact frontalier», qui aide les États membres à résoudre les problèmes transfrontaliers de nature juridique ou administrative;
- l'établissement, pour chaque frontière, d'un document d'orientation exposant le point de vue de la Commission sur les principaux défis, les opportunités, les scénarios possibles en ce qui concerne la coopération à venir et la nécessité d'une séparation claire avec les autres programmes couvrant les régions frontalières.
Les documents d'orientation relatifs aux frontières, en particulier, se sont avérés particulièrement utiles pour améliorer le ciblage des difficultés transfrontalières: ils décrivent les principales caractéristiques des régions transfrontalières et présentent des options ainsi que des orientations en matière de programmation. Même dans les cas où les autorités responsables des programmes ne souscrivaient pas entièrement à leur contenu, ces documents ont joué un rôle important dans les travaux préparatoires et le lancement de la discussion sur les besoins transfrontaliers.
Les autorités responsables des programmes transfrontaliers ont tiré parti des possibilités de simplification offertes pendant la crise liée à la COVID-19
86Peu après le début de la pandémie de COVID-19, la Commission a présenté des propositions de mesures visant à alléger les exigences juridiques relatives aux Fonds ESI, en particulier pour l'année 2020 (voir point 23, point 24 et figure 5).
87Nous avons examiné le recours qui a été fait à ces mesures dans le cadre des 53 programmes de coopération transfrontalière (voir point 33). Nous avons également examiné les répercussions de la pandémie sur la mise en œuvre des trois programmes de coopération ayant donné lieu à des visites sur place et du programme Roumanie – Bulgarie, pour lequel un examen de ce type était prévu.
88Fin février 2021, 186 programmes de 24 États membres, y compris les programmes Interreg, avaient fait l'objet de 241 modifications liées à la COVID-19, dont 202 nécessitant une adoption par la Commission. Les 39 autres étaient des modifications simplifiées adoptées par les États membres ou, dans le cas d'Interreg, par les autorités responsables des programmes, et notifiées à la Commission. En ce qui concerne les programmes Interreg, 33 autorités responsables ont utilisé des mesures liées à la COVID-19 comportant une modification des programmes. La mesure à laquelle il a le plus été recouru est celle qui autorise à différer la présentation du rapport annuel de mise en œuvre. Le dernier rapport a été transmis en septembre 2020 (au lieu de l'être en mai), c'est-à-dire avec quatre mois de retard. D'après la Commission, le fort taux d'engagement (voir point 17) est la principale raison qui explique que cette mesure ait été la plus utilisée. Par ailleurs, sept autorités responsables de programmes ont procédé à des modifications simplifiées nécessitant seulement une notification à la Commission, mais n'exigeant pas de modification du programme.
89Pour ce qui est de l'impact sur la mise en œuvre, les autorités responsables des trois programmes pour lesquels nous avons effectué des visites sur place ainsi que du programme Roumanie – Bulgarie (pour lequel un examen sur place était prévu) ont déclaré que la crise avait frappé chaque projet d'une façon différente, selon le calendrier et le type d'activités prévues, comme le montre l'exemple de l'encadré 7. De manière générale, les projets tributaires des déplacements ont nécessité des modifications plus substantielles ou l'adoption de dispositions différentes, par exemple le remplacement de réunions sur site par des téléconférences. Cependant, d'après les indications fournies par les autorités responsables de ces quatre programmes, les bénéficiaires ont été contraints d'abandonner ou de suspendre moins de 1 % des projets approuvés.
Encadré 7
L'impact de la COVID-19
Le programme de coopération relatif à la Baltique centrale couvre des régions de Finlande, d'Estonie, de Lettonie et de Suède. D'après son autorité de gestion, au moment où la crise liée à la COVID-19 a débuté:
- pour les projets qui n'étaient qu'au début de leur mise en œuvre, le calendrier et le contenu des actions ont pu être facilement modifiés;
- pour la moitié de ceux qui étaient à mi-parcours, des demandes de report de délai ou de modification de la mise en œuvre des plans de travail ont été déposées;
- pour une majorité des projets qui approchaient de la fin du processus, l'achèvement des activités a comporté des difficultés. Dans la plupart de ces cas, les bénéficiaires ont demandé un report de délai.
Le cadre juridique n'était pas encore approuvé lorsque la période 2021-2027 a commencé
90Enfin, nous avons examiné l'élaboration des documents relatifs à la période 2021‑2027 pour l'ensemble des programmes de coopération de notre échantillon. Nous avons procédé au suivi de la mise en œuvre d'une recommandation de la Cour visant à ce que la Commission établisse en temps utile les propositions législatives en matière de cohésion45 et nous avons effectué une comparaison avec les deux précédentes périodes de programmation, en ce qui concerne la durée nécessaire à l'adoption du cadre juridique.
91À deux exceptions près, les autorités responsables des 23 programmes ont déclaré que les discussions relatives à la prochaine période de programmation n'avaient commencé que peu avant la pause estivale de 2020. D'après les autorités responsables des programmes, l'élaboration de ceux-ci a débuté tardivement à cause de l'insécurité juridique qui prévalait dans l'attente de l'adoption du cadre juridique. Ce retard dans l'adoption du cadre juridique, joint à la nécessité d'achever les travaux relevant d'une période de programmation tout en lançant la suivante46, a empêché un démarrage en douceur de la période de programmation pluriannuelle au niveau des États membres.
92Les propositions de la Commission relatives au nouveau règlement portant dispositions communes, au nouveau règlement FEDER et au nouveau règlement CTE ont été publiées en mai 2018, bien avant le début de la période de programmation, conformément à notre précédente recommandation. Toutefois, les négociations entre le Parlement européen et le Conseil ont duré plus longtemps que prévu. Fin avril 2021, c'est-à-dire quatre mois après le début de la période de programmation 2021‑2027, le paquet législatif relatif à la politique de cohésion, qui comprenait le règlement CTE, n'avait toujours pas été adopté. À titre de comparaison, la base juridique pertinente avait été adoptée respectivement un mois et cinq mois avant le début des périodes de programmation 2014‑2020 et 2007‑2013.
Conclusions et recommandations
93Lors de cet audit, nous avons cherché à déterminer si la Commission et les États membres avaient réellement tenu compte, dans les programmes de coopération relative aux frontières intérieures financés au titre d'Interreg, des défis des régions transfrontalières. Dans l'ensemble, nous avons constaté que les programmes de coopération examinés comportaient des stratégies claires pour répondre aux défis des régions transfrontalières couvertes. Toutefois, en raison de faiblesses dans la mise en œuvre et d'insuffisances dans les informations de suivi, ces programmes n'étaient que peu susceptibles de libérer le potentiel de ces régions. Certaines des recommandations ci-après sont adressées aux autorités responsables des programmes examinés, mais compte tenu de la forte proportion de programmes couverts, nous estimons qu'elles s'appliquent également aux autres autorités responsables de programmes. Les autorités responsables des programmes nous ont fait part de leurs réactions à ces recommandations (voir annexe VI).
94Les programmes de coopération ne permettent pas de remédier à toutes les difficultés transfrontalières à cause de leur budget limité et parce que les mesures contre certaines d'entre elles doivent être prises entre États membres, au niveau national. Nous avons constaté que même lorsque les autorités responsables des programmes avaient analysé les défis, elles ne les avaient pas hiérarchisés afin de concentrer leurs efforts sur ceux que les régions transfrontalières devaient relever en priorité (voir points 36 à 43).
95En ce qui concerne la stratégie, les programmes de coopération étaient dotés d'une logique d'intervention solide, et il existait un lien entre les défis, les axes prioritaires, les objectifs thématiques et spécifiques ainsi que les appels à propositions de projets. Les documents relatifs aux programmes indiquaient la marche à suivre pour coordonner les programmes de coopération avec les autres fonds. Les procédures de sélection décrites dans les documents relatifs aux programmes mettaient en avant le caractère transfrontalier des projets à cofinancer, et tenaient compte de la détermination de partenaires basés dans différents pays/différentes régions à participer activement au projet (voir points 47 à 50).
96Cependant, pour 14 des 23 programmes de coopération compris dans notre échantillon, nous avons observé que, du point de vue des domaines de soutien et des types d'opérations à cofinancer, il n'existait pas de délimitation claire avec les programmes principaux, si bien que les deux sources de financement pouvaient soutenir le même type d'opérations. Le ciblage requis sur les besoins réels risque de pâtir de ce chevauchement entre les domaines éligibles à un financement au titre à la fois d'Interreg et des programmes principaux du FEDER. La nécessité d'augmenter la valeur ajoutée des interventions de l'UE revêt d'autant plus d'importance que, pour la période 2021‑2027, le budget dédié à Interreg sera revu à la baisse et la concentration thématique, réduite par rapport à la période 2014‑2020 (voir points 56 à 59).
97Nous avons par ailleurs décelé des projets dont peu d'éléments attestaient le caractère transfrontalier, car la coopération entre les partenaires s'était limitée à la présentation d'une proposition de projet commune afin d'obtenir un financement pour les interventions (voir point 62).
Recommandation n° 1 – Mieux cibler les programmes de coopération- Les autorités responsables des programmes de coopération examinés devraient:
- veiller à ce que les documents relatifs à ces programmes précisent que, pour les priorités d'investissement qu'ils soutiennent, ceux-ci sont centrés sur des types de projets différents par rapport aux programmes principaux des régions limitrophes;
- coordonner le soutien, lorsque ces programmes couvrent les mêmes domaines de soutien que les programmes principaux des régions limitrophes.
- Dans le droit fil des deux recommandations précédentes, la Commission devrait exiger, lors de l'adoption des programmes de coopération et des programmes principaux, que les projets cofinancés soient complémentaires.
Quand? D'ici à décembre 2022.
98Les autorités responsables de la plupart des programmes n'ont pas classé les projets en fonction de leurs mérites afin de faire en sorte que seules les meilleures propositions à financer soient prises en considération. Il s'agit là d'une omission lourde de conséquences lorsque l'on dispose de peu de fonds. En outre, pour certains programmes de coopération, les propositions de projets ne devaient pas obtenir de note minimale pour être sélectionnées, ce qui permet pourtant de garantir le caractère transfrontalier des propositions et leur contribution à la réponse aux défis à relever en priorité par la région (voir points 66 à 69).
Recommandation n° 2 – Hiérarchiser les projets et leur accorder un soutien en fonction de leurs mérites au moyen d'un système de notationPour que soient sélectionnés les projets qui répondent le mieux aux défis des régions transfrontalières et aux objectifs des programmes de coopération, les autorités responsables de programmes couvertes par l'examen devraient:
- utiliser un système fondé sur les mérites dans le cadre du processus d'évaluation des projets;
- ne proposer de financer que les projets qui ont obtenu une note globale minimale, ainsi qu'un certain nombre de points pour leur caractère transfrontalier.
Quand? D'ici à décembre 2022.
99Les objectifs spécifiques étaient conformes aux critères SMART, et les indicateurs de réalisation et de résultat étaient généralement mesurables. Cependant, ces deux types d'indicateurs présentaient des insuffisances du point de vue de leur pertinence et du caractère réalisable de leurs valeurs cibles: certains indicateurs n'étaient pas adaptés aux finalités de l'objectif spécifique ciblé par le projet et, pour certaines valeurs cibles, un juste milieu entre réalisation et ambition n'avait pas été trouvé. Dans la plupart des cas, les autorités responsables des programmes utilisaient des indicateurs qui ne rendaient pas compte des effets transfrontaliers (voir points 73 à 78).
Recommandation n° 3 – Utiliser des indicateurs qui visent à rendre compte des effets des projets transfrontaliersLors de l'évaluation des programmes de coopération aux fins de leur approbation, la Commission devrait:
- coopérer étroitement avec les autorités responsables des programmes afin d'encourager la sélection des indicateurs communs de réalisation et de résultat pertinents pour les types d'actions à mettre en œuvre dans le cadre des programmes et, dès lors, propres à mesurer les réalisations ainsi que les effets des projets transfrontaliers;
- dans les cas où il n'est pas possible de recourir aux indicateurs communs, faire équipe avec les autorités responsables des programmes afin d'évaluer si les indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques permettent de mesurer les réalisations et les effets des projets transfrontaliers en utilisant les orientations disponibles de la Commission.
Quand? D'ici à décembre 2022.
100Dans notre échantillon, les données sur lesquelles reposaient les statistiques régionales utilisées pour mesurer les indicateurs présentaient plusieurs faiblesses. Dans certains cas, les données étaient indisponibles, et dans d'autres, la coordination entre États membres était insuffisante pour permettre aux données de rendre compte avec fiabilité des effets transfrontaliers des opérations soutenues (voir point 79).
101Les orientations de la Commission à l'intention des autorités responsables des programmes ont été améliorées au cours des deux dernières périodes de programmation. Les documents d'orientation relatifs aux frontières établis pour la période 2021‑2027 ont fourni une analyse plus ciblée, y compris pour ce qui est des suggestions, que les documents de prise de position concernant la période 2014‑2020 (voir points 82 à 85).
102Les autorités responsables des programmes de coopération ont recouru aux mesures proposées dans le cadre des initiatives CRII et CRII+ afin d'atténuer les effets de la crise liée à la COVID-19. Quelques projets transfrontaliers seulement ont été suspendus ou annulés à cause de la pandémie, principalement parce que, pour de nombreux projets, des conventions de subvention avaient déjà été conclues au titre d'Interreg. La crise a toutefois eu des répercussions manifestes, et les autorités responsables des programmes ont déployé des efforts pour soutenir la mise en œuvre des projets ayant fait l'objet de conventions de subvention (voir points 88 et 89).
103La Commission a présenté ses propositions législatives relatives à la période 2021‑2027 en temps utile, mais les colégislateurs ne les ont adoptées qu'après le début de la période de programmation. L'élaboration des programmes de coopération a fortement pâti de ce retard, qui a empêché un démarrage en douceur de la nouvelle période de programmation (voir points 91 et 92).
Le présent rapport a été adopté par la Chambre II, présidée par Mme Iliana Ivanova, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg le 19 mai 2021.
Par la Cour des comptes,

Klaus-Heiner Lehne
Président
Annexes
Annexe I – Liste des programmes de coopération financés par la composante d'Interreg V-A relative aux frontières intérieures pour la période 2014-2020
Pour la période 2014‑2020, la Commission a approuvé, au total, 53 programmes de coopération transfrontalière relatifs aux frontières intérieures. La figure 9 en donne une représentation cartographique. Les parties hachurées correspondent aux zones couvertes par plusieurs programmes à la fois.
Figure 9
Composante d'Interreg V-A relative aux frontières intérieures: les 53 programmes de coopération
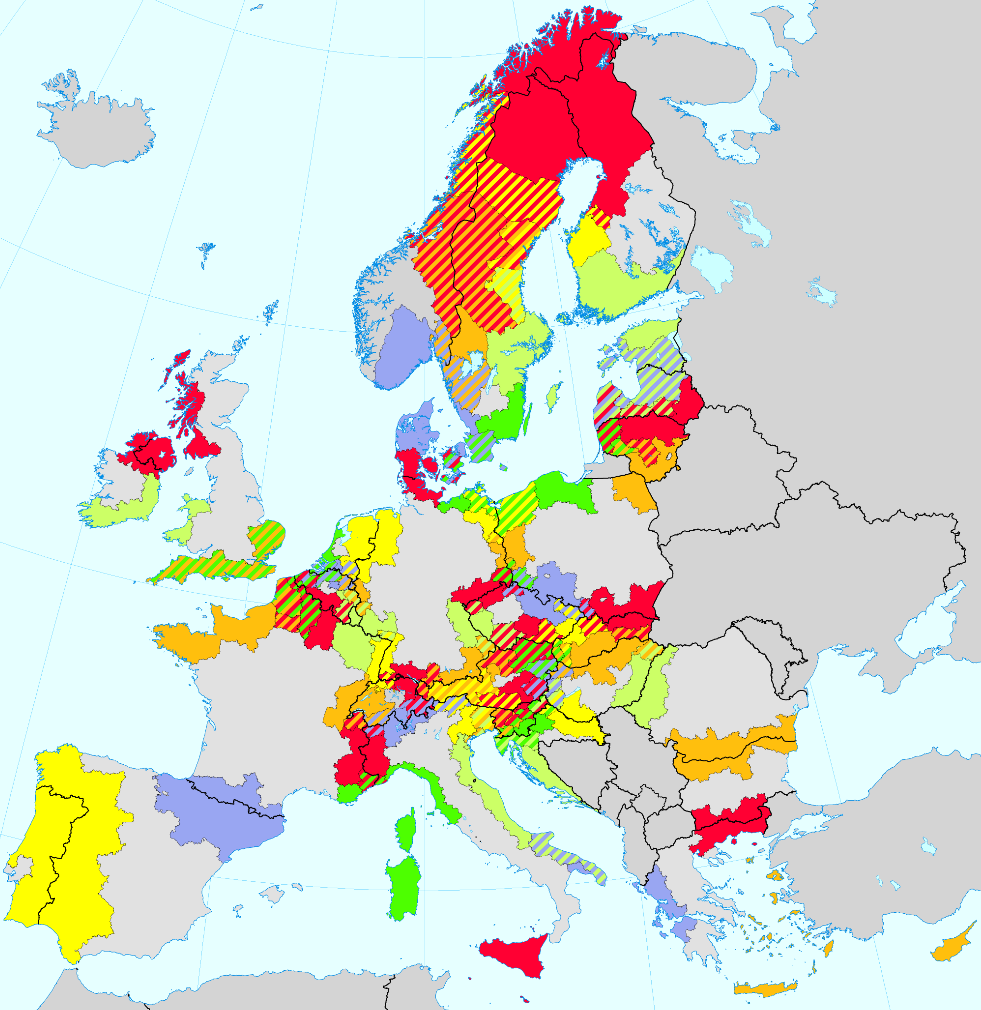
Source: Commission européenne.
Le tableau ci-après répertorie les 53 programmes de coopération et présente, pour chacun d'entre eux, le budget total et la contribution de l'UE. Les programmes que nous avons examinés sont indiqués en gras.
| Nom | Code commun d'identification | Budget total du programme (en euros) |
Montant total de la contribution de l'UE (en euros) |
|
| 1 | Belgique – Allemagne – Pays-Bas (Euregio Meuse-Rhin) | 2014TC16RFCB001 | 140 434 645 | 96 000 250 |
| 2 | Autriche – Tchéquie | 2014TC16RFCB002 | 115 076 396 | 97 814 933 |
| 3 | Slovaquie – Autriche | 2014TC16RFCB003 | 89 285 509 | 75 892 681 |
| 4 | Autriche – Allemagne/Bavière | 2014TC16RFCB004 | 64 332 186 | 54 478 064 |
| 5 | Espagne – Portugal (POCTEP) | 2014TC16RFCB005 | 484 687 353 | 365 769 686 |
| 6 | Espagne – France – Andorre (POCTEFA) | 2014TC16RFCB006 | 288 964 102 | 189 341 397 |
| 7 | Hongrie – Croatie | 2014TC16RFCB008 | 73 900 028 | 60 824 406 |
| 8 | Allemagne/Bavière – Tchéquie | 2014TC16RFCB009 | 121 617 825 | 103 375 149 |
| 9 | Autriche – Hongrie | 2014TC16RFCB010 | 95 870 327 | 78 847 880 |
| 10 | Allemagne/Brandebourg – Pologne | 2014TC16RFCB011 | 117 826 565 | 100 152 579 |
| 11 | Pologne – Slovaquie | 2014TC16RFCB012 | 210 114 137 | 178 597 014 |
| 12 | Pologne – Danemark – Allemagne – Lituanie – Suède (South Baltic) | 2014TC16RFCB013 | 100 614 276 | 82 978 784 |
| 13 | Finlande – Estonie – Lettonie – Suède (Central Baltic) | 2014TC16RFCB014 | 170 544 922 | 132 628 689 |
| 14 | Slovaquie – Hongrie | 2014TC16RFCB015 | 183 304 695 | 155 808 987 |
| 15 | Suède – Norvège | 2014TC16RFCB016 | 94 399 930 | 47 199 965 |
| 16 | Allemagne/Saxe – Tchéquie | 2014TC16RFCB017 | 189 274 570 | 157 967 067 |
| 17 | Pologne – Allemagne/Saxe | 2014TC16RFCB018 | 82 353 025 | 70 000 069 |
| 18 | Allemagne/Mecklembourg-Poméranie-occidentale – Brandebourg – Pologne | 2014TC16RFCB019 | 157 647 549 | 134 000 414 |
| 19 | Grèce – Italie | 2014TC16RFCB020 | 123 176 901 | 104 700 362 |
| 20 | Roumanie – Bulgarie | 2014TC16RFCB021 | 258 504 126 | 215 745 513 |
| 21 | Grèce – Bulgarie | 2014TC16RFCB022 | 130 262 835 | 110 723 408 |
| 22 | Allemagne – Pays-Bas | 2014TC16RFCB023 | 443 059 158 | 222 159 360 |
| 23 | Allemagne – Autriche – Suisse – Liechtenstein (Alpenrhein – Bodensee – Hochrhein) | 2014TC16RFCB024 | 56 554 900 | 39 588 430 |
| 24 | Tchéquie – Pologne | 2014TC16RFCB025 | 266 143 190 | 226 221 710 |
| 25 | Suède – Danemark – Norvège (Öresund – Kattegat – Skagerrak) | 2014TC16RFCB026 | 271 376 522 | 135 688 261 |
| 26 | Lettonie – Lituanie | 2014TC16RFCB027 | 82 255 348 | 69 621 072 |
| 27 | Suède – Finlande – Norvège (Botnia – Atlantica) | 2014TC16RFCB028 | 61 284 055 | 36 334 420 |
| 28 | Slovénie – Croatie | 2014TC16RFCB029 | 55 690 913 | 46 114 193 |
| 29 | Slovaquie – Tchéquie | 2014TC16RFCB030 | 106 046 429 | 90 139 463 |
| 30 | Lituanie – Pologne | 2014TC16RFCB031 | 70 769 277 | 60 153 883 |
| 31 | Suède – Finlande – Norvège (Nord) | 2014TC16RFCB032 | 94 617 296 | 60 413 727 |
| 32 | Italie – France (Maritime) | 2014TC16RFCB033 | 199 649 897 | 169 702 411 |
| 33 | France – Italie (Alcotra) | 2014TC16RFCB034 | 233 972 102 | 198 876 285 |
| 34 | Italie – Suisse | 2014TC16RFCB035 | 118 281 056 | 100 221 466 |
| 35 | Italie – Slovénie | 2014TC16RFCB036 | 92 588 182 | 77 929 954 |
| 36 | Italie – Malte | 2014TC16RFCB037 | 51 708 438 | 43 952 171 |
| 37 | France – Belgique – Pays-Bas – Royaume-Uni (Les Deux Mers/Two seas/Twee Zeeën) | 2014TC16RFCB038 | 392 143 504 | 256 648 702 |
| 38 | France – Allemagne – Suisse (Rhin supérieur/Oberrhein) | 2014TC16RFCB039 | 210 615 695 | 109 704 965 |
| 39 | France – Royaume-Uni (Manche/Channel) | 2014TC16RFCB040 | 315 264 678 | 223 046 948 |
| 40 | France – Suisse | 2014TC16RFCB041 | 102 823 622 | 65 890 505 |
| 41 | Italie – Croatie | 2014TC16RFCB042 | 236 890 849 | 201 357 220 |
| 42 | Belgique – France (France – Wallonie – Vlaanderen) | 2014TC16RFCB044 | 283 295 074 | 169 977 045 |
| 43 | France – Belgique – Allemagne – Luxembourg (Grande Région/Großregion) | 2014TC16RFCB045 | 234 606 265 | 139 802 646 |
| 44 | Belgique – Pays-Bas (Vlaanderen – Nederland) | 2014TC16RFCB046 | 305 151 170 | 152 575 585 |
| 45 | Royaume-Uni – Irlande (Irlande – Irlande du Nord – Écosse) | 2014TC16RFCB047 | 282 761 998 | 240 347 696 |
| 46 | Royaume-Uni/Pays de Galles – Irlande | 2014TC16RFCB048 | 98 998 059 | 79 198 450 |
| 47 | Roumanie – Hongrie | 2014TC16RFCB049 | 231 861 763 | 189 138 672 |
| 48 | Estonie – Lettonie | 2014TC16RFCB050 | 46 728 715 | 38 933 803 |
| 49 | Italie – Autriche | 2014TC16RFCB052 | 98 380 352 | 82 238 866 |
| 50 | Slovénie – Hongrie | 2014TC16RFCB053 | 18 641 195 | 14 795 015 |
| 51 | Slovénie – Autriche | 2014TC16RFCB054 | 57 213 193 | 47 988 355 |
| 52 | Grèce – Chypre | 2014TC16RFCB055 | 64 560 486 | 54 876 411 |
| 53 | Allemagne – Danemark | 2014TC16RFCB056 | 121 306 000 | 89 634 975 |
| Ensemble des programmes de coopération transfrontalière intérieure | 8 597 431 283 | 6 346 119 962 | ||
| Programmes de coopération transfrontalière intérieure examinés | 3 508 658 525 | 2 708 476 109 | ||
Source: Cour des comptes européenne, sur la base des programmes de coopération de la période 2014‑2020.
Annexe II – Liste des programmes de coopération transnationale relevant d'Interreg V-B (période 2014-2020)
Pour la période de programmation 2014‑2020, Interreg V-B couvre 15 programmes de coopération d'une valeur totale de 2,1 milliards d'euros.
Ces programmes sont les suivants: «Mer du Nord», «Europe du Nord-Ouest», «Périphérie Nord et Arctique», «Mer Baltique», «Danube», «Espace atlantique», «Espace alpin», «Europe centrale», «Adriatique – Ionienne», «Balkans Méditerranée», «Europe du Sud-Ouest», «Méditerranée», «Caraïbes», «Amazonie» et «Océan Indien». La figure 10 montre les pays participant aux différents programmes de coopération.
Figure 10
Interreg V-B: les 15 programmes de coopération transnationale

Source: Commission européenne, https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/trans-national/
En plus du financement accordé au titre du volet B d'Interreg, le Conseil européen a approuvé quatre stratégies macrorégionales47:
- la stratégie de l'UE pour la région de la mer Baltique (2009);
- la stratégie de l'UE pour la région du Danube (2010);
- la stratégie de l'UE pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne (2014);
- la stratégie de l'UE pour la région alpine (2015).
Les quatre stratégies macrorégionales couvrent 19 États membres et 8 pays tiers, comme le montre la figure 11.
Figure 11
Interreg V-B: les quatre macrorégions transnationales

Source: Commission européenne, https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/cooperation/
Annexe III – Liste des objectifs thématiques (OT) de la composante d'Interreg V-A relative aux frontières intérieures (période 2014-2020)
Données au 31.12.2020
| OT | Intitulé | Montant total de la contribution de l'UE (en euros) |
Pourcentage |
| OT 1 | Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation | 872 076 167 | 13,7 % |
| OT 2 | Améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication (TIC), leur utilisation et leur qualité | 0 | 0 % |
| OT 3 | Renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) | 300 110 731 | 4,7 % |
| OT 4 | Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans tous les secteurs | 161 017 673 | 2,5 % |
| OT 5 | Promouvoir l'adaptation au changement climatique et la prévention et la gestion des risques | 279 299 676 | 4,4 % |
| OT 6 | Préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources | 1 478 698 158 | 23,2 % |
| OT 7 | Promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d'étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles | 593 085 445 | 9,3 % |
| OT 8 | Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre | 375 390 004 | 5,9 % |
| OT 9 | Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination | 216 707 527 | 3,4 % |
| OT 10 | Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie | 116 666 051 | 1,8 % |
| OT 11 | Renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et contribuer à l'efficacité de l'administration publique | 569 531 414 | 9,0 % |
| Plusieurs objectifs thématiques | 940 330 421 | 14,8 % | |
| Assistance technique | 319 783 299 | 5,0 % | |
| Aucun objectif thématique sélectionné | 123 423 396 | 1,9 % | |
| TOTAL | 6 346 119 962 | 100 % |
Source: Plateforme de données ouvertes dédiée aux Fonds ESI.
Annexe IV – Liste des 10 codes d'intervention les plus utilisés pour la composante d'Interreg V-A relative aux frontières intérieures (période 2014-2020)
Données au 31.12.2020
| Code | Description | Montant total de la contribution de l'UE (en euros) |
Pourcentage du total |
| 94 | Protection, développement et promotion des actifs culturels et patrimoniaux publics | 444 477 809 | 7 % |
| 87 | Mesures d'adaptation au changement climatique, prévention des risques liés au climat, comme l'érosion, les incendies, les tempêtes et les sécheresses, y compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et de gestion des catastrophes | 355 767 156 | 6 % |
| 34 | Autre réfection ou amélioration du réseau routier (autoroute, route nationale, régionale ou locale) | 310 554 407 | 5 % |
| 119 | Investissement dans les capacités institutionnelles et dans l'efficacité des administrations et des services publics au niveau national, régional et local dans la perspective de réformes, d'une meilleure réglementation et d'une bonne gouvernance | 303 568 412 | 5 % |
| 121 | Assistance technique: préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle | 295 745 460 | 5 % |
| 62 | Transfert de technologies et coopération entre universités et entreprises, principalement au profit des PME | 272 901 928 | 4 % |
| 85 | Protection et amélioration de la biodiversité, protection de la nature et infrastructure verte | 271 919 799 | 4 % |
| 91 | Développement et promotion du potentiel touristique des espaces naturels | 254 307 765 | 4 % |
| 60 | Activités de recherche et d'innovation dans les centres de recherche publics et les centres de compétence, y compris la mise en réseau | 223 236 862 | 4 % |
| 112 | Amélioration de l'accès à des services abordables, durables et de qualité, y compris les soins de santé et les services sociaux d'intérêt général | 205 317 652 | 3 % |
| Total pour les 10 codes d'intervention les plus utilisés | 2 937 797 250 | 46 % | |
| Total pour les autres codes | 3 408 322 712 | 54 % | |
| TOTAL | 6 346 119 962 | 100 % |
Source: Plateforme de données ouvertes dédiée aux Fonds ESI.
Annexe V – Liste des programmes de coopération examinés, avec indication du type d'examen effectué et des programmes principaux sélectionnés à des fins de comparaison
Le tableau ci-après dresse la liste des 23 programmes de coopération examinés et indique, pour chacun, son budget total, le montant de la contribution de l'UE et l'ampleur de l'examen effectué:
- lors des contrôles documentaires de base (dix programmes en tout), nous avons examiné: les difficultés transfrontalières; l'analyse SWOT et/ou l'analyse socioéconomique; la logique d'intervention; le ciblage du programme par rapport à celui des deux programmes principaux des régions limitrophes; les indicateurs; la méthode appliquée pour évaluer le caractère transfrontalier des projets; la procédure de coordination avec les autres Fonds ESI; les documents de prise de position et les documents d'orientation relatifs aux frontières, ainsi que le degré de préparation en vue de la période 2021‑2027;
- lors des contrôles documentaires approfondis (dix programmes en tout), nous avons également examiné: les appels à propositions, la procédure de sélection des projets, et l'approche suivie pour attirer les propositions de projets (approche «descendante» ou «ascendante»);
- lors des examens sur place (trois programmes en tout), nous avons en outre examiné un échantillon de quatre projets et leur caractère transfrontalier.
| Nom | Code commun d'identification | Budget total du programme (en euros) |
Montant total de la contribution de l'UE (en euros) |
Type d'examen effectué par la Cour | |
| 1 | Belgique – Allemagne – Pays-Bas (Euregio Meuse-Rhin) | 2014TC16RFCB001 | 140 434 645 | 96 000 250 | Contrôle documentaire de base |
| Programme principal n° 1 Belgique: PO Région flamande (régional) |
2014BE16RFOP002 | 435 508 941 | 175 592 099 | ||
| Programme principal n° 2 Allemagne: PO Rhénanie-du-Nord-Westphalie (régional) |
2014DE16RFOP009 | 2 423 462 022 | 1 211 731 011 | ||
| 2 | Autriche – Allemagne/Bavière | 2014TC16RFCB004 | 64 332 186 | 54 478 064 | Contrôle documentaire de base |
| Programme principal n° 1 Autriche: PO Investissements pour la croissance et l'emploi (national) |
2014AT16RFOP001 | 2 037 475 362 | 536 262 079 | ||
| Programme principal n° 2 Allemagne: PO FEDER 2014‑2020 Bavière (régional) |
2014DE16RFOP002 | 1 478 842 432 | 494 704 308 | ||
| 3 | Espagne – Portugal (POCTEP) | 2014TC16RFCB005 | 484 687 353 | 365 769 686 | Contrôle documentaire de base |
| Programme principal n° 1 Espagne: PO Andalousie 2014‑2020 (régional) |
2014ES16RFOP003 | 3 951 571 669 | 3 200 907 333 | ||
| Programme principal n° 2 Portugal: PO Nord 2014‑2020 (régional) |
2014PT16M2OP001 | 4 209 657 730 | 3 378 770 731 | ||
| 4 | Espagne – France – Andorre (POCTEFA) |
2014TC16RFCB006 | 288 964 102 | 189 341 397 | Contrôle documentaire de base |
| Programme principal n° 1 Espagne: Catalogne (régional) |
2014ES16RFOP011 | 1 671 234 350 | 835 617 175 | ||
| Programme principal n° 2 France: Languedoc-Roussillon (régional) |
2014FR16M0OP006 | 754 041 639 | 431 686 793 | ||
| 5 | Allemagne/Bavière – Tchéquie | 2014TC16RFCB009 | 121 617 825 | 103 375 149 | Contrôle documentaire approfondi |
| Programme principal n° 1 Allemagne: PO Bavière 2014‑2020 (régional) |
2014DE16RFOP002 | 1 478 842 432 | 494 704 308 | ||
| Programme principal n° 2 Tchéquie: Programme opérationnel régional intégré Croissance 2014‑2020 (national) |
2014CZ16RFOP002 | 5 575 445 155 | 4 763 230 350 | ||
| 6 | Autriche – Hongrie | 2014TC16RFCB010 | 95 870 327 | 78 847 880 | Contrôle documentaire approfondi |
| Programme principal n° 1 Autriche: PO Investissements pour la croissance et l'emploi (national) |
2014AT16RFOP001 | 2 037 475 362 | 536 262 079 | ||
| Programme principal n° 2 Hongrie: PO Développement économique et innovation 2014‑2020 (national) |
2014HU16M0OP001 | 8 813 195 514 | 7 733 969 530 | ||
| 7 | Pologne – Danemark – Allemagne – Lituanie – Suède (South Baltic) | 2014TC16RFCB013 | 100 614 276 | 82 978 784 | Contrôle documentaire approfondi |
| Programme principal n° 1 Pologne: PO régional Poméranie 2014‑2020 (régional) |
2014PL16M2OP011 | 2 193 896 122 | 1 864 811 698 | ||
| Programme principal n° 2 Lituanie: PO Investissements des Fonds structurels de l'UE pour 2014‑2020 (national) |
2014LT16MAOP001 | 7 887 798 523 | 6 709 396 130 | ||
| 8 | Finlande – Estonie – Lettonie – Suède (Central Baltic) | 2014TC16RFCB014 | 170 544 922 | 132 628 689 | Examen sur place |
| Programme principal n° 1 Finlande: Croissance durable et emploi pour la Finlande 2014‑2020 (national) |
2014FI16M2OP001 | 2 570 429 202 | 1 285 214 601 | ||
| Programme principal n° 2 Estonie: Investissement pour la croissance et l'emploi en Estonie 2014‑2020 (national) |
2014EE16M3OP001 | 4 891 748 878 | 3 499 202 664 | ||
| 9 | Slovaquie – Hongrie | 2014TC16RFCB015 | 183 304 695 | 155 808 987 | Contrôle documentaire de base |
| Programme principal n° 1 Slovaquie: PO régional intégré 2014‑2020 (national) |
2014SK16RFOP002 | 2 059 278 976 | 1 699 941 778 | ||
| Programme principal n° 2 Hongrie: PO Développement économique et innovation 2014‑2020 (national) |
2014HU16M0OP001 | 8 813 195 514 | 7 733 969 530 | ||
| 10 | Suède – Norvège | 2014TC16RFCB016 | 94 399 930 | 47 199 965 | Contrôle documentaire de base |
| Programme principal n° 1 Suède: PO Norrland central (régional) |
2014SE16RFOP007 | 289 910 518 | 144 955 259 | ||
| 11 | Allemagne/Saxe – Tchéquie | 2014TC16RFCB017 | 189 274 570 | 157 967 067 | Contrôle documentaire approfondi |
| Programme principal n° 1 Allemagne: PO Saxe 2014‑2020 (régional) |
2014DE16RFOP012 | 2 341 365 486 | 1 873 092 389 | ||
| Programme principal n° 2 Tchéquie: Programme opérationnel régional intégré Croissance 2014‑2020 (national) |
2014CZ16RFOP002 | 5 575 445 155 | 4 763 230 350 | ||
| 12 | Roumanie – Bulgarie | 2014TC16RFCB021 | 258 504 126 | 215 745 513 | Contrôle documentaire approfondi48 |
| Programme principal n° 1 Roumanie: PO régional roumain (national) |
2014RO16RFOP002 | 8 384 288 100 | 6 860 000 000 | ||
| Programme principal n° 2 Bulgarie: PO régional bulgare «Régions en croissance» (national) |
2014BG16RFOP001 | 1 543 182 113 | 1 311 704 793 | ||
| 13 | Allemagne – Autriche – Suisse – Liechtenstein (Alpenrhein – Bodensee – Hochrhein) | 2014TC16RFCB024 | 56 554 900 | 39 588 430 | Contrôle documentaire approfondi |
| Programme principal n° 1 Allemagne: Programme opérationnel régional Innovation et énergie Bade-Wurtemberg, période 2014‑2020 (régional) |
2014DE16RFOP001 | 493 170 076 | 246 585 038 | ||
| Programme principal n° 2 Autriche: PO FEDER 2014‑2020 Investissements pour la croissance et l'emploi en Autriche (national) |
2014AT16RFOP001 | 2 073 339 826 | 536 262 079 | ||
| 14 | Tchéquie – Pologne | 2014TC16RFCB025 | 266 143 190 | 226 221 710 | Examen sur place |
| Programme principal n° 1 Tchéquie: Programme opérationnel régional intégré 2014‑2020 (national) |
2014CZ16RFOP002 | 5 575 445 155 | 4 763 230 350 | ||
| Programme principal n° 2 Pologne: Programme opérationnel régional 2014‑2020 pour la Basse-Silésie (régional) |
2014PL16M2OP001 | 2 659 054 816 | 2 252 546 589 | ||
| 15 | Suède – Finlande – Norvège (Botnia – Atlantica) | 2014TC16RFCB028 | 61 284 055 | 36 334 420 | Contrôle documentaire de base |
| Programme principal n° 1 Suède: PO Norrland septentrional (régional) |
2014SE16RFOP008 | 421 646 628 | 210 823 314 | ||
| Programme principal n° 2 Finlande: Croissance durable et emploi 2014‑2020 (national) |
2014FI16M2OP001 | 2 570 429 202 | 1 285 214 601 | ||
| 16 | Slovaquie – Tchéquie | 2014TC16RFCB030 | 106 046 429 | 90 139 463 | Contrôle documentaire approfondi |
| Programme principal n° 1 Slovaquie: PO Infrastructures intégrées 2014‑2020 (national) |
2014SK16M1OP001 | 4 646 130 079 | 3 949 210 563 | ||
| Programme principal n° 2 Tchéquie: PO régional intégré 2014‑2020 (national) |
2014CZ16RFOP002 | 5 575 445 155 | 4 763 230 350 | ||
| 17 | Italie – Slovénie | 2014TC16RFCB036 | 92 588 182 | 77 929 954 | Contrôle documentaire approfondi |
| Programme principal n° 1 Italie: Programme opérationnel régional Frioul-Vénétie Julienne (régional) |
2014IT16RFOP009 | 230 779 184 | 115 389 592 | ||
| Programme principal n° 2 Slovénie: PO pour la mise en œuvre de la politique de cohésion de l'UE (national) |
2014SI16MAOP001 | 3 818 118 670 | 3 067 924 925 | ||
| 18 | Italie – Malte | 2014TC16RFCB037 | 51 708 438 | 43 952 171 | Contrôle documentaire approfondi |
| Programme principal n° 1 Italie: Programme opérationnel régional FEDER 2014‑2020 Sicile (régional) |
2014IT16RFOP016 | 4 273 038 791 | 3 418 431 018 | ||
| Programme principal n° 2 Malte: PO Malte – Encourager une économie concurrentielle et durable pour relever nos défis 2014‑2020 (national) |
2014MT16M1OP001 | 709 109 686 | 580 096 106 | ||
| 19 | Italie – Croatie | 2014TC16RFCB042 | 236 890 849 | 201 357 220 | Contrôle documentaire de base |
| Programme principal n° 1 Italie: PO régional Pouilles 2014‑2020 (régional) |
2014IT16M2OP002 | 7 120 958 992 | 3 560 479 496 | ||
| Programme principal n° 2 Croatie: PO Compétitivité et Cohésion 2014‑2020 (national) |
2014HR16M1OP001 | 8 036 770 938 | 6 831 255 232 | ||
| 20 | France – Belgique – Allemagne – Luxembourg (Grande Région) | 2014TC16RFCB045 | 234 606 265 | 139 802 646 | Examen sur place |
| Programme principal n° 1 France: PO FEDER/FSE 2014‑2020 Lorraine et Vosges (régional) |
2014FR16M0OP015 | 689 879 511 | 409 839 615 | ||
| Programme principal n° 2 Belgique: PO Wallonie-2020.EU (régional) |
2014BE16RFOP003 | 1 700 524 237 | 681 639 700 | ||
| 21 | Royaume-Uni/Pays de Galles – Irlande | 2014TC16RFCB048 | 98 998 059 | 79 198 450 | Contrôle documentaire approfondi |
| Programme principal n° 1 Royaume-Uni: FEDER Ouest du Pays de Galles et région des vallées (régional) |
2014UK16RFOP005 | 1 829 859 998 | 1 206 110 065 | ||
| Programme principal n° 2 Irlande: Programme opérationnel régional pour le Sud et l'Est (régional) |
2014IE16RFOP002 | 500 132 354 | 250 066 177 | ||
| 22 | Estonie – Lettonie | 2014TC16RFCB050 | 46 728 715 | 38 933 803 | Contrôle documentaire de base |
| Programme principal n° 1 Estonie: Programme opérationnel pour les Fonds de la politique de cohésion 2014‑2020 (national) |
2014EE16M3OP001 | 4 655 679 786 | 3 499 202 664 | ||
| Programme principal n° 2 Lettonie: Croissance et emploi 2014‑2020 (national) |
2014LV16MAOP001 | 5 192 801 940 | 4 418 233 214 | ||
| 23 | Grèce – Chypre | 2014TC16RFCB055 | 64 560 486 | 54 876 411 | Contrôle documentaire de base |
| Programme principal n° 1 Grèce: PO Crète (régional) |
2014GR16M2OP011 | 449 652 852 | 359 722 280 | ||
| Programme principal n° 2 Chypre: PO Compétitivité et développement durable (national) |
2014CY16M1OP001 | 699 726 575 | 594 767 585 |
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données relatives aux programmes de coopération et aux programmes principaux pour la période 2014‑2020.
Annexe VI – Réactions des autorités responsables des programmes aux recommandations n° 1, point a), et n° 2
Certaines de nos recommandations sont adressées aux autorités responsables des programmes, qui sont chargées de les mettre en œuvre. C'est pourquoi nous leur avons demandé de nous faire part de leurs réactions à cet égard. Les réponses que nous avons reçues, ainsi que les raisons pour lesquelles certaines autorités ont rejeté nos recommandations ou ne les ont acceptées qu'en partie, sont résumées ci-après.
Tableau 1 – Recommandation n° 1, point a): mieux cibler les programmes de coopération
| Réaction des autorités responsables des programmes | |
| Acceptée | 14 |
| Acceptée en partie | 5 |
| Rejetée | 4 |
|
Les autorités responsables des programmes qui ont rejeté cette recommandation ou l'ont acceptée en partie seulement arguent du fait que les programmes Interreg concernés sont déjà bien ciblés et suffisamment coordonnés avec les programmes principaux des régions limitrophes, car:
|
|
Tableau 2 – Recommandation n° 2: hiérarchiser les projets et leur accorder un soutien en fonction de leurs mérites au moyen d'un système de notation
| Réaction des autorités responsables des programmes | |
| Acceptée | 14 |
| Acceptée en partie | 6 |
| Rejetée | 3 |
| Les autorités responsables des programmes qui ont rejeté cette recommandation ou l'ont acceptée en partie seulement arguent du fait qu'elle a déjà été mise en œuvre. | |
Sigles, acronymes et formes abrégées
CRII: initiative d'investissement en réaction au coronavirus (Coronavirus Response Investment Initiative)
CRII+: initiative d'investissement+ en réaction au coronavirus (Coronavirus Response Investment Initiative Plus)
CTE: coopération territoriale européenne
DG REGIO: direction générale de la politique régionale et urbaine
FEDER: Fonds européen de développement régional
Fonds ESI: Fonds structurels et d'investissement européens
FSE: Fonds social européen
Interreg: acronyme généralement utilisé pour désigner le programme de coopération interrégionale de l'UE
NUTS: nomenclature des unités territoriales statistiques
OT: objectif thématique
PIB: produit intérieur brut
SMART: spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et daté (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely)
SWOT: atouts, faiblesses, opportunités et menaces (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)
Glossaire
Autorité de gestion: autorité (publique ou privée) nationale, régionale ou locale, désignée par un État membre pour gérer un programme financé par l'UE.
Axe prioritaire: objectif clé d'un programme opérationnel, consistant en une ou plusieurs priorités d'investissement.
Comité de suivi: organisme composé de représentants des autorités des États membres et de la Commission (celle-ci ayant le rôle d'observateur), qui supervise la mise en œuvre d'un programme opérationnel.
Coopération territoriale européenne: objectif de coopération interrégionale, transfrontalière et transnationale, servant de cadre aux échanges en matière de politiques et à la mise en œuvre d'actions communes.
Fonds européen de développement régional: Fonds de l'UE destiné à renforcer la cohésion économique et sociale au sein de l'Union en finançant des investissements qui réduisent les déséquilibres entre les régions.
Fonds structurels et d'investissement européens: les cinq principaux Fonds de l'UE destinés à soutenir conjointement le développement économique dans l'ensemble de l'Union: le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.
Initiative d'investissement en réaction au coronavirus: ensemble de mesures visant à autoriser une utilisation souple des Fonds structurels et d'investissement européens en réaction à la pandémie de COVID-19.
Logique d'intervention: liens entre les objectifs d'une proposition, les intrants et activités prévus ainsi que les résultats et l'impact escomptés.
Objectif thématique: résultat global escompté d'une priorité d'investissement, décomposé en objectifs spécifiques à des fins de mise en œuvre.
Priorité d'investissement: subdivision d'un axe prioritaire.
Secrétariat conjoint: service qui assiste l'autorité de gestion et le comité de suivi d'un programme de coopération territoriale européenne, informe les bénéficiaires des possibilités de financement éventuelles et soutient la mise en œuvre des projets.
Équipe d'audit
Les rapports spéciaux de la Cour présentent les résultats de ses audits relatifs aux politiques et programmes de l'UE ou à des questions de gestion concernant des domaines budgétaires spécifiques. La Cour sélectionne et conçoit ces activités d'audit de manière à maximiser leur impact en tenant compte des risques pour la performance ou la conformité, du niveau des recettes ou des dépenses concernées, des évolutions escomptées ainsi que de l'importance politique et de l'intérêt du public.
L'audit de la performance objet du présent rapport a été réalisé par la Chambre II (Investissements en faveur de la cohésion, de la croissance et de l'inclusion), présidée par Mme Iliana Ivanova, Membre de la Cour. L'audit a été effectué sous la responsabilité de M. Ladislav Balko, Membre de la Cour, assisté de: M. Branislav Urbanič, chef de cabinet, et Mme Zuzana Franková, attachée de cabinet; M. Niels-Erik Brokopp, manager principal; Mme Chrysoula Latopoulou, cheffe de mission; M. Dennis Wernerus, chef de mission adjoint; Mmes Katarzyna Solarek, Ana Popescu, Angelika Zych et Aino Nyholm, ainsi que MM. Thierry Lavigne, Aleksandar Latinov, Nils Odins et Francisco Carretero Llorente, auditeurs. L'assistance linguistique a été fournie par M. James Verity.

Notes
1 Article 174 du TFUE.
2 Considérant 4 du règlement (UE) n° 1299/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (règlement CTE) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).
3 Article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1301/2013 du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 (règlement FEDER) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 293).
4 Considérant 5 du règlement CTE.
5 Communication de la Commission intitulée «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l'Union européenne», COM(2017) 534 final du 20 septembre 2017, p. 7.
6 Collecting solid evidence to assess the needs to be addressed by Interreg cross-border cooperation programmes, SWECO, t33, Politecnico di Milano et Nordregio pour la DG REGIO, novembre 2016, p. 64-91.
Easing legal and administrative obstacles in EU border regions, Metis GmbH, Panteia BV, AEIDL – Association européenne pour l'information sur le développement local, CASE – Center for Social and Economic Research pour la DG REGIO, mars 2017.
Quantification of the effects of legal and administrative border obstacles in land border regions, Politecnico di Milano pour la DG REGIO, mai 2017.
7 Article 4, paragraphe 1, du règlement CTE.
8 Article 2 du règlement CTE.
9 Article 12, paragraphe 2, du règlement CTE.
10 L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1059/2003 du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 3) prévoit le découpage du territoire économique des États membres en régions de taille plus petite afin de permettre la collecte, l'établissement et la diffusion de statistiques régionales. En vertu de cet article, les régions des États membres sont classées dans trois catégories déterminées par des seuils démographiques. Les régions de niveau 1 (NUTS 1), qui comptent 3 à 7 millions d'habitants, sont subdivisées en régions de niveau 2 (NUTS 2), qui comptent 800 000 à 3 millions d'habitants. Celles-ci sont enfin subdivisées en régions de niveau 3 (NUTS 3), peuplées de 150 000 à 800 000 habitants.
11 Article 3, paragraphe 2, du règlement CTE.
12 Article 104, paragraphe 7, du texte du compromis en vue d'un accord sur le nouveau règlement portant dispositions communes, 25 février 2021.
13 Article 3 de la confirmation du texte de compromis final en vue d'un accord sur le règlement portant dispositions particulières relatives à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (nouveau règlement CTE), 11 décembre 2020.
14 Article 9, paragraphe 2, du texte de compromis en vue d'un accord sur le nouveau règlement CTE.
15 Section II, point 8, de la communication C(90) 1562/3 aux États membres fixant les orientations pour des programmes opérationnels que les États membres sont invités à établir dans le cadre d'une initiative communautaire concernant les zones frontalières (Interreg) (JO C 215 du 30.8.1990, p. 4).
16 Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 38).
17 Article 3, paragraphe 1, du règlement CTE.
18 Article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 10).
19 Article 20, paragraphe 2, point b), du règlement CTE.
20 Document COM(2017) 534 final, p. 4.
21 Considérant 33 et article 23, paragraphe 2, du règlement CTE.
22 Considérant 88 du règlement portant dispositions communes.
23 Article 9 du règlement portant dispositions communes.
24 Article 6, paragraphe 1, du règlement CTE.
25 Article 8, paragraphe 1, du règlement CTE.
26 Article 96, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) et b), du règlement portant dispositions communes, et article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement CTE.
27 Article 14 du règlement CTE.
28 Article 16 et annexe du règlement CTE.
29 European territorial Cooperation, Work Package 11, ‘Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007‑2013, focusing on the ERDF and the Cohesion Fund', ADE, à la demande de la DG REGIO, juillet 2016.
30 Article 15 du texte de compromis en vue d'un accord sur le nouveau règlement CTE.
31 Règlement (UE) 2020/460 du 30 mars 2020 modifiant les règlements (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013 et (UE) n° 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d'autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d'investissement en réaction au coronavirus) (règlement CRII) (JO L 99 du 31.3.2020, p. 5).
32 Règlement (UE) 2020/558 du 23 avril 2020 modifiant les règlements (UE) n° 1301/2013 et (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à offrir une flexibilité exceptionnelle pour l'utilisation des Fonds structurels et d'investissement européens en réaction à la propagation de la COVID‐19 (règlement CRII+) (JO L 130 du 24.4.2020, p. 1).
33 Proposition de règlement relatif à la création d'un mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier, COM(2018) 373 final du 29 mai 2018.
34 Article 8, paragraphe 2, point a), du règlement CTE.
35 Considérant 19 du règlement CTE.
36 Annexe XI du règlement portant dispositions communes, priorité d'investissement 9a.
37 Considérant 88 du règlement portant dispositions communes.
38 Article 8, paragraphe 5, point a), du règlement CTE.
39 Article 12, paragraphe 2, du règlement CTE.
40 Article 12, paragraphe 2, du règlement CTE.
41 Article 8, paragraphe 2, point b), du règlement CTE.
42 Article 8, paragraphe 2, point b), du règlement CTE.
43 Annexe du règlement CTE.
44 Article 16, paragraphe 3, du règlement CTE.
45 Rapport spécial n° 2/2017 de la Cour des comptes européenne intitulé «Négociation, par la Commission, des accords de partenariat et des programmes relevant de la cohésion pour la période 2014‑2020: les dépenses ciblent davantage les priorités d'Europe 2020, mais les dispositifs destinés à mesurer la performance sont de plus en plus complexes», recommandation n° 1, p. 79.
46 Rapport spécial n° 17/2018 de la Cour des comptes européenne intitulé «Les actions engagées par la Commission et les États membres dans les dernières années des programmes de la période 2007‑2013 visaient bien à améliorer l'absorption, mais n'étaient pas suffisamment centrées sur les résultats», point 84, p. 48.
47 Rapport de la Commission sur la mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l'Union, COM(2019) 21 final du 29 janvier 2019.
48 Pour ce programme de coopération, nous avions initialement prévu un examen sur place mais avons été contraints, en raison des restrictions de déplacement liées à la pandémie de COVID-19, de changer de type d'examen et de réaliser un contrôle documentaire approfondi.
Calendrier
| Étape | Date |
| Adoption du plan d'enquête / Début de l'audit | 25.9.2019 |
| Envoi officiel du projet de rapport à la Commission (ou à toute autre entité auditée) |
26.3.2021 |
| Adoption du rapport définitif après la procédure contradictoire | 19.5.2021 |
| Réception des réponses officielles de la Commission (ou de toute autre entité auditée) dans toutes les langues | 7.6.2021 |
Contact
COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tél. +352 4398-1
Contact: eca.europa.eu/fr/Pages/ContactForm.aspx
Site internet: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
De nombreuses autres informations sur l’Union européenne sont disponibles sur l’internet via le serveur Europa (http://europa.eu).
Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2021
| ISBN 978-92-847-6410-5 | ISSN 1977-5695 | doi:10.2865/794586 | QJ-AB-21-016-FR-N | |
| HTML | ISBN 978-92-847-6442-6 | ISSN 1977-5695 | doi:10.2865/330442 | QJ-AB-21-016-FR-Q |
DROITS D'AUTEUR
© Union européenne, 2021.
La politique de réutilisation de la Cour des comptes européenne est régie par la décision n° 6-2019 de la Cour des comptes européenne sur la politique d'ouverture des données et la réutilisation des documents.
Sauf indication contraire (par exemple dans une déclaration distincte concernant les droits d'auteur), le contenu des documents de la Cour, qui appartient à l'UE, fait l'objet d'une licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Cela signifie que vous pouvez en réutiliser le contenu à condition de mentionner la source et d'indiquer les modifications que vous avez apportées. Le réutilisateur a l'obligation de ne pas altérer le sens ou le message initial des documents. La Cour des comptes européenne ne répond pas des conséquences de la réutilisation.
Vous êtes tenu(e) d'acquérir des droits supplémentaires si un contenu spécifique représente des personnes physiques identifiables, comme par exemple sur des photos des agents de la Cour, ou contient des travaux de tiers. Lorsque l'autorisation a été obtenue, elle annule et remplace l'autorisation générale susmentionnée et doit clairement indiquer toute restriction d'utilisation.
Pour utiliser ou reproduire des contenus qui n'appartiennent pas à l'UE, vous pouvez être amené(e) à demander l'autorisation directement aux titulaires des droits d'auteur.
Figure 5: icônes réalisées par Pixel perfect, disponibles sur le site https://flaticon.com.
Les logiciels ou documents couverts par les droits de propriété industrielle tels que les brevets, les marques, les modèles déposés, les logos et les noms sont exclus de la politique de réutilisation de la Cour des comptes européenne et aucune licence ne vous est accordée à leur égard.
La famille de sites internet institutionnels de l'Union européenne relevant du domaine europa.eu fournit des liens vers des sites tiers. Étant donné que la Cour n'a aucun contrôle sur leur contenu, vous êtes invité(e) à prendre connaissance de leurs politiques respectives en matière de droits d'auteur et de protection des données.
Utilisation du logo de la Cour des comptes européenne
Le logo de la Cour des comptes européenne ne peut être utilisé sans l'accord préalable de celle-ci.
COMMENT PRENDRE CONTACT AVEC L'UNION EUROPÉENNE?
En personne
Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres d’information Europe Direct sont à votre disposition. Pour connaître l’adresse du centre le plus proche, visitez la page suivante: https://europa.eu/european-union/contact_fr
Par téléphone ou courrier électronique
Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne. Vous pouvez prendre contact avec ce service:
- par téléphone:
- via un numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certains opérateurs facturent cependant ces appels),
- au numéro de standard suivant: +32 22999696;
- par courrier électronique via la page https://europa.eu/european-union/contact_fr
COMMENT TROUVER DES INFORMATIONS SUR L'UNION EUROPÉENNE?
En ligne
Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les langues officielles de l’UE, sur le site internet Europa à l’adresse https://europa.eu/european-union/index_fr
Publications de l’Union européenne
Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes à l’adresse https://op.europa.eu/fr/publications. Vous pouvez obtenir plusieurs exemplaires de publications gratuites en contactant Europe Direct ou votre centre d’information local (https://europa.eu/european-union/contact_fr).
Droit de l’Union européenne et documents connexes
Pour accéder aux informations juridiques de l’Union, y compris à l’ensemble du droit de l’UE depuis 1952 dans toutes les versions linguistiques officielles, consultez EUR-Lex à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu
Données ouvertes de l’Union européenne
Le portail des données ouvertes de l’Union européenne (http://data.europa.eu/euodp/fr) donne accès à des ensembles de données provenant de l’UE. Les données peuvent être téléchargées et réutilisées gratuitement, à des fins commerciales ou non commerciales.
 Rapport spécial
Rapport spécial