12 leçons sur l’Europe





par Pascal Fontaine
Quel est le but de l’Union européenne? Pourquoi et comment a-t-elle été créée? Comment fonctionne-t-elle? Qu’a-t-elle déjà accompli pour ses citoyens et quels sont les nouveaux défis auxquels elle est confrontée aujourd’hui?
À l’heure de la mondialisation, l’Union européenne peut-elle rivaliser avec les autres grandes économies tout en préservant ses valeurs sociales? Comment gérer l’immigration? Quel rôle l’Europe jouera-t-elle sur la scène internationale dans les prochaines années? Quelles seront les frontières ultimes de l’Union? Quel est l’avenir de l’euro?
Voici quelques-unes des questions que Pascal Fontaine — expert en affaires européennes — pose dans cette édition 2017 de sa brochure 12 leçons sur l’Europe, destinée au grand public. Pascal Fontaine est un ancien collaborateur de Jean Monnet et professeur à l’Institut d’études politiques de Paris.
Les avis exprimés n’engagent que l’auteur et ne sauraient être considérés comme constituant une prise de position officielle de la Commission européenne.

Avant qu’elle ne se concrétise en un véritable projet politique, l’idée européenne resta limitée au cercle des philosophes et des visionnaires. La perspective des «États-Unis d’Europe», selon la formule de Victor Hugo, correspondait à un idéal humaniste et pacifique. Les tragiques conflits qui brisèrent le continent durant la première moitié du XXe siècle lui ont apporté un brutal démenti.
Il a fallu attendre les réflexions issues des mouvements de résistance au totalitarisme, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour voir émerger un nouvel espoir: dépasser les antagonismes nationaux, créer les conditions d’une paix durable. Une poignée d’hommes d’État courageux, tels Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi, Winston Churchill, se sont engagés entre 1945 et 1950 pour convaincre leurs peuples d’entrer dans une ère nouvelle: celle d’une organisation structurée de l’Europe de l’Ouest fondée sur des intérêts communs, garantie par des traités assurant l’égalité de chaque État et le respect du droit.
Robert Schuman (ministre des affaires étrangères du gouvernement français) a repris une idée de Jean Monnet et, le 9 mai 1950, a proposé la création d’une Communauté européenne du charbon et de l’acier. Placer sous une autorité commune, la Haute Autorité, la production du charbon et de l’acier de pays autrefois ennemis avait une grande portée symbolique. Les matériaux de la guerre se transformaient en instruments de réconciliation et de paix.
La paix est aujourd’hui assurée entre les pays de l’Union européenne dont les populations vivent dans des démocraties régies par le droit et le respect des libertés fondamentales. Les pays de l’ex-Yougoslavie, qui se sont affrontés au début des années 90 dans de terribles conflits, ont adhéré à l’Union ou sont en train de s’y préparer.
Néanmoins, la paix n’est jamais un bien définitivement acquis. La montée des populismes, des extrémismes et des nationalismes s’attaque à l’Europe démocratique et à la légitimité même de l’intégration européenne depuis les années de crise économique et sociale qui accompagnent le début du XXIe siècle. Dans un certain nombre de pays de l’Union, on assiste à la tentation d’un repli identitaire qui s’oppose à l’intégration européenne et marque la défiance d’une partie de l’opinion et des électeurs à l’égard des institutions, aussi bien nationales qu’européennes. Le retour progressif de la croissance, qui devrait se traduire par la diminution du chômage, sera, s’il se confirme durablement et profite à l’ensemble des pays de l’Union, de nature à apaiser ces tensions. Il reste aux gouvernements et aux institutions de l’Union à agir conjointement et efficacement pour favoriser le retour de la confiance des opinions publiques dans le projet européen en lui donnant un nouvel élan et en privilégiant l’action commune aux perspectives purement nationales.
L’Union européenne a favorisé la réunification allemande après la chute du mur de Berlin en 1989. Tout naturellement, après la décomposition de l’Empire soviétique en 1991, les pays d’Europe centrale et orientale, contraints pendant des décennies de vivre derrière le «rideau de fer», ont à leur tour retrouvé la maîtrise de leur destin. Nombreux sont ceux qui ont alors fait le choix de reprendre leur place au sein de la famille démocratique européenne. Huit d’entre eux ont ainsi rejoint l’Union en 2004, suivis par deux autres en 2007, puis par la Croatie en 2013. Deux pays méditerranéens, Chypre et Malte, ont également contribué à la configuration de l’Europe des 28.
Ce processus d’élargissement européen se poursuit aujourd’hui encore. Sept pays se trouvent actuellement à des stades différents de préparation à une éventuelle future adhésion. Pourtant, la situation économique et politique rend improbable la perspective de nouvelles adhésions au cours des prochaines années.
Dans le même temps, un État membre, le Royaume-Uni, a organisé, le 23 juin 2016, un référendum, à l’issue duquel une majorité d’électeurs a exprimé le souhait que le pays quitte l’Union.
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié au Conseil européen son intention de quitter l’Union européenne, conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Les négociations avec le Royaume-Uni au titre de l’article 50 ont débuté le 19 juin 2017.
L’Europe du XXIe siècle reste confrontée à d’importants défis en matière de sécurité.
Au sud du continent monte la menace d’un fanatisme religieux qui se traduit par l’extension d’un terrorisme aveugle et meurtrier. Les attentats qui se sont succédés sur le sol européen au nom du soi-disant «État islamique», Daech, ont conduit les États membres à intensifier leurs échanges d’informations afin de lutter ensemble contre cette nouvelle forme de guerre qui nie l’essence même de la civilisation européenne.
À l’est, la Russie met en œuvre une stratégie de rétablissement de sa puissance militaire qui risque de remettre en cause l’ordre issu de la fin de la guerre froide. L’annexion de la Crimée et la guerre dans l’est de l’Ukraine ont suscité des demandes de solidarité vis-à-vis de l’Ukraine, surtout dans les États membres qui ont vécu les conséquences de la chute de l’ancien Empire soviétique.
Sécurité intérieure et sécurité extérieure sont les deux faces de la même médaille: la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée impose une coopération étroite entre les services de police des États membres.
Face aux déferlements tragiques sur les côtes méditerranéennes, principalement en Italie et en Grèce, de réfugiés fuyant la guerre en Syrie, les dictatures et la famine, l’Union est confrontée à un immense défi de solidarité. La mise en place d’une politique commune d’asile et d’immigration plus efficace s’est inscrite dramatiquement à son agenda au printemps 2015.
La constitution d’un «espace de liberté, de sécurité et de justice» au sein de l’Union, où chaque citoyen est protégé par la loi et a le même accès à la justice, ouvre un nouveau chantier qui exige une coordination accrue des actions des gouvernements. Des organes tels qu’Europol (l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs) ou Eurojust (qui promeut la coordination entre les procureurs, les juges et les officiers de police des États membres) sont également appelés à renforcer leur rôle et leurs moyens d’intervention.
L’Europe s’est construite sur la base d’objectifs politiques, qu’elle poursuit à travers une coopération économique.
Pour assurer la croissance et faire face à la concurrence mondiale, au sein de laquelle les autres continents montent en puissance, les pays européens doivent continuer à s’unir. Pris isolément, aucun de nos États n’est en mesure de faire suffisamment le poids pour défendre ses intérêts dans le commerce mondial. De même, les entreprises européennes ont besoin d’un espace plus vaste que le marché national pour bénéficier des économies d’échelle et trouver de nouveaux clients, ce que leur offre le marché unique européen. Le vaste marché continental de plus de 510 millions de consommateurs doit être profitable au plus grand nombre d’acteurs économiques et sociaux. C’est pourquoi l’Union européenne s’emploie à faire disparaître les obstacles aux échanges et les rigidités administratives qui entravent leur action.
La solidarité est le corollaire nécessaire à ce grand espace de libre concurrence. Elle s’illustre de façon concrète pour les citoyens: quand ceux-ci sont victimes d’inondations ou d’autres catastrophes naturelles, le budget de l’Union dégage des crédits pour venir en aide aux sinistrés. Les Fonds structurels gérés par la Commission européenne agissent en complément et en incitation aux interventions des États et des régions pour réduire les écarts de développement. L’Union, à travers son budget et les crédits de la Banque européenne d’investissement, favorise par exemple l’extension des infrastructures en matière d’énergie et de transport (autoroutes, trains à grande vitesse) qui ont pour effet de désenclaver les régions périphériques et de stimuler les échanges transeuropéens.
Face à la crise financière qui a ébranlé les économies européennes à l’automne 2008, entraînant une forte récession, les gouvernements et les institutions de l’Union ont su se mobiliser et réagir avec l’urgence nécessaire. L’Union a en effet décidé de consolider la situation financière des établissements bancaires en leur offrant des garanties, et a ainsi évité l’extension de la crise. Elle a également soutenu financièrement les pays les plus touchés. Les programmes d’assistance financière au profit de l’Irlande, du Portugal, de l’Espagne et de Chypre ont été suffisamment efficaces pour que ces pays, après des efforts nationaux souvent douloureux pour les populations, aient été en mesure de s’en acquitter, pour la plupart dès 2014. La Grèce s’est engagée, à la suite des négociations parfois tendues de l’été 2015, dans les réformes structurelles indispensables au rétablissement de ses équilibres financiers.
Depuis 2015, le plan d’investissement de l’Union soutient des investissements privés par l’intermédiaire de garanties financières et de la réforme de certaines règles dans ce domaine.
En dépit de ces aléas particuliers, la monnaie commune s’est révélée être un véritable bouclier contre les risques de dévaluation et de spéculation.
Le défi majeur des pays européens dans les décennies à venir consiste ainsi à conjuguer leurs forces pour s’adapter aux gigantesques bouleversements de l’économie mondiale et trouver ensemble une sortie de crise durable, qui permette le retour à une croissance soutenue, créatrice d’emplois, notamment dans les domaines de l’économie numérique et des technologies vertes.

© European Union
La solidarité économique et sociale est un des objectifs fondamentaux de l’Union européenne et de la Commission présidée par Jean-Claude Juncker.
Les sociétés postindustrielles européennes deviennent de plus en plus complexes. Les citoyens ont connu une élévation continue de leur niveau de vie, mais des écarts importants subsistent et peuvent même s’accroître sous les effets de la crise économique, des restructurations industrielles, du vieillissement de la population et des dérapages des finances publiques. C’est pour cela qu’il est important que les pays membres de l’Union travaillent ensemble pour résoudre leurs problèmes.
Toutefois, travailler ensemble ne signifie pas gommer l’identité culturelle et linguistique distincte des pays de l’Union. Au contraire, de nombreuses activités de l’Union contribuent à créer une nouvelle croissance économique fondée sur les particularités régionales et la grande diversité des traditions et des cultures. Les spécialités alimentaires régionales, le tourisme et les arts en sont de bons exemples. Les technologies numériques feront de la diversité culturelle un élément encore plus fort, puisqu’il est techniquement plus facile de partager des produits culturels locaux.

© Highwaystarz/Adobe Stock
«Unie dans la diversité»: l’action commune a plus de poids que l’action individuelle.
On se rend compte, après soixante-six années d’intégration européenne, que l’ensemble de l’Union pèse beaucoup plus sur les plans économique, social, technologique, commercial mais aussi politique que la simple addition des États membres. Il y a bien une valeur ajoutée européenne, une prime à l’action commune.
D’autres puissances mondiales, telles que la Chine et les États-Unis, cherchent à influencer les règles économiques mondiales. Les États membres de l’Union ont plus que jamais intérêt à unir leurs forces pour conserver ensemble «la masse critique» et éviter la marginalisation. Dans la pratique, cela passe par exemple par le rôle que tient l’Union dans les négociations mondiales sur les règles commerciales. Les pays de l’Union ont aussi adopté de nombreux principes et standards liés à la vie quotidienne, qui serviront de modèle à beaucoup d’autres parties du monde. Il s’agit notamment des normes de santé et de sécurité, de la promotion des sources d’énergie renouvelables, du principe de précaution dans la sécurité alimentaire, des aspects éthiques des nouvelles technologies, et de bien d’autres choses encore. L’Union reste aussi à la pointe des efforts entrepris au niveau mondial pour lutter contre le réchauffement climatique.
Les valeurs européennes sont également visibles dans le monde entier sous la forme de la coopération au développement et de l’aide humanitaire gérées par l’Union européenne.
Le vieil adage «L’union fait la force» garde aujourd’hui tout son sens pour les Européens.
L’Union veut promouvoir une vision humaniste et progressiste de l’être humain, placé au cœur d’une révolution de la planète, qu’il lui appartient de maîtriser et non de subir. Les seules forces du marché ou le recours à l’action unilatérale de pays agissant séparément ne peuvent garantir la satisfaction des besoins des peuples.
L’Union est donc porteuse d’un message et d’un modèle auxquels ses citoyens adhèrent en grande majorité. Les droits de l’homme, la solidarité sociale, la liberté d’entreprendre, le partage équitable des fruits de la croissance, la lutte contre le chômage, le droit à un environnement protégé, le respect des diversités culturelles, linguistiques et religieuses, l’harmonieuse synthèse entre la tradition et le progrès constituent pour les Européens un véritable patrimoine de valeurs.
La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été proclamée à Nice, en décembre 2000. Cette charte est juridiquement contraignante et énumère tous les droits dans lesquels tous les États membres et les citoyens se reconnaissent aujourd’hui. Ce patrimoine rassemble les Européens quand ils se comparent au reste du monde. Par exemple, la peine de mort est abolie dans tous les pays de l’Union.


© European Union
Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre français des affaires étrangères, suggère les idées qui menèrent à la réalisation de l’Union européenne. Tous les 9 mai, on fête la Journée de l’Europe.
La chute du mur de Berlin, suivie de la réunification allemande en octobre 1990, et la démocratisation des pays d’Europe centrale et orientale, libérés de la tutelle de l’Union soviétique, elle-même dissoute en décembre 1991, transforment profondément la structure politique du continent.
Les États membres négocient un nouveau traité, adopté par les chefs d’État ou de gouvernement à Maastricht, en décembre 1991. En ajoutant au système communautaire un système de coopération intergouvernementale dans certains domaines, notamment la politique étrangère ainsi que la justice et les affaires intérieures, le traité de Maastricht crée l’Union européenne et entre en vigueur le 1er novembre 1993.
Désormais, l’Union, qui compte quinze membres depuis l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède en 1995, doit faire face aux défis croissants de la mondialisation. L’accélération des progrès technologiques et l’utilisation toujours grandissante de l’internet participent à la modernisation des économies. Mais les profondes mutations que subit le tissu économique entraînent également des déchirures sociales et des chocs culturels.
Dans le même temps, l’Union achève sa marche vers le projet le plus ambitieux qu’elle puisse offrir aux citoyens: le remplacement de leur monnaie nationale par l’euro. Le 1er janvier 2002, la monnaie européenne circule dans les douze pays de la zone euro et prend le statut de grande monnaie de paiement et de réserve à côté du dollar.
À peine constituée, l’Europe des Quinze entame la marche vers un nouvel élargissement d’une ampleur sans précédent. Les anciennes «démocraties populaires» du bloc soviétique (la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie), les trois États baltes issus de la décomposition de l’Union soviétique (l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie), l’une des Républiques de l’ex-Yougoslavie (la Slovénie) et deux pays méditerranéens (Chypre et Malte) frappent à la porte de l’Union au milieu des années 90.
Le désir de stabilité du continent et l’aspiration à étendre le bénéfice de l’unification européenne aux jeunes démocraties favorisent leur démarche. Les négociations d’adhésion sont ouvertes à Luxembourg en décembre 1997. L’Europe des Vingt-cinq devient une réalité le 1er mai 2004, celle des Vingt-sept en 2007 avec l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie et celle des Vingt-huit en 2013 avec l’adhésion de la Croatie.
Alors que les défis du XXIe siècle se multiplient et se complexifient, décider dans une Union comprenant autant de pays devient très difficile. Il est alors urgent de réformer son édifice institutionnel et de le simplifier. C’est dans cette optique que les États membres signent en juin 2004 le projet de Constitution pour l’Europe, qui doit se substituer à tous les traités préexistants.
Mais, rejeté par deux référendums nationaux, en France et aux Pays-Bas, ce projet est remplacé par le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 et entré en vigueur le 1er décembre 2009. Celui-ci ne se substitue pas aux autres traités, mais il les modifie amplement en y insérant la plupart des changements proposés dans la Constitution. Par exemple, l’Union dispose désormais d’un président permanent du Conseil européen et d’un haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

© Robert Maass/Corbis
Avec la chute du mur de Berlin en 1989, les anciennes lignes de fracture sur le continent européen disparaissent progressivement.
Les élections européennes de mai 2014 marquent un tournant dans la pratique institutionnelle de l’Union: conformément au traité de Lisbonne, le Conseil européen nomme au poste de président de la Commission le candidat désigné par le parti politique européen ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, en l’occurrence Jean-Claude Juncker, soutenu par le Parti populaire européen. Celui-ci est investi par une large majorité proeuropéenne, incluant le Groupe socialiste et démocrate et le Groupe libéral.
Cependant, ces huitièmes élections marquent également le renforcement d’un courant eurosceptique regroupant une centaine de députés. Ceux-ci manifestent lors de la plupart des votes une opposition frontale à la ligne politique des majorités européennes et leur scepticisme vis-à-vis de l’immigration.
Une crise économique et financière mondiale éclate en 2008. Cela conduit à la mise en place de nouveaux mécanismes communautaires pour assurer la stabilité des banques, réduire la dette publique et coordonner les politiques économiques des États membres, notamment dans la zone euro. Au cours de l’année 2016, tout porte à croire que, dans la plupart des pays de l’Union, les efforts entrepris sur le plan des réformes structurelles et des améliorations dans les comptes publics commencent à porter leurs fruits, sous la forme d’une nouvelle croissance économique.
La gouvernance de la zone euro est renforcée, sous le contrôle de la Commission et du Conseil de ministres, qui disposent de nouveaux instruments législatifs pour appliquer les accords conclus par les pays de l’Union en vue de garder des finances publiques saines. La Banque centrale européenne augmente la liquidité monétaire et maintient des taux d’intérêt très bas. L’Union encourage de nouveaux investissements à travers son nouveau fonds d’investissement stratégique, notamment dans le cadre des partenariats public-privé.

La construction européenne s’est toujours présentée comme un processus politique et économique ouvert à tous les pays européens disposés à adhérer aux traités constitutifs et à reprendre l’acquis communautaire. Le traité de Lisbonne stipule, à son article 49, que tout État européen qui respecte les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’état de droit peut poser sa candidature.
En 1993, face à la demande des anciens États communistes qui souhaitaient faire partie de l’Union, le Conseil européen a précisé trois critères à remplir pour adhérer à l’Union européenne. Au moment de son adhésion, un pays doit disposer:
Les négociations d’adhésion ont lieu entre chaque pays candidat et la Commission européenne, qui représente l’Union européenne. La décision de faire entrer un nouvel État dans l’Union doit être prise à l’unanimité par les États membres réunis au sein du Conseil, après avis de la Commission. Le Parlement européen doit donner son avis conforme, à la majorité absolue des membres qui le composent. Tous les traités d’adhésion doivent être ensuite ratifiés par les États membres et l’État candidat selon leurs procédures constitutionnelles respectives.
Durant les années de négociations, les pays candidats se voient normalement offrir par l’Union une aide financière de «préadhésion» qui facilite leur rattrapage économique. La plupart d’entre eux bénéficient d’un accord de stabilisation et d’association qui implique directement l’Union dans le suivi des restructurations économiques et administratives que doivent nécessairement adopter les pays candidats pour rejoindre les critères européens.
Le Conseil européen, réuni en décembre 2002 à Copenhague, a fait franchir au processus d’unification européenne l’une des étapes les plus importantes de toute son histoire. En décidant de faire adhérer douze nouveaux pays, les Quinze n’ont pas seulement élargi la surface géographique ni accru le nombre de citoyens de l’Union européenne, mais ils ont mis fin à la coupure brutale du continent qui l’avait divisé en deux depuis 1945. Des pays européens qui, pendant des décennies, avaient été privés de liberté démocratique ont finalement pu rejoindre la famille démocratique des nations européennes. Sont ainsi devenues membres de l’Union en 2004 la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, aux côtés des îles méditerranéennes que sont Chypre et Malte. La Bulgarie et la Roumanie ont suivi dès 2007. La Croatie a rejoint le processus en présentant une demande d’adhésion en 2003 et en devenant finalement membre en 2013.

© Craig Campbell/Moodboard/Corbis
La «perle de l’Adriatique» ― Dubrovnik en Croatie, l’État membre le plus récent de l’Union européenne.
La Turquie, membre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et liée de longue date à l’Union par un accord d’association, est candidate à l’adhésion depuis 1987. Sa situation géographique et son histoire politique ont longtemps fait hésiter l’Union à donner une réponse positive à sa demande. Finalement, le Conseil européen a ouvert, en octobre 2005, les négociations d’adhésion. Celles-ci n’ont progressé que très lentement, et certains États membres ont émis des doutes sur leur conclusion positive. Néanmoins, elles ont connu une nouvelle actualité en 2015 à la suite d’un accord entre l’Union européenne et la Turquie, cette dernière s’engageant à réduire le nombre des migrants, notamment syriens et irakiens, réfugiés sur le territoire turc et cherchant à rejoindre l’Europe. L’Union européenne a l’intention de rester une référence pour la Turquie en matière de réformes, en particulier dans les domaines de l’état de droit et des libertés fondamentales. Elle insiste sur le fait que le strict respect de ces valeurs reste une condition sine qua non à la poursuite des négociations d’adhésion.
Principalement issus de l’ex-Yougoslavie, les pays des Balkans occidentaux se tournent également vers l’Union européenne pour accélérer leur reconstruction économique et la normalisation de leurs relations mutuelles longtemps meurtries par des guerres ethniques, nationales et religieuses, et consolider leurs institutions démocratiques. L’Union européenne a accordé le statut de pays candidat à l’Albanie, à l’ancienne République yougoslave de Macédoine, au Monténégro et à la Serbie, alors que la Bosnie-Herzégovine a soumis sa candidature en 2016. Le Kosovo (1Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.) a proclamé son indépendance en 2008 et pourrait également rejoindre la liste des candidats à l’adhésion lorsque les négociations en cours au sujet de son avenir auront été clôturées.
Les négociations formelles ont été entamées avec le Monténégro en 2012 et avec la Serbie en 2013.
Dans sa stratégie d’élargissement, la Commission réaffirme avec force le principe de «priorité aux fondamentaux» dans le processus d’adhésion. Les questions essentielles que constituent l’état de droit, les droits fondamentaux, le renforcement des institutions démocratiques, y compris la réforme de l’administration publique, ainsi que le développement économique et la compétitivité, restent des priorités.
L’Islande, frappée de plein fouet par la crise financière en 2008, avait déposé sa candidature en 2009, mais les négociations d’adhésion ont été interrompues en 2014 à la demande du pays lui-même. L’opinion publique islandaise considère en effet que l’amélioration de la situation économique et financière du pays rend moins nécessaire son adhésion, et manifeste ainsi son attachement à son identité et à ses intérêts nationaux, notamment dans le domaine de la pêche.
Jean-Claude Juncker, dans son discours d’investiture devant le Parlement européen en 2014, a annoncé qu’il n’y aurait pas de nouvelle adhésion d’un pays candidat durant sa présidence de la Commission.
Les débats publics sur l’avenir de l’Union européenne montrent les interrogations des opinions européennes sur la question des frontières de l’Union et de son identité. La question ne trouve pas de réponse simple, d’autant plus que les États membres n’ont pas tous la même perception de leurs intérêts géopolitiques ou économiques. Les pays baltes et la Pologne plaident en faveur de l’adhésion de l’Ukraine, mais le conflit entre l’Ukraine et la Russie et l’annexion de la Crimée créent une tension géopolitique d’une telle ampleur que cette perspective ne peut être à l’ordre du jour. La situation politique de la Biélorussie ainsi que la situation stratégique de la Moldavie posent également le problème des relations de l’Union avec la Russie.
L’éventuelle adhésion de la Turquie poserait la question de la place de certains États du Caucase, tels que la Géorgie ou l’Arménie.
Le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ne sont pas membres de l’Union européenne, bien qu’ils remplissent les conditions d’adhésion, parce que leur opinion publique n’y consent pas à l’heure actuelle.
Plus généralement, le thème des frontières ultimes de l’Union est plus ou moins sensible selon les opinions publiques des États membres. Certes, des critères géographiques pourraient être appliqués, mais il serait juridiquement impossible de ne pas tenir compte du système de valeurs démocratiques auquel se réfère l’Union. On ne peut imaginer avant très longtemps que l’Union puisse finalement compter, comme le Conseil de l’Europe (qui n’est pas un organe de l’Union), quarante-sept membres.
La réponse fait donc appel au bon sens: tout pays européen capable de reprendre et d’assumer l’ensemble de l’acquis communautaire, c’est-à-dire les traités et le droit dérivé, y compris l’euro, a vocation à devenir membre. Toute réflexion voulant définitivement fixer les limites de l’Union est en contradiction avec le processus de construction européenne qui, depuis 1950, est une «création continue».
Au fur et à mesure que l’élargissement à douze pays de l’Europe centrale, orientale et méditerranéenne a repoussé les frontières extérieures de l’Union, s’est posée la question de la stabilité et de la sécurité de ses nouveaux voisins. L’Union a entrepris de réduire les nouvelles lignes de fracture qui pourraient apparaître entre elle et ces régions plus lointaines. Il fallait s’efforcer entre autres de contrer l’émergence des risques d’insécurité comme l’immigration clandestine, la rupture des importations énergétiques, la dégradation environnementale, la pénétration de la criminalité organisée et du terrorisme.
Aussi l’Union a-t-elle développé une nouvelle politique européenne de voisinage pour gérer ses relations avec ses voisins:
Pratiquement tous ces pays ont bénéficié à partir de 2004 d’un accord bilatéral de partenariat et de coopération ou d’un accord d’association: d’une part, les pays concernés prennent des engagements dans le sens des valeurs communes de la démocratie, de l’état de droit et du respect des droits de l’homme, et s’efforcent de progresser vers l’économie de marché, le développement durable et la réduction de la pauvreté; d’autre part, l’Union offre des crédits, une coopération technique, une assistance macroéconomique, un assouplissement du régime des visas et toute mesure permettant le développement de ses partenaires.
Mais les événements géopolitiques survenus au cours de la dernière décennie, à l’est comme au sud du continent, ont radicalement changé la donne.
La chute du gouvernement autoritaire de l’Ukraine, à la fin de 2013, et l’élection, en mai 2014, d’un président tourné vers les valeurs occidentales, Petro Poroschenko, ont permis la signature, en septembre 2014, d’un accord d’association, ratifié simultanément par le Parlement ukrainien et le Parlement européen. La situation catastrophique de l’économie ukrainienne, ajoutée à la tension militaire dans l’est du pays entre l’armée ukrainienne et des forces sécessionnistes soutenues par la Russie, hypothèque l’avenir du pays sans empêcher son rapprochement avec l’Union. Dans les années 2014-2015, l’Union européenne a accordé à l’Ukraine une aide de plus de 7 milliards d’euros à titre d’assistance financière en échange de réformes politiques et démocratiques.
Les révolutions arabes qui ont bouleversé la situation politique dans la plupart des pays de la rive sud de la Méditerranée en 2011, suivies de changements de régime en Tunisie et en Égypte, la guerre civile en Syrie, le chaos qui a succédé au régime Kadhafi en Libye, l’offensive et la conquête par la terreur de territoires en Irak et en Syrie par le soi-disant «État islamique», Daech, ont sensiblement compliqué la politique de voisinage de l’Union européenne dans cette région.
D’une part, certains États membres se sont engagés dans la coalition militaire combattant le soi-disant «État islamique», Daech; d’autre part, l’Union doit faire face à un afflux important de migrants, provenant de Syrie, de la Corne de l’Afrique et de l’Afrique subsaharienne, fuyant la guerre, les persécutions religieuses ou la misère. En 2015, 1 million de personnes ont traversé la Méditerranée sur des bateaux affrétés par des passeurs illégaux depuis les côtes libyennes et turques ou ont rejoint les Balkans. Face à ce défi humanitaire de grande ampleur et à la menace de voir affluer des centaines de milliers d’autres migrants, l’Union a révisé et approfondi sa politique commune d’asile et d’immigration (voir le chapitre 10).

© josef/kubes/Adobe Stock
L’Union soutient financièrement le développement de l’économie des pays voisins.
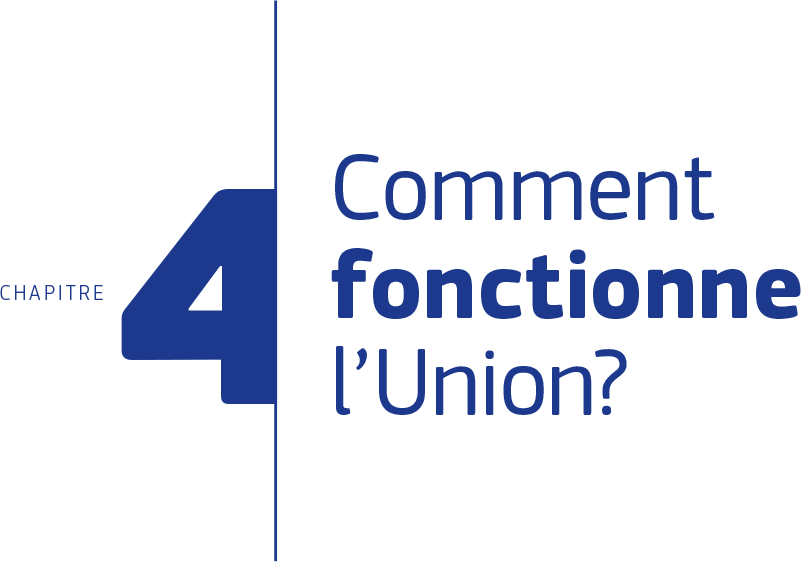
Plus qu’une confédération d’États, moins qu’un État fédéral, l’Union européenne est une construction qui n’entre pas dans une catégorie juridique classique. Elle se fonde sur un système politique original en permanente évolution depuis plus de soixante ans.
Les traités (constituant le droit primaire) sont à l’origine de nombreux actes juridiques (dits «de droit dérivé») qui ont une incidence directe sur la vie quotidienne des citoyens européens. C’est le cas notamment des règlements, directives et recommandations adoptés par les institutions de l’Union.
Ces lois et, de façon plus générale, les politiques de l’Union européenne sont le résultat de décisions prises par le Parlement européen, représentant les citoyens, le Conseil, représentant les États membres, et la Commission, organe exécutif et indépendant des États, garantissant l’intérêt général des Européens.
Le Parlement européen est l’organe d’expression démocratique et de contrôle politique de l’Union qui participe également au processus législatif. Depuis 1979, ses membres sont élus au suffrage universel tous les cinq ans.
En 2017, un Italien, Antonio Tajani [Groupe du Parti populaire européen (démocrates-chrétiens)], a été élu président du Parlement pour une période de deux ans et demi.

© European Union
Le Parlement européen, c’est l’endroit où vous pouvez faire entendre votre voix.
| Allemagne | 96 |
| Autriche | 18 |
| Belgique | 21 |
| Bulgarie | 17 |
| Chypre | 6 |
| Croatie | 11 |
| Danemark | 13 |
| Espagne | 54 |
| Estonie | 6 |
| Finlande | 13 |
| France | 74 |
| Grèce | 21 |
| Hongrie | 21 |
| Irlande | 11 |
| Italie | 73 |
| Lettonie | 8 |
| Lituanie | 11 |
| Luxembourg | 6 |
| Malte | 6 |
| Pays-Bas | 26 |
| Pologne | 51 |
| Portugal | 21 |
| République tchèque | 21 |
| Roumanie | 32 |
| Royaume-Uni | 73 |
| Slovaquie | 13 |
| Slovénie | 8 |
| Suède | 20 |
| Total | 751 |
Le Parlement tient ses principaux débats chaque mois au cours de sessions plénières qui réunissent tous les députés européens, à Strasbourg. Des sessions additionnelles se tiennent également à Bruxelles. Ses vingt commissions, qui préparent les travaux des séances plénières, entre autres en introduisant des amendements législatifs, ainsi que les groupes politiques se réunissent la plupart du temps à Bruxelles. Ces derniers jouent un rôle déterminant dans la ligne politique de l’institution, notamment à travers la conférence des présidents de groupe (réunissant ceux-ci autour du président du Parlement) qui fixe l’ordre du jour des sessions plénières. Le travail administratif quotidien du Parlement est assuré par le secrétariat général, installé à Luxembourg et à Bruxelles. Les groupes politiques disposent également chacun d’un secrétariat.
Le Parlement exerce une fonction législative auprès de l’Union à deux niveaux:
Le Parlement partage également avec le Conseil le pouvoir budgétaire: il adopte le budget de l’Union (proposé par la Commission européenne). Il a aussi la possibilité de le rejeter, ce qui s’est déjà produit à plusieurs reprises. Dans ce cas, toute la procédure budgétaire est à recommencer. En utilisant ses pouvoirs budgétaires, le Parlement exerce une influence considérable sur les politiques de l’Union.
Mais avant tout, le Parlement européen est l’organe de contrôle démocratique de l’Union et plus spécifiquement de la Commission.
Tous les cinq ans, le Parlement européen est renouvelé. Entre le 22 et le 25 mai 2014 eurent lieu les 8es élections, qui atteignirent un taux moyen de participation de 42,5 %, pour 380 millions d’électeurs inscrits, chiffre sensiblement égal à celui des précédentes élections de 2009.
En application du traité de Lisbonne, et pour la première fois, les partis politiques européens désignèrent leurs têtes de liste qui se présentèrent comme candidats au poste de président de la Commission. Les députés issus du Parti populaire européen étant les plus nombreux, le Conseil européen a décidé de nommer, à la majorité qualifiée, le candidat de ce groupe, Jean-Claude Juncker, ancien Premier ministre du Luxembourg, en tant que président désigné de la Commission. À une très large majorité (422 voix contre 250 et 47 abstentions), le Parlement européen a voté l’investiture du nouveau président de la Commission le 15 juillet 2014.
Le Parlement a ensuite auditionné chacun des 27 commissaires proposés par chaque État membre avant de procéder au vote d’approbation de l’ensemble de la Commission. Le Parlement dispose du pouvoir de renverser l’ensemble de la Commission à tout moment en adoptant une motion de censure. Celle-ci requiert deux tiers des votes. Le Parlement contrôle aussi la gestion quotidienne des politiques de l’Union en posant des questions orales et écrites à la Commission et au Conseil.
Enfin, il faut ajouter que les membres du Parlement européen et ceux des parlements nationaux des États membres entretiennent des liens de travail étroits soit au sein des groupes politiques, soit au sein d’organes spécialisés. Le traité de Lisbonne définit depuis 2009 les droits et obligations des parlements nationaux. Ils peuvent exprimer leur point de vue sur les actes législatifs proposés par la Commission et veiller à l’application du principe de subsidiarité dans le processus décisionnel européen. Ce principe énonce que l’Union intervient uniquement si l’action envisagée peut être plus efficace au niveau de l’Union qu’au niveau national ou régional.
Composition des groupes politiques au Parlement européen

Le Conseil européen est le principal centre de décision politique de l’Union européenne. Il comprend les chefs d’État ou de gouvernement — les présidents et/ou les Premiers ministres — de tous les pays membres de l’Union, ainsi que le président de la Commission. Il se réunit en principe quatre fois par an, à Bruxelles. Le président permanent du Conseil européen a pour rôle de coordonner le travail de celui-ci et d’en assurer la continuité. Il est élu à la majorité qualifiée par ses membres pour deux ans et demi et est rééligible une fois. L’ancien Premier ministre polonais Donald Tusk occupe cette fonction depuis le 1er décembre 2014.
Le Conseil européen fixe les objectifs de l’Union et détermine les moyens d’y parvenir. Il donne l’impulsion des principales initiatives politiques de l’Union et prend des décisions sur les questions épineuses qui n’ont pu être résolues par le Conseil de ministres. Le Conseil européen aborde également les problèmes d’actualité internationale à travers la politique étrangère et de sécurité commune, mécanisme de rapprochement et d’expression d’une diplomatie commune des États membres.
Le Conseil de l’Union européenne (ou Conseil de ministres) est composé des ministres des gouvernements nationaux de l’Union européenne. Chaque pays de l’Union en exerce la présidence, par rotation, pour une durée de six mois. Il réunit les ministres des pays membres de l’Union selon la matière inscrite à l’ordre du jour, ce qui représente dix formations différentes: «Affaires étrangères», «Affaires générales», «Affaires économiques et financières», «Justice et affaires intérieures», «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs», «Compétitivité (marché intérieur, industrie, recherche et espace)», «Transports, télécommunications et énergie», «Agriculture et pêche», «Environnement» et «Éducation, jeunesse, culture et sport».
| Année | De janvier à juin | De juillet à décembre |
|---|---|---|
| 2017 | Malte | Estonie |
| 2018 | Bulgarie | Autriche |
| 2019 | Roumanie | Finlande |
| 2020 | Croatie | Allemagne |
| 2021 | Portugal | Slovénie |
Pour favoriser la continuité du Conseil, les présidences semestrielles collaborent par groupe de trois pour gérer un programme de travail commun sur une période de dix-huit mois, assurant ainsi une gestion suivie des dossiers.
La présidence du Conseil des ministres des affaires étrangères est exercée par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Cette fonction est exercée par une personnalité désignée par le Conseil européen, et est cumulée avec celle de vice-président de la Commission. Madame Federica Mogherini, ancienne ministre des affaires étrangères de l’Italie, exerce cette double responsabilité depuis décembre 2014.
Le Conseil dispose du pouvoir législatif, qu’il partage avec le Parlement européen. Il exerce également avec ce dernier le pouvoir budgétaire. Le Conseil arrête les accords internationaux négociés au préalable par la Commission.
Selon les traités, les décisions prises au sein du Conseil font l’objet d’un vote à la majorité simple, à la majorité qualifiée ou à l’unanimité, selon les matières.
Dans des domaines essentiels tels que l’adhésion d’un nouvel État, la fiscalité, la modification des traités ou la mise en route d’une nouvelle politique commune, le Conseil doit statuer à l’unanimité.
Dans la plupart des autres cas, le Conseil doit statuer à la majorité qualifiée à travers une «double majorité»: une décision est adoptée si elle obtient le soutien de 55 % des membres du Conseil, soit 16 pays sur 28, représentant au moins 65 % de la population de l’Union, soit environ 332 millions de personnes sur 510 millions.
Une autre formation du Conseil de ministres s’exerce depuis la création de l’euro: l’Eurogroupe. Celui-ci est composé des ministres de l’économie et des finances des 19 pays de la zone euro.
La Commission européenne est l’un des organes clés du système institutionnel de l’Union européenne. Elle dispose du monopole de l’initiative dans le domaine législatif: ses propositions sont adressées au Parlement européen et au Conseil pour discussion et adoption. Ses membres sont nommés pour cinq ans d’un commun accord par les États membres après un vote d’investiture du Parlement. Elle est contrainte à la démission collective lorsqu’elle est censurée par le Parlement européen, devant lequel elle est responsable.
La Commission compte un commissaire par État membre, y compris le président et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité qui en est l’un des vice-présidents. Le collège des commissaires présidé par Jean-Claude Juncker a pris ses fonctions le 1er novembre 2014. Sept vice-présidents ont été désignés pour coordonner les travaux des commissaires et assurer leur collaboration dans des secteurs prioritaires comme l’emploi, la croissance et l’investissement, le marché unique numérique, l’énergie et le climat, l’union économique et monétaire, etc.

© European Union
La Commission européenne est l’organe exécutif de l’Union européenne et ses membres se doivent d’écouter les avis des citoyens, comme c’est le cas ici, lors d’un de ses «dialogues citoyens».
Pour que l’action du collège se concentre sur les secteurs les plus stratégiques de la vie de l’Union et conformément au principe de subsidiarité et d’efficacité, le président a désigné un premier vice-président, Frans Timmermans, qui est chargé de l’amélioration de la réglementation et des relations interinstitutionnelles.
La Commission jouit d’une large indépendance dans l’exercice de ses attributions. Elle incarne l’intérêt commun et ne doit se soumettre à aucune injonction de l’un ou l’autre État membre. Gardienne des traités, elle veille à la mise en œuvre des règlements et des directives adoptés par le Conseil et le Parlement, et peut recourir à la voie contentieuse devant la Cour de justice pour faire appliquer le droit de l’Union.
Organe de gestion, la Commission exécute les décisions prises par le Conseil, par exemple dans le domaine de la politique agricole commune. Elle dispose d’un large pouvoir dans la conduite des politiques communes dont le budget lui est confié: recherche et technologie, aide au développement, cohésion régionale, etc.
Les commissaires disposent pour les assister d’une administration, basée principalement à Bruxelles et à Luxembourg. Il existe aussi des offices et des agences, créés pour mener à bien des tâches spécifiques de la Commission et qui sont généralement basés dans d’autres villes européennes.
La Cour de justice de l’Union européenne, dont le siège est fixé à Luxembourg, est composée d’un juge par État membre et assistée de onze avocats généraux, qui sont désignés d’un commun accord par les gouvernements, pour un mandat de six ans renouvelable. Leur indépendance est garantie. Le rôle de la Cour est d’assurer le respect du droit européen et l’interprétation et l’application correcte des traités.
La Banque centrale européenne, située à Francfort, a la responsabilité de gérer l’euro et la politique monétaire de l’Union (voir le chapitre 7). Le conseil des gouverneurs de la Banque, composé des six membres du directoire et des gouverneurs des banques centrales des dix-neuf membres de la zone euro, est le principal organe de cette institution indépendante qui ne reçoit d’instructions ni des États membres, ni des institutions de l’Union. Ses principales missions consistent à maintenir la stabilité des prix et à surveiller les banques de la zone euro. M. Mario Draghi est président de la Banque centrale européenne depuis 2011.
La Cour des comptes européenne, créée en 1975, a son siège à Luxembourg. Elle est composée de 28 membres, un pour chaque pays de l’Union, désignés d’un commun accord pour six ans par les États membres, après consultation du Parlement européen. Elle vérifie la légalité et la régularité des recettes et des dépenses de l’Union ainsi que sa bonne gestion financière.
Le Conseil et la Commission européenne sont assistés par le Comité économique et social européen. Celui-ci est formé de membres représentant les différentes catégories de la vie économique et sociale et de la société civile, nommés par le Conseil pour une durée de cinq ans.
Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales, nommés par le Conseil sur proposition des États membres pour cinq ans. Il est consulté par le Conseil ou la Commission dans les cas prévus par les traités et peut émettre des avis de sa propre initiative.
La Banque européenne d’investissement, située à Luxembourg, est compétente pour accorder des prêts et des garanties pour la mise en valeur des régions moins développées, et favoriser les investissements.
Le Médiateur européen, élu pour un mandat renouvelable de cinq ans par le Parlement européen, enquête sur les plaintes pour mauvaise administration par des institutions de l’Union. Ces plaintes peuvent lui être adressées par des citoyens, des résidents et des entreprises de l’Union. Mme Emily O’Reilly est le Médiateur depuis 2013.

© belahoche/Adobe Stock
La Cour de justice garantit le respect de la loi européenne.
Elle a, par exemple, confirmé l’interdiction de la discrimination à l’encontre des travailleurs handicapés.
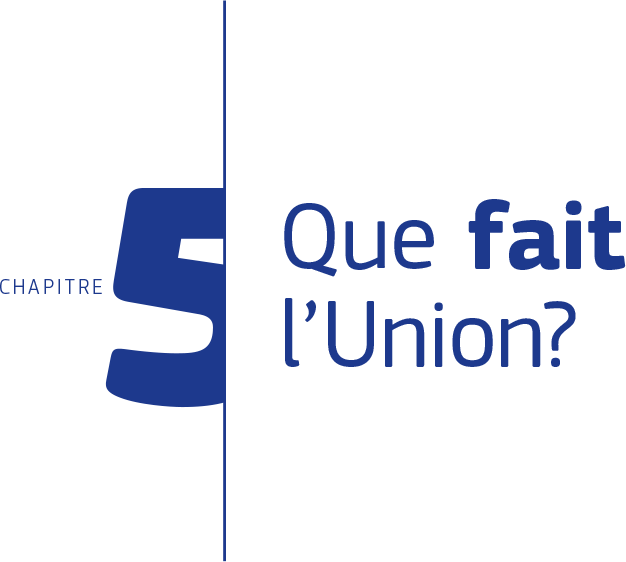
La dimension européenne est présente dans le cadre de vie du citoyen en s’attaquant aux défis concrets de la société: la protection de l’environnement, l’innovation technologique, l’énergie, etc.
Dès les années 60, les scientifiques ont alerté sur la gravité du réchauffement climatique. La réponse des dirigeants mondiaux a été trop longtemps marquée par un certain déni de cette réalité et de ses risques pour la planète. Néanmoins, un groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat est créé en 1988 sous l’égide des Nations unies. Très rapidement, ce groupe d’experts met en garde la communauté internationale contre les effets potentiellement désastreux du réchauffement climatique induit par les émissions toujours croissantes des gaz à effet de serre, principalement produits par la combustion des hydrocarbures.

© Westend61/gettyimages
L’Union mène la lutte contre le changement climatique et défend le développement durable.
L’Union européenne apporte dès 2008 une contribution majeure à la lutte contre le changement climatique en décidant de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % d’ici à 2020 par rapport au niveau de 1990, de faire passer la part des énergies renouvelables à 20 % du marché et de réduire de 20 % la consommation globale d’énergie. En 2014, l’Union s’est fixé l’objectif plus contraignant de diminuer, d’ici à 2030, les émissions à effet de serre d’au moins 40 % par rapport au niveau de 1990. L’Union a joué un rôle décisif pour assurer, à la Conférence des Nations unies, en décembre 2015, la conclusion d’un accord par 195 pays, visant à maintenir le réchauffement planétaire au-dessous de 2 °C d’ici à la fin du siècle. Les pays en développement, en particulier les plus pauvres, ayant besoin d’une importante aide financière pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique, l’Union a prévu de prélever 14 milliards d’euros de subventions sur le Fonds européen de développement entre 2014 et 2020 à cette fin. La procédure de ratification de l’accord par l’Union européenne s’est achevée le 4 octobre 2016. Le Parlement européen a approuvé la ratification de l’accord de Paris par l’Union européenne. Cela a permis l’entrée en vigueur de l’accord.
Les États membres de l’Union adoptent progressivement une législation contraignante conçue pour permettre d’atteindre ces objectifs. Une grande partie de l’effort porte sur les investissements dans les nouvelles technologies, qui sont également créateurs de croissance économique et d’emplois.
L’action de l’Union en matière d’environnement est extrêmement variée: elle aborde des aspects tels que le bruit, les déchets, la protection des habitats naturels, les gaz d’échappement, les produits chimiques, les accidents industriels ou les eaux de baignade. L’Union est également active dans le domaine de la prévention des catastrophes naturelles ou d’origine humaine, telles que les marées noires ou les feux de forêt.
L’Union européenne s’implique dans l’amélioration des réglementations visant à assurer une meilleure protection de la santé des citoyens. Par exemple, la réglementation relative aux produits chimiques est progressivement réformée afin de remplacer la législation établie par un système unique d’enregistrement, d’évaluation et d’autorisation des substances chimiques (REACH — Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Ce système repose sur une base de données centrale qui est gérée par l’Agence européenne des produits chimiques, établie à Helsinki. L’objectif est d’éviter la contamination de l’air, de l’eau, des sols et des bâtiments, de préserver la biodiversité et d’améliorer la santé et la sécurité des citoyens de l’Union, tout en maintenant la compétitivité de l’industrie européenne.
Convaincue que l’avenir de l’Europe résidait dans la capacité des Européens à tenir leur rang dans la course technologique, la Communauté européenne a, dès son origine, évalué à leur juste mesure l’effet mobilisateur et la valeur en termes d’investissement pour le futur de la recherche menée en commun. Aux côtés de la Communauté économique européenne a été lancé, en 1958, l’Euratom, consacrée à l’exploitation en commun de l’énergie atomique à usage civil et dotée de son propre centre de recherche. Ce Centre commun de recherche est composé de neuf instituts répartis sur quatre sites.
Mais l’accélération de la course à l’innovation a rendu nécessaire le fait d’aller plus loin et de susciter le plus grand brassage possible de scientifiques, en décloisonnant les recherches et en multipliant les applications industrielles.
L’action de l’Union s’est voulue complémentaire des actions nationales: elle favorise les projets regroupant plusieurs laboratoires de plusieurs États membres. Elle stimule des efforts menés aussi bien dans le domaine de la recherche fondamentale, comme la fusion thermonucléaire contrôlée, source d’énergie potentiellement inépuisable pour le XXIe siècle, que dans les industries les plus stratégiques menacées sur le plan industriel, comme l’électronique et l’informatique.
Le plan d’action de l’Union en faveur de l’éco-innovation finance la recherche et les entreprises éco-innovantes. L’Union encourage aussi la passation de marchés publics respectueux de l’environnement, le calcul des coûts des produits tout au long de leur cycle de vie et le label écologique afin d’élargir la diffusion des technologies vertes.
L’Union s’est fixé comme objectif d’investir dans la recherche 3 % du produit intérieur brut européen. Les programmes-cadres constituent le principal instrument de financement de la recherche européenne. Le huitième programme-cadre de recherche et de développement technologique couvre la période 2014-2020. Le budget de 80 milliards d’euros est en grande partie consacré à des domaines tels que la santé, l’alimentation et l’agriculture, les technologies de l’information et de la communication, les nanosciences, l’énergie, l’environnement, les transports, la sécurité, l’espace et les sciences socio-économiques. D’autres programmes valorisent les idées, le personnel et les capacités, par des travaux de recherche aux frontières de la connaissance, par un soutien apporté aux chercheurs et au développement de leur carrière et par la coopération internationale.
À l’heure actuelle, l’Union européenne est le plus gros importateur d’énergie au monde. Elle importe 53 % de l’énergie qu’elle consomme pour un coût annuel d’environ 400 milliards d’euros. Elle est donc vulnérable face aux ruptures d’approvisionnement ou aux hausses de prix provoquées par les crises internationales. Elle doit aussi réduire sa consommation de combustibles fossiles afin d’inverser la tendance au réchauffement climatique.
L’avenir exige de combiner plusieurs éléments: économiser l’énergie en l’utilisant de manière plus intelligente, développer les sources d’énergie alternatives (en particulier les énergies renouvelables en Europe) et renforcer la coopération internationale. La meilleure isolation thermique des bâtiments est un secteur clé, puisque 40 % de l’énergie y est consommée et qu’ils émettent 36 % de tous les gaz à effet de serre dans l’Union. La recherche et le développement en Europe favorisent les projets portant sur le solaire, l’éolien, la biomasse et le nucléaire. L’Union a également investi dans le projet «Clean sky» pour développer des transports aériens moins polluants.
Une autre priorité inscrite dans la stratégie énergétique de la Commission depuis 2014 concerne l’interconnexion des grands réseaux de transport sur l’ensemble du territoire de l’Union. Cela concerne par exemple l’interconnexion des marchés de l’énergie entre la péninsule Ibérique et la France, et au sein de la région en mer Baltique.
L’Europe doit faire valoir ses intérêts sur la scène internationale, en tant que premier marché de consommation régional au monde, afin de garantir la sécurité de ses approvisionnements énergétiques, en particulier ceux provenant de la Russie et du Moyen-Orient. Il est donc vital que l’Europe parle d’une seule voix avec ses principaux fournisseurs.

© sergbob/fotolia
Les réseaux énergétiques doivent être mieux connectés au sein de l’Europe afin de fournir une énergie plus sûre et plus efficace.
Pour réaliser l’achèvement du marché intérieur, il est nécessaire d’en corriger les déséquilibres. C’est la raison d’être des politiques de solidarité qui, comme leur nom l’indique, vont favoriser les régions en retard et les secteurs en difficulté. L’Union apporte également sa contribution à la reconversion des industries durement touchées par la concurrence mondiale en pleine expansion.
Dans le cadre du budget de l’Union pour la période 2014-2020, la politique de cohésion investira 325 milliards d’euros, soit 34 % des crédits prévus, dans les États membres, leurs régions et leurs villes afin de favoriser la réalisation des objectifs européens consistant à créer de la croissance et des emplois et à lutter contre le changement climatique, la dépendance énergétique et l’exclusion sociale.
Ces objectifs sont financés par des fonds spécifiques qui viennent compléter ou stimuler les efforts des États, des régions et des investissements privés:
Le traité de Rome de mars 1957 avait fixé, pour la politique agricole commune, des objectifs qui ont été largement atteints: assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, stabiliser les marchés, assurer des prix raisonnables aux consommateurs, moderniser les structures agricoles. D’autres principes progressivement mis en place ont correctement fonctionné. La sécurité des approvisionnements a été assurée pour les consommateurs, qui ont pu bénéficier de prix stables. Le financement de la politique agricole transite par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

© European Union
En Pologne, Anna de Lublin gère son propre jardin d’enfants grâce, en partie, à un projet destiné aux femmes entrepreneurs soutenu par le Fonds social européen.
Victime de son succès, la politique agricole a dû redéfinir ses méthodes pour limiter une croissance de la production qui dépassait largement celle de la consommation et générait des coûts considérables à la charge du budget de l’Union. Ces réformes ont porté leurs fruits, et la production est maintenant mieux maîtrisée.
Le monde agricole se voit confier de nouvelles tâches: assurer une certaine activité économique au sein de chaque territoire et entretenir la diversité et la durabilité de nos paysages. Cette diversité et la reconnaissance d’une «civilisation rurale» — la relation harmonieuse entre l’homme et les terroirs — sont des éléments importants de l’identité européenne. Plus encore, l’agriculture doit contribuer à la défense du climat et de la nature et participer à la lutte contre la faim dans le monde.
En outre, il existe des régimes destinés à promouvoir et à protéger les désignations et appellations d’origine de nombreux produits alimentaires locaux et régionaux de qualité.
Enfin, l’Union a réformé sa politique commune de la pêche, avec comme objectifs principaux la réduction de la surcapacité des flottes de pêche et la protection des ressources de la mer (comme le thon rouge), tout en aidant financièrement les personnes qui quittent ce secteur.
Une politique sociale tente de corriger les déséquilibres les plus flagrants. Le Fonds social européen a été mis en place en 1961 pour promouvoir les facilités d’emploi et la mobilité professionnelle et géographique des travailleurs.
L’aide financière n’est pas le seul instrument concrétisant la vocation sociale de l’Union. Cette aide ne suffirait pas à remédier à l’ensemble des situations dues à la crise ou au retard de développement de certaines régions. Les effets dynamiques de la croissance doivent en priorité favoriser le progrès social. Celui-ci est également accompagné par une législation garantissant un «socle» de droits minimaux. Cet espace social est à la fois constitué de règles inscrites dans les traités, comme l’égalité de rémunération à travail égal entre hommes et femmes, et issu de directives portant sur la protection des travailleurs (hygiène et sécurité sur le lieu de travail) et sur les normes de sécurité essentielles.
La charte européenne des droits sociaux fondamentaux, intégrée dans le traité sur l’Union européenne en 1997, définit les droits dont devrait bénéficier le monde du travail dans toute l’Union: libre circulation, juste rémunération, amélioration des conditions de travail, protection sociale, associations et négociations collectives, formation professionnelle, égalité de traitement entre hommes et femmes, information, consultation et participation des travailleurs, protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, protection des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées.
Des discussions sont en cours concernant la manière dont la protection sociale européenne peut être organisée dans un futur marché du travail de plus en plus influencé par les nouvelles technologies et la mondialisation.
Pour financer ces politiques, l’Union dispose d’un budget annuel qui s’élève à plus de 157 milliards d’euros en 2017, soit environ 1 % du revenu national brut cumulé de l’ensemble des États membres.
Ce budget est financé par les «ressources propres» de l’Union, qui sont principalement tirées:
Le budget 2017 comprend les cinq grandes rubriques suivantes:
Chaque budget annuel s’inscrit dans un cycle budgétaire septennal appelé «cadre financier pluriannuel», élaboré par la Commission européenne et adopté à l’unanimité par les États membres à la suite de négociations et d’un accord avec le Parlement européen. Le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 a été adopté en 2013. Le plafond global des dépenses a été réduit de près de 3 % en termes réels par rapport à la période précédente, qui couvrait les années 2007-2013.
Ce plan de dépenses vise à améliorer la croissance et l’emploi en Europe, à favoriser une agriculture plus verte et à établir une Europe plus attentive à l’environnement et plus forte sur la scène internationale. Certains domaines comme la recherche et l’innovation, l’éducation et la formation et les relations extérieures bénéficient d’augmentations de financement. Des fonds spécifiques serviront à la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, ainsi qu’aux politiques de migration et d’asile. Les dépenses consacrées au climat représentent une part croissante des dépenses de l’Union au cours de la période 2014-2020.
Dix priorités pour l’Europe
Depuis novembre 2014, la Commission européenne, présidée par Jean-Claude Juncker, a défini dix grandes priorités, sur lesquelles les institutions de l’Union européenne concentrent leur action.
 Un nouvel élan pour l’emploi, la croissance et l’investissement
Un nouvel élan pour l’emploi, la croissance et l’investissement Un marché unique numérique connecté
Un marché unique numérique connecté Une Union plus résiliente sur le plan de l’énergie, dotée d’une politique visionnaire en matière de changement climatique
Une Union plus résiliente sur le plan de l’énergie, dotée d’une politique visionnaire en matière de changement climatique Un marché intérieur plus approfondi et plus équitable, doté d’une base industrielle renforcée
Un marché intérieur plus approfondi et plus équitable, doté d’une base industrielle renforcée Une Union économique et monétaire plus approfondie et plus équitable
Une Union économique et monétaire plus approfondie et plus équitable Un accord de libre-échange raisonnable et équilibré avec les États-Unis
Un accord de libre-échange raisonnable et équilibré avec les États-Unis Un espace de justice et de droits fondamentaux basé sur la confiance mutuelle
Un espace de justice et de droits fondamentaux basé sur la confiance mutuelle Vers une nouvelle politique migratoire
Vers une nouvelle politique migratoire Une Europe plus forte sur la scène internationale
Une Europe plus forte sur la scène internationale Une Union du changement démocratique
Une Union du changement démocratiqueComment sont réparties les compétences entre les États membres et l’Union européenne?

Le traité instituant la Communauté économique européenne, signé en mars 1957, a permis la suppression des barrières douanières intracommunautaires et l’établissement d’un tarif douanier commun à l’égard des pays hors de la Communauté. Cet objectif a été atteint le 1er juillet 1968.
Mais les droits de douane ne constituent qu’un aspect du protectionnisme. D’autres entraves aux échanges ont, dans les années 70, empêché la réalisation complète du marché commun. Les spécifications techniques, les normes de santé et de sécurité, les réglementations nationales concernant l’exercice des professions et le contrôle des changes restreignaient la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux.
En juin 1985, le président de la Commission, Jacques Delors, rend public un livre blanc prévoyant la suppression, en sept ans, de toutes les entraves physiques, techniques et fiscales à la libre circulation dans l’espace de la Communauté. Son objectif est d’accroître les possibilités d’expansion industrielle et commerciale à l’intérieur d’un grand espace économique unifié, à la mesure du grand marché américain.
Des négociations intergouvernementales ont conduit à l’adoption d’un nouveau traité, l’Acte unique européen, qui est entré en vigueur en juillet 1987. Il prévoyait:
Tous les contrôles aux frontières au sein de l’Union sur les marchandises ont été supprimés, ainsi que les contrôles douaniers sur les personnes. Les contrôles de police (lutte contre la criminalité et la drogue) subsistent ponctuellement.
L’accord de Schengen, conclu en juin 1985 entre cinq des États membres, organise la coopération policière et une politique d’asile et de visa commune, afin de rendre possible l’abolition totale des contrôles des personnes aux frontières à l’intérieur de l’Union (voir le chapitre 10). L’espace Schengen compte aujourd’hui vingt-six pays européens, dont quatre ne sont pas membres de l’Union (l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse).
Les États membres ont adopté, pour la plupart des produits, le principe de reconnaissance mutuelle des réglementations nationales, introduit par la Cour de justice lors de la célèbre affaire Cassis de Dijon (1979). Tout produit légalement fabriqué et commercialisé dans un État membre doit pouvoir être mis sur le marché de tout autre État membre.
La libéralisation du secteur des services est acquise grâce à la reconnaissance mutuelle ou à la coordination des réglementations nationales d’accès ou d’exercice de certaines professions (droit, médecine, tourisme, banque, assurances, etc.). Néanmoins, la libre circulation des personnes est loin d’être accomplie. En effet, certaines catégories de travailleurs qui souhaitent séjourner ou exercer leur activité dans un autre État membre se heurtent à de multiples obstacles, en dépit de la directive de septembre 2005 sur la reconnaissance des diplômes et des qualifications professionnelles. Mais de plus en plus de professionnels (professions libérales, juridiques ou médicales, bâtiment, menuiserie, plomberie) sont à même d’exercer leur métier et de s’établir sur tout le territoire de l’Union.
La Commission a pris des initiatives pour favoriser la mobilité de ces actifs, notamment par le biais de la reconnaissance des diplômes ou des qualifications professionnelles.
Certains travailleurs exercent leur profession temporairement dans un autre pays de l’Union. C’est le cas, par exemple, d’une entreprise de construction ayant un projet dans un autre pays que celui dans lequel elle est établie. La législation européenne stipule que les conditions de travail des travailleurs dits «détachés» doivent être équivalentes à celles dont bénéficient les travailleurs du pays dans lequel le travail est effectué.
Les entraves fiscales ont été réduites grâce à l’harmonisation des taux de TVA. Les États membres sont convenus d’un alignement général de leurs règles et de fixer des taux minimaux, afin d’éviter une distorsion de la concurrence au sein de l’Union.
Les marchés publics constituent un secteur essentiel de l’économie, puisqu’ils représentent 19 % du produit intérieur brut de l’Union. Conclus au nom des administrations à l’échelle centrale, régionale ou locale, ils font désormais l’objet d’une concurrence sur tout le territoire de l’Union grâce aux directives sur la passation des marchés publics de services, de fournitures et de travaux, y compris dans des secteurs tels que l’eau potable, l’énergie et les télécommunications.
En conclusion, le marché intérieur bénéficie désormais aux consommateurs. Par exemple, grâce à l’ouverture des marchés nationaux de l’Union, le prix des appels téléphoniques au sein de l’Union européenne n’est plus qu’une fraction de ce qu’il était il y a dix ou quinze ans. Les tarifs aériens ont chuté de manière significative en Europe sous la pression de la concurrence.
La tourmente bancaire et financière mondiale de 2008, partie des États-Unis à la suite de la cessation de paiement de certaines banques et de la crise des subprimes, a profondément ébranlé le système économique mondial et a entraîné un recul du produit intérieur brut de l’Union en 2009. La réponse qui s’en est suivie a notamment consisté à réformer le système financier pour obtenir plus de transparence et de responsabilité. La Commission a lancé le vaste chantier de l’union bancaire. Des autorités de surveillance européennes, principalement sous le contrôle de la Banque centrale européenne, ont été mises en place en 2014 pour surveiller les banques. De nouvelles règles européennes renforcent la garantie des dépôts, augmentent les fonds propres des banques afin d’accroître leur stabilité, réglementent des produits financiers complexes et imposent des limites aux bonus des dirigeants des banques. Il reste à approfondir le marché unique des capitaux pour faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises au financement et renforcer l’attractivité de l’Europe en matière d’investissements.
L’un des prochains chantiers de la Commission porte sur la réforme de la fiscalité des entreprises. Celle-ci permettrait, non pas par l’harmonisation des taux d’impôt des entreprises, mais à travers l’harmonisation des règles de calcul et de comptabilité, de rendre l’accès au marché unique plus facile pour les entreprises et réduirait l’évasion ou l’«optimisation» fiscale.

© Rolf Bruderer/Corbis
En ouvrant le marché des télécommunications à la concurrence, l’Union a fait baisser les tarifs de manière spectaculaire.
Les produits de l’Union européenne doivent être protégés contre le piratage et la contrefaçon. La Commission européenne estime que ces pratiques coûtent chaque année des milliers d’emplois à l’Union. C’est la raison pour laquelle la Commission et les États membres s’efforcent de renforcer la protection des droits d’auteur et des brevets.
L’activité de l’Union s’est concentrée sur la libre prestation des services dans le domaine des transports terrestres, notamment le libre accès au marché des transports internationaux et les activités de cabotage, c’est-à-dire l’admission des transporteurs d’un État membre sur le marché des transports nationaux d’un autre État membre. L’Union harmonise les conditions de concurrence pour les transports routiers, notamment les conditions d’accès à la profession et au marché, la liberté d’établissement et de prestation de services, les durées de conduite et la sécurité.
Auparavant, le domaine du transport aérien était dominé par des compagnies nationales et des aéroports appartenant aux États. Aujourd’hui, avec le marché européen, toutes les compagnies européennes peuvent proposer leurs services, quelle que soit la destination, et fixer leurs tarifs comme elles l’entendent. De nouvelles routes dans le ciel se sont ouvertes, et les prix ont diminué de manière spectaculaire. Aussi tous les acteurs (passagers, compagnies, aéroports et employés) sont-ils gagnants.
La concurrence dans les transports ferroviaires s’est également ouverte au profit des passagers.
Les transports maritimes sont soumis aux règles de concurrence qui s’appliquent aussi bien aux armateurs européens qu’à ceux naviguant sous pavillon de pays tiers. Ces règles tentent de contrôler les pratiques tarifaires déloyales (pavillons de complaisance), mais également de faire face aux difficultés qui frappent l’industrie des chantiers navals en Europe.
Depuis le début des années 2000, l’Union européenne a par ailleurs lancé des projets technologiques ambitieux tels que le système de navigation par satellite Galileo, le système européen de gestion du trafic ferroviaire et le programme visant à améliorer les infrastructures de gestion du trafic aérien. Les normes en matière de trafic et de sécurité pour les transports routiers (état technique des véhicules, transport des marchandises dangereuses, sécurité des infrastructures routières) ont été sévèrement renforcées. Les droits des passagers sont aussi mieux protégés grâce à la mise en œuvre d’un ensemble complet de droits pour tous les modes de transport: routier, aérien, ferroviaire et maritime/fluvial. Tous les passagers, y compris les personnes handicapées et à mobilité réduite, ont le droit d’obtenir des informations exactes et en temps utile, une assistance et, dans certaines circonstances, une indemnisation en cas d’annulation ou de retard important.
Les investissements dans les infrastructures de transport de l’Union font partie des priorités du programme massif d’investissements publics annoncé par la Commission Juncker en 2014.

© Image Broker/Belga
Avec l’union bancaire, l’Union européenne a mis en place des règles plus strictes afin que les banques fonctionnent dans un cadre solide et sûr.
La politique commune de la concurrence est l’indispensable corollaire de l’application des règles de liberté des échanges au sein du marché intérieur européen. Elle est appliquée par la Commission européenne, qui en est la garante avec la Cour de justice.
Le principe de cette politique est de garantir une concurrence juste et équitable entre les entreprises. Le respect de ces règles profite aux consommateurs, aux entreprises et à l’ensemble de l’économie européenne.
Toute entente tombant sous le coup des règles du traité est soumise à une notification auprès de la Commission européenne, laquelle peut imposer directement une amende aux entreprises qui ne respecteraient pas son jugement, comme ce fut le cas pour l’entreprise Microsoft, finalement amenée à payer une astreinte de 900 millions d’euros en 2008. Toute concentration d’entreprises qui pourrait créer une situation de position dominante doit être notifiée à la Commission. En 2017, la Commission a infligé à Google une amende de 2,42 milliards d’euros pour abus de position dominante sur le marché des moteurs de recherche, pour avoir promu ses services de comparaison de prix en ligne dans ses résultats de recherche, et dégradé ceux de ses concurrents.
En ce qui concerne les aides non notifiées ou illégales, la Commission peut en exiger le remboursement. Les avantages fiscaux octroyés par les pouvoirs publics à des entreprises individuelles peuvent également être considérés comme des aides d’État illégales. Par exemple, en août 2016, la Commission européenne a conclu que l’Irlande avait accordé à Apple des avantages fiscaux indus pour un montant de 13 milliards d’euros.
La législation de l’Union vise à assurer à tous les consommateurs de l’Union, où qu’ils vivent, voyagent ou effectuent leurs achats, un niveau commun élevé de protection contre les risques qui menacent leur santé ou leurs intérêts économiques. La crise de la vache folle en 1997 a véritablement rendu indispensable une intervention de l’Union dans des mesures de précaution à l’échelle de l’Union. C’est ainsi qu’a été créée, en 2002, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, dont l’expertise scientifique doit permettre une législation adaptée dans ce domaine.
Par ailleurs, l’intervention de l’Union est également nécessaire dans bien d’autres secteurs, comme la sécurité des produits cosmétiques, des jouets, des feux d’artifice, etc. L’Agence européenne des médicaments gère depuis 1993 les procédures d’autorisation de commercialisation des produits pharmaceutiques. Aucun médicament ne peut être mis sur le marché s’il n’a pas reçu d’autorisation.
De même, l’Union européenne intervient pour protéger les consommateurs contre la publicité trompeuse et mensongère, les produits défectueux et les abus dans le cadre des crédits à la consommation ou de la vente par correspondance ou par l’internet.
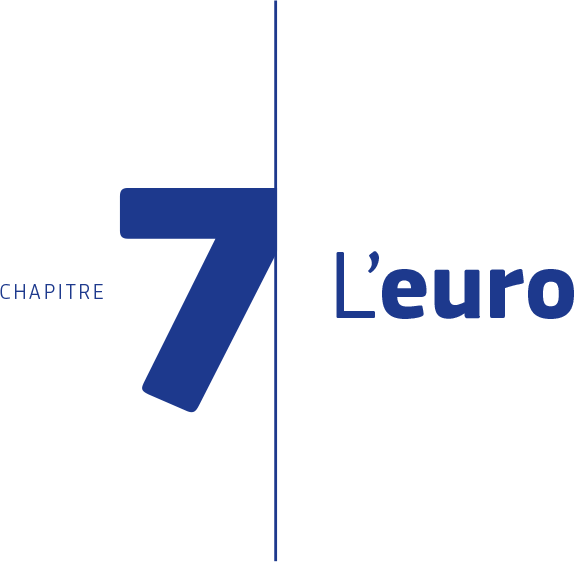
À la suite de la décision des États-Unis en 1971 de supprimer la relation fixe entre le dollar et l’étalon-or qui permettait la stabilité monétaire mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale, il est mis fin au système de taux de change fixes. Les gouverneurs des banques centrales de la Communauté économique européenne décident de réduire à 2,25 % les marges de fluctuation entre les monnaies européennes et créent le système monétaire européen, qui entre en vigueur en mars 1979.
Au Conseil européen de Madrid, en juin 1989, les dirigeants européens adoptent un plan en trois phases pour une Union économique et monétaire. Ce plan est intégré au traité de Maastricht sur l’Union européenne, adopté par le Conseil européen en décembre 1991.
La première phase s’est ouverte le 1er juillet 1990. Elle comprenait:
La deuxième phase a débuté le 1er janvier 1994. Elle comprenait:
La troisième phase a ouvert la voie à la naissance de l’euro: le 1er janvier 1999, les monnaies des États participants laissent progressivement la place à l’euro qui devient ainsi, le 1er janvier 2002, la monnaie commune de la Belgique, de l’Allemagne, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de l’Autriche, du Portugal et de la Finlande. La Banque centrale européenne est désormais responsable de la politique monétaire qui est définie et exécutée en euros.
Le Danemark, la Suède et le Royaume-Uni ont décidé, pour des raisons politiques et techniques, de ne pas participer à l’euro lors de son lancement.
La Slovénie a rejoint la zone euro en 2007, suivie de Chypre et de Malte en 2008, puis de la Slovaquie en 2009, de l’Estonie en 2011, de la Lettonie en 2014 et de la Lituanie en 2015.
Dix-neuf États membres participent ainsi à la zone euro, et les autres États membres, à l’exception de ceux qui ont obtenu une dérogation par traité, les rejoindront au fur et à mesure qu’ils rempliront les critères requis.
Afin de rejoindre la zone euro, chaque pays de l’Union doit remplir les cinq critères de convergence suivants:

© mastermilmar/Shutterstock
L’euro, la monnaie unique depuis 1999, a permis aux consommateurs et aux entreprises de comparer plus facilement les prix au sein de l’Europe.
Le Conseil européen d’Amsterdam de juin 1997 adopte un pacte de stabilité et de croissance qui est un engagement permanent de stabilité budgétaire, permettant de sanctionner financièrement un pays membre de la zone euro qui s’exposerait à un déficit budgétaire supérieur à 3 % du produit intérieur brut. La même idée est approfondie en 2012, lorsque les gouvernements de vingt-cinq États membres signent un accord international intitulé «Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire». Également connu sous le nom de «pacte budgétaire», cet accord oblige les États membres signataires à intégrer des règles relatives à l’équilibre budgétaire dans leur législation nationale.
Un certain nombre de pays de la zone euro sont encore loin, quelques années après la crise économique qui a éclaté en 2008, de satisfaire aux exigences de ce traité. La Commission et l’Eurogroupe exercent la vigilance nécessaire pour conduire les États concernés à corriger leurs trajectoires, en particulier par la réduction de leur endettement.
L’Eurogroupe est la réunion des ministres des finances des pays membres de la zone euro. Ces réunions ont pour objet une meilleure coordination des politiques économiques et la surveillance des politiques budgétaires et financières des États membres, ainsi que la représentation de l’euro dans les enceintes monétaires internationales. L’Eurogroupe a été institutionnalisé par le traité de Lisbonne. Son président, le ministre néerlandais des finances Jeroen Dijsselbloem, a été élu à ce poste en 2013, et, en juillet 2015, il a été élu pour un second mandat.
La crise financière de 2008 a fortement accru les déficits publics de la plupart des États membres de l’Union. L’euro a servi de bouclier contre le risque de dévaluation qui aurait frappé les économies les plus vulnérables face à la crise et aux attaques spéculatives des marchés.

© Danita Delimont/gettyimages
Le mécanisme européen de stabilité a permis d’aider les pays de l’Union européenne particulièrement touchés par la crise économique, telle la Grèce.
Au début de la crise, de nombreuses banques ont connu des difficultés qui ont conduit à leur renflouement par les gouvernements nationaux, ce qui a entraîné une hausse de la dette publique. L’attention s’est ensuite tournée vers celle-ci, car certains États membres ont été particulièrement touchés par ces attaques en 2009-2010, compte tenu de l’aggravation des déficits de leurs finances publiques et de leur endettement. C’est la raison pour laquelle les dirigeants de l’Union ont mis en place le «mécanisme européen de stabilité», un pare-feu doté d’une capacité de prêt de 500 milliards d’euros, garantie par les pays de la zone euro, et utilisé pour préserver la stabilité financière dans la zone euro. Au cours de la période 2010-2013, cinq pays (l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, Chypre et le Portugal) ont conclu des accords d’assistance financière avec différents organes de l’Union et le Fonds monétaire international. Ces accords, bien qu’adaptés à la situation de chacun de ces pays, impliquaient généralement des réformes visant à renforcer l’efficacité du secteur public dans le pays concerné. À la fin de l’année 2013, l’Irlande a été le premier pays à mener à bien le programme d’ajustement économique ainsi convenu et à recommencer à emprunter de l’argent directement sur les marchés des capitaux. L’Espagne et le Portugal ont également progressé dans le rétablissement des équilibres économiques et cessé de se trouver sous l’assistance financière de l’Union en 2014. Chypre a suivi en 2016.
La Grèce, qui a bénéficié de 2010 à 2014 de deux programmes d’ajustement financés par l’Union européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international pour un montant total de 226 milliards d’euros, a éprouvé des difficultés à remplir ses engagements en termes de contreparties dans les réformes structurelles de son économie (réforme de la fonction publique, privatisations, retraites, etc.). Des négociations tendues entre les institutions, les États membres réunis à plusieurs reprises au plus haut niveau et les autorités grecques ont finalement conduit à valider, en août 2015, un troisième plan d’aide en échange d’engagements fermes de la part du gouvernement grec de mener des politiques importantes de redressement des finances publiques et de réformes structurelles.
Dans le cadre de la réponse à la crise, les États membres et les institutions de l’Union ont également activé les dispositions du traité de Lisbonne destinées à renforcer la gouvernance économique de l’Europe: dès le 15 octobre de chaque année, les États membres doivent présenter à la Commission leur avant-projet de budget pour l’année suivante. Ils sont ensuite tenus d’apporter les corrections nécessaires proposées par la Commission pour suivre les trajectoires de convergences décidées en commun. La discussion préalable des projets de budget des États membres, la surveillance des économies nationales et le renforcement des règles de compétitivité, avec des sanctions si des pays enfreignent les règles financières, constituent progressivement le socle d’une gouvernance économique et monétaire commune entre les pays de la zone euro.
Ainsi, sous la pression des évolutions économiques et financières mondiales, l’Union européenne est conduite à renforcer ses mécanismes de solidarité et de responsabilité budgétaire et financière, garantissant par là même la crédibilité de l’euro comme monnaie unique et permettant aux économies des États membres de mieux faire face ensemble aux défis de la mondialisation. L’impérative coordination des politiques économiques et sociales est soulignée par la Commission et le Parlement, qui considèrent qu’une union monétaire n’est pas viable à long terme sans un gouvernement économique commun.
Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, s’appuyant sur un rapport élaboré par les présidents des cinq institutions concernées par l’Union économique et monétaire, a proposé, en 2015, une série de mesures visant à consolider la zone euro: un système commun garantissant aux citoyens européens que leur épargne bancaire sera toujours protégée; la représentation unique de l’euro au sein des institutions financières mondiales, comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale; un système de surveillance économique et budgétaire plus efficace et plus démocratique; une convergence des politiques fiscales vers plus d’équité et de transparence; enfin, un marché du travail véritablement paneuropéen sur la base d’un socle européen des droits sociaux. L’ensemble serait couronné par la mise en place d’un Trésor de la zone euro.
La Banque centrale européenne a également, durant cette période, interprété son mandat de façon large et volontariste pour contribuer à la relance de l’économie européenne. En 2015, elle a lancé un ambitieux programme d’«assouplissement quantitatif», qui consiste en achats massifs de titres de dettes, essentiellement publiques, dans l’objectif de soutenir la reprise et de favoriser l’investissement.

Au début des années 90, la mondialisation a commencé à révolutionner l’économie et la vie quotidienne dans toutes les régions du monde, y compris en Europe. Les économies sont devenues de plus en plus interdépendantes et participent à une «économie globale». La production européenne est soumise à la vive concurrence des pays émergents, principalement la Chine et les pays asiatiques, qui bénéficient de coûts salariaux bien plus compétitifs; cette concurrence ébranle le modèle de société européenne fondé sur la redistribution sociale ainsi que sur le maintien d’un niveau de vie élevé. Par ailleurs, la révolution technologique ainsi que l’arrivée de l’internet et des nouvelles technologies de l’information et de la communication ont ouvert de nouvelles perspectives de croissance et d’emploi.
Plus récemment, le monde a été ébranlé par d’importantes crises économiques et financières. La crise des subprimes américains et de l’endettement européen a provoqué en Europe la plus grave récession économique depuis celle de 1929, qui avait conduit au désastre de la Seconde Guerre mondiale. Le coût social de la récession, qui a marqué un pic en 2010 et commencé à s’inverser au profit d’une croissance modérée à partir de 2014, s’est traduit par une hausse massive du chômage, en particulier dans les pays du Sud, frappant de plein fouet la jeunesse.
La principale priorité pour les pays de l’Union a été de réduire leur endettement public qui s’était brutalement accru sous l’effet de la hausse des dépenses des États et des collectivités locales. Certains États se sont engagés vigoureusement dans la voie du désendettement; d’autres ont obtenu de la Commission des délais supplémentaires pour atteindre l’objectif des 3 % du déficit annuel public à ne pas dépasser. Les choix politiques qui guident les gouvernements dans ces efforts de redressement concernent directement les citoyens: acceptent-ils une augmentation de l’âge du départ à la retraite, un aménagement des prestations sociales, une modernisation de l’appareil administratif? Connaissent-ils les conséquences pour leur sécurité des dépenses militaires, et la nécessité en période de troubles internationaux de les maintenir ou même de les augmenter? Les échéances électorales qui rythment la vie politique de nos démocraties interfèrent avec ces choix dont la dimension européenne n’est pas toujours perçue par les opinions publiques.
L’Union et ses institutions ont joué un rôle actif durant cette décennie pour redresser l’économie européenne. Alors que les mesures destinées à consolider l’Union économique et monétaire se mettaient en place (voir le chapitre 7), la Commission a lancé différentes initiatives conçues pour accroître la productivité des économies européennes et renforcer la cohésion sociale.

© shock/Adobe Stock
Avec un marché de capitaux plus efficace en Europe, les jeunes peuvent obtenir des investissements et créer de nouvelles entreprises.
Les vingt-huit États membres ont décidé, à travers cette stratégie:
Plaçant son mandat sous le signe d’un programme ambitieux pour stimuler la croissance, l’emploi et l’investissement, le président de la Commission Jean-Claude Juncker a lancé en 2014 un plan d’investissement de 315 milliards d’euros pour la période 2015-2017, à travers un nouveau Fonds européen pour les investissements stratégiques, en partenariat avec la Banque européenne d’investissement. Compte tenu du succès de la première année du Fonds, le président Juncker a parlé, lors de son discours sur l’état de l’Union en septembre 2016, d’un montant de 500 milliards d’euros à l’horizon 2020 et de 630 milliards pour l’année 2022. Avec la garantie et les fonds européens engagés, la Commission mise sur l’effet multiplicateur des crédits publics auprès des investisseurs privés.
Le Fonds concentrera ses investissements sur les infrastructures, notamment les réseaux à haut débit et les réseaux énergétiques, les infrastructures de transport dans les centres industriels, l’éducation, la recherche et l’innovation, les énergies renouvelables, ainsi que les petites et moyennes entreprises. En 2016, la Commission a proposé d’utiliser un système identique pour promouvoir l’investissement en Afrique et dans les pays voisins de l’Europe.
Dans le même temps se développe le chantier très prometteur pour l’Europe de l’économie numérique. L’internet et les technologies numériques transforment le monde dans lequel nous vivons en modifiant le système des productions, des distributions et des services, et en multipliant les offres au profit des consommateurs.

© lmgorthand/iStock
L’accès aux films, à la musique et aux services en ligne d’un autre pays européen, c’est ce qu’on appelle le «marché unique numérique».
Comment maximaliser le potentiel de croissance de l’économie numérique? En procédant à une révision ambitieuse de la réglementation en matière de télécommunications et en remédiant à la fragmentation des marchés, notamment pour les réseaux à haut débit sécurisés.
Pour le moment, trop d’obstacles demeurent dans le commerce en ligne à l’échelle européenne. Seuls 7 % des petites entreprises vendent leurs produits à l’étranger. Un marché numérique totalement intégré pourrait contribuer, selon la Commission, à hauteur de 415 milliards d’euros par an à l’économie de l’Union et créer 3,8 millions d’emplois. Il s’agit en particulier d’harmoniser les règles concernant les contrats et la protection des consommateurs pour les achats en ligne, et d’encourager les services de livraisons transfrontalières des colis et de faire baisser leurs coûts.

La citoyenneté européenne est consacrée dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’article 20, paragraphe 1: «[…] Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.» Mais, dans la pratique, que signifie la citoyenneté européenne?
Le premier droit du citoyen européen est de pouvoir circuler, résider et travailler dans toute l’Union.
Les États membres ont adopté une directive instaurant un système de reconnaissance mutuelle des diplômes de l’enseignement supérieur. Ce texte s’applique à toutes les formations universitaires d’une durée minimale de trois ans et est fondé sur le principe de la confiance mutuelle dans la validité des filières d’enseignement et de formation.

© germanacom/fotolia
Les citoyens européens peuvent s’établir et travailler où ils le souhaitent dans l’Union.
Hormis les activités entraînant des prérogatives de puissance publique (la police, l’armée, les affaires étrangères, etc.), les services de santé, l’enseignement et les services publics commerciaux s’ouvrent à tout ressortissant d’un pays de l’Union. Quoi de plus naturel que de recruter un professeur allemand pour enseigner l’allemand à des élèves de Rome ou d’inciter un jeune diplômé belge à tenter un concours administratif en France?
Depuis 2004, les citoyens européens qui se déplacent dans l’Union européenne peuvent obtenir une carte européenne d’assurance maladie, délivrée par les États membres, qui leur facilite la prise en charge des soins médicaux éventuellement nécessaires lors de leurs voyages.
Cependant, le ressortissant d’un État membre n’est pas seulement un consommateur ou un acteur de la vie économique et sociale. Il est aussi un citoyen de l’Union, avec des droits politiques en conséquence. L’Europe des citoyens a en effet gagné en qualité depuis le traité de Maastricht: tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a un droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et européennes.
Le traité de Lisbonne institue le «droit d’initiative européen»: les citoyens peuvent, dès lors qu’ils réunissent 1 million de signatures provenant d’au moins sept États membres, demander à la Commission de proposer un projet de loi.
L’engagement de l’Union en faveur des droits des citoyens a été confirmé de façon solennelle par la proclamation, en décembre 2000, à Nice, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette charte a été élaborée par une convention composée de parlementaires européens et nationaux, de représentants des gouvernements nationaux et d’un membre de la Commission. Elle regroupe en six chapitres — «Dignité», «Libertés», «Égalité», «Solidarité», «Citoyenneté» et «Justice» — 54 articles définissant les valeurs fondamentales de l’Union européenne ainsi que les droits civils et politiques, économiques et sociaux du citoyen européen.
Les premiers articles sont consacrés à la dignité humaine, au droit à la vie, au droit à l’intégrité de la personne, à la liberté d’expression et au droit à l’objection de conscience. Le chapitre «Solidarité» innove en incorporant des droits sociaux et économiques tels que:
La charte promeut aussi l’égalité entre les hommes et les femmes et instaure des droits comme la protection des données, l’interdiction des pratiques eugéniques et du clonage reproductif des êtres humains, un niveau élevé de protection de l’environnement, les droits des enfants et des personnes âgées ou le droit à une bonne administration.
Le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, attribue à la charte la même valeur juridique que les traités, tout en incluant un protocole sur son application en Pologne et au Royaume-Uni. Les citoyens européens peuvent désormais l’évoquer devant la Cour de justice.
La Commission assure un suivi actif auprès des États membres pour la transposition complète de la directive concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie au moyen du droit pénal.
Par ailleurs, dans son article 6, le traité de Lisbonne offre à l’Union la base juridique pour adhérer à la convention européenne des droits de l’homme. Celle-ci ne sera alors plus seulement une référence dans les traités, mais deviendra applicable à l’Union, au sein de laquelle seront ainsi renforcés les droits de l’homme.
Le sentiment d’appartenir à une même collectivité, de partager le même destin, ne peut être créé artificiellement. L’Europe culturelle doit dorénavant prendre le relais de l’Europe économique et contribuer à la formation d’une conscience commune.
L’organisation des écoles et de l’enseignement ainsi que le contenu exact des programmes sont toujours décidés au niveau national ou local. L’Union gère cependant des programmes sous l’appellation «Erasmus+» permettant aux étudiants et aux jeunes ouvriers de se rendre à l’étranger, de participer à des activités scolaires transnationales, d’apprendre de nouvelles langues, etc. Plus de 4 millions de personnes devraient bénéficier d’un soutien au cours de la période 2014-2020. Le budget d’Erasmus+ a été augmenté de 40 % sur cette période pour atteindre 16 milliards d’euros.
Dans le cadre du processus de Bologne a été institué un espace européen de l’enseignement supérieur facilitant la reconnaissance mutuelle des périodes d’études ainsi que la comparaison des qualifications pour l’obtention des diplômes communs (licence/bachelor, master, doctorat).
Dans le domaine de la culture, le programme européen «Europe créative» stimule la coopération entre les programmateurs, les promoteurs, les organismes de radiodiffusion et les opérateurs culturels de différents pays. Il aide à produire davantage de produits audiovisuels européens et à rétablir l’équilibre entre la production européenne et la production américaine.
La diversité linguistique de l’Union européenne est l’une de ses principales caractéristiques. La préserver est l’un des principes de fonctionnement de l’Union européenne. La législation européenne doit être disponible dans les vingt-quatre langues officielles. Les parlementaires européens peuvent dès lors s’exprimer dans toutes ces langues lors des débats au Parlement européen.
Pour rapprocher l’Union européenne de ses citoyens, le traité sur l’Union européenne a instauré le Médiateur européen. Le Médiateur, également appelé «Ombudsman» selon une tradition scandinave, est désigné par le Parlement européen pour la durée de sa législature. Son mandat l’habilite à recevoir les plaintes contre les institutions ou les organes de l’Union européenne. La saisine du Médiateur appartient à tout citoyen de l’Union et à toute personne morale et physique résidant ou ayant un siège statutaire dans un État membre.
Plus encore, la pratique bien établie du Parlement européen consistant à accepter des pétitions de toute personne résidant dans un État membre constitue un lien important entre les citoyens et les institutions.
L’Europe des citoyens est à peine née: elle reposera aussi sur la multiplication des symboles d’identification commune, tels que le passeport européen, en circulation depuis 1985. Une devise a été adoptée: «Unie dans la diversité». Le 9 mai est déclaré «Journée de l’Europe».
L’hymne (l’Ode à la joie de Beethoven) et le drapeau (un cercle de douze étoiles d’or sur un fond azur) ont été adoptés en 1985 comme les symboles de l’Union les plus importants. Les États membres, les autorités locales et les citoyens qui le souhaitent peuvent en faire usage.
Par ailleurs, le sentiment d’appartenance est conditionné par la bonne connaissance et la compréhension de ce que fait l’Union. Aussi les institutions européennes et les États membres doivent-ils faire plus pour expliquer l’Union de manière compréhensible aux citoyens.
Les citoyens ont également besoin de sentir que l’action de l’Union a une influence directe sur leur vie quotidienne. C’est en cela que la mise en circulation en 2002 de la monnaie unique a eu un effet psychologique important. Le consommateur gère ses comptes bancaires en euros. Grâce à la fixation des prix des biens de consommation et des services dans la même monnaie, utilisée par les deux tiers de la population de l’Union, il a une vision transparente du marché.
La suppression des contrôles de police aux frontières entre la plupart des pays membres dans le cadre de l’accord de Schengen accroît déjà la conscience d’appartenir à un espace unifié.
Pour se sentir appartenir à l’Union, le citoyen européen a aussi et surtout besoin de pouvoir peser dans la prise de décisions. L’élection directe au Parlement européen depuis 1979, à laquelle tout citoyen européen majeur a le droit de participer, a ainsi établi un lien de légitimité directe entre le processus d’intégration et la volonté populaire. L’élection indirecte du président de la Commission, lors des élections européennes de mai 2014, à la suite d’une campagne animée par les partis politiques européens présentant chacun leur candidat à cette fonction, a créé un précédent qui réduira progressivement ce que certains appellent la fracture démocratique au sein de l’Union.

© germanacom/fotolia
Concilier vie familiale et vie professionnelle est l’un des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
L’Union européenne est née pour servir les peuples d’Europe. L’implication des citoyens, quel que soit leur milieu social, doit aller en s’accroissant: «Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes», disait Jean Monnet dès 1952. L’adhésion de l’opinion publique à l’idée européenne reste le grand défi auquel doivent faire face non seulement les institutions, mais également les États membres et les acteurs de la société civile.

Les citoyens européens sont en droit de vivre librement sans crainte de persécution ni de violence, où qu’ils se trouvent sur le territoire de l’Union. Cependant, la criminalité internationale et le terrorisme sont parmi les phénomènes les plus préoccupants pour les Européens d’aujourd’hui. La création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice s’est imposée au fil des années, par des amendements successifs aux traités.
Le traité de Lisbonne, en vigueur depuis 2009, renforce l’efficacité de la prise de décisions dans la constitution et la gestion de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, longtemps réservé aux États membres agissant dans un cadre intergouvernemental et laissant peu de pouvoirs à la Commission et au Parlement. Désormais, le Conseil de ministres vote le plus souvent à la majorité qualifiée, le Parlement dispose du pouvoir de codécision et la Commission dispose d’un droit d’initiative.
La libre circulation des personnes pose aux États membres des problèmes de sécurité liés à la perte de contrôle des frontières intérieures. Des mesures de sécurité compensatoires sont nécessaires pour corriger cette perte de contrôle, en mettant l’accent sur la défense commune des frontières extérieures et sur la coopération policière et judiciaire dans la lutte contre la criminalité qui, désormais, peut s’organiser sur la totalité du territoire de l’Union.
L’une des initiatives les plus importantes destinées à faciliter les voyages des citoyens au sein de l’Union européenne tire son origine d’un accord intergouvernemental entre l’Allemagne, la France et les pays du Benelux, signé dans la petite ville frontalière luxembourgeoise de Schengen, en 1985. Il supprime les contrôles sur les personnes, quelle que soit leur nationalité, aux frontières entre les États membres, harmonise les contrôles aux frontières extérieures de l’Union et introduit une politique commune en matière de visas. Les non-ressortissants de l’Union ne doivent pas tous posséder un visa pour pénétrer dans l’espace Schengen. Des exemptions s’appliquent aux pays avec lesquels l’Union a signé des accords en ce sens. De Helsinki à Lisbonne, de Palerme à Tallinn, les citoyens européens et les ressortissants de pays ne faisant pas partie de l’Union ont pris l’habitude de voyager sans contrôle de police. Toutefois, en cas d’urgence, les États membres peuvent temporairement réintroduire des contrôles aux frontières intérieures.
Aujourd’hui, l’acquis de Schengen a été entièrement intégré dans les traités constitutifs de l’Union. L’espace Schengen s’est progressivement élargi. En 2017, tous les États membres de l’Union, à l’exception de la Bulgarie, de l’Irlande, de la Croatie, de Chypre, de la Roumanie et du Royaume-Uni, appliquaient les dispositions de Schengen. Quatre pays tiers, à savoir l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, font également partie de l’espace Schengen.

© Associated Press
En 2015, face à l’arrivée massive des demandeurs d’asile en Europe, l’Union européenne a lancé de nombreuses nouvelles mesures.
Le renforcement des contrôles aux frontières extérieures est devenu une priorité. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Frontex, située à Varsovie, a été fondée en 2004. Les États membres mettent à sa disposition des navires, des hélicoptères et des avions en vue de constituer des patrouilles communes dans des zones sensibles, par exemple en Méditerranée. Il a été décidé de renforcer la capacité d’intervention rapide aux frontières et de transformer l’agence en un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. L’inauguration de celui-ci a eu lieu en octobre 2016.
L’Europe est fière de sa tradition humanitaire d’accueil des étrangers et d’asile pour les réfugiés menacés et persécutés. Les gouvernements de l’Union sont aujourd’hui confrontés à la question pressante de savoir comment réagir, dans un espace dépourvu de frontières intérieures, face à un nombre élevé d’immigrants légaux et illégaux.
Les gouvernements de l’Union sont convenus d’harmoniser leurs règles de telle façon que les demandes d’asile soient examinées conformément à un ensemble de principes de base uniformément reconnus dans toute l’Union européenne. Des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile ainsi que pour l’octroi du statut de réfugié ont été adoptées.
La lutte contre l’immigration irrégulière a été érigée en priorité pour faire face à l’afflux massif d’immigrés clandestins sur les côtes européennes. Des directives permettent aux États membres de lutter ensemble contre la traite des êtres humains et de favoriser la reconnaissance mutuelle des mesures d’éloignement. Dans le même temps, l’immigration légale a été mieux coordonnée par des directives sur le regroupement familial, le statut des résidents de longue durée et l’admission des ressortissants des pays tiers à des fins d’études et de recherches.
Néanmoins, les arrivées massives de réfugiés en provenance du Proche-Orient et d’Afrique, qui se sont dramatiquement accélérées en 2015 et 2016 avec plus de 1 million de personnes et la mort de plusieurs milliers d’entre elles en Méditerranée, ont donné une nouvelle dimension à la problématique du droit d’asile et de l’accueil des réfugiés. La distinction entre réfugiés politiques et réfugiés économiques est difficile à établir, et les pays les plus exposés aux afflux massifs sur leurs côtes et à leurs frontières, telles l’Italie et la Grèce, attendent de leurs partenaires une plus grande solidarité et un partage du fardeau. L’Allemagne, pour sa part, est le pays qui a été en 2015 le plus largement ouvert aux réfugiés politiques.
Les dirigeants de l’Union sont convenus un nombre de mesures pour faire face à cette nouvelle situation. Cela inclut des décisions visant à relocaliser les demandeurs d’asile arrivant en Grèce et en Italie vers d’autres pays de l’Union et à accélérer le retour des personnes qui ne peuvent bénéficier de l’asile. L’Union a conclu un accord avec la Turquie sur ces questions, étant donné que de nombreux demandeurs d’asile ont traversé la mer à partir de la Turquie pour se diriger vers la Grèce. L’Union a envoyé des experts d’autres pays pour aider à faire face à ces afflux sur place; elle a renforcé les capacités du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pour mener des opérations de recherche et de sauvetage et pour combattre les réseaux criminels; et elle a aussi lancé une mission militaire dans le bassin méditerranéen.
Plus de 10 milliards d’euros du budget de l’Union ont été consacrés, en 2015, 2016 et 2017, à l’aide humanitaire aux réfugiés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union.
Un effort coordonné est nécessaire pour combattre les associations de malfaiteurs qui organisent des filières clandestines d’immigration et pratiquent le trafic et l’exploitation des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.
La criminalité organisée devient de plus en plus sophistiquée et utilise régulièrement des réseaux européens ou internationaux pour pratiquer ses activités. Elle a montré qu’elle pouvait frapper avec une brutalité extrême, n’importe où dans le monde.
C’est dans ce contexte qu’a été créé le système d’information Schengen. Il s’agit d’une base de données complexe qui permet aux forces de l’ordre et aux autorités judiciaires compétentes d’échanger des données à des fins d’enquête sur des personnes et des biens, par exemple des personnes recherchées en vue d’une arrestation ou d’une extradition ou des véhicules ou des œuvres d’art volés. Une nouvelle génération de ce système permet d’accroître le nombre et la nature des données stockées et de recourir à des systèmes biométriques d’identification des personnes.
Suivre la piste des fonds illégaux est aussi l’une des meilleures méthodes pour traquer les criminels. C’est pour cette raison, autant que pour bouleverser le financement des organisations criminelles, que l’Union se tourne vers une législation portant sur le blanchiment d’argent.
L’avancée de loin la plus considérable enregistrée ces dernières années dans la coopération entre les forces de l’ordre a été la mise sur pied de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), un organisme propre de l’Union européenne, établi à La Haye, composé de fonctionnaires de police et des douanes. L’Union a élargi les responsabilités d’Europol, qui comprennent le trafic de drogue et de véhicules volés, la traite des êtres humains ainsi que les réseaux d’immigration clandestine, l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, la pornographie, la contrefaçon, le trafic des matières radioactives et nucléaires, le terrorisme, le blanchiment d’argent et la falsification de l’euro.
L’offensive du terrorisme islamiste en Europe, menée par Al-Qaida et accentuée par le soi-disant «État islamique», Daech, frappe l’opinion publique en s’attaquant aux symboles des valeurs de l’Union: la liberté de pratiquer son culte et d’exprimer ses opinions. L’attentat à la rédaction d’un journal satirique à Paris en 2015 et les tueries massives de civils qui l’ont suivi en Europe désignent un ennemi difficilement prévisible dont les bases militaires et financières se trouvent au Moyen-Orient et en Afrique. La coopération policière et entre les services de renseignements occidentaux devra nécessairement, pour éradiquer cette menace frappant au cœur de l’Europe, être couplée avec une action politico-militaire menée en dehors des frontières de l’Union.
À travers ces attentats, ce sont les valeurs fondamentales de l’Europe qui sont visées. La Commission propose de créer un centre d’excellence chargé de centraliser et de diffuser l’expertise dans le domaine de la radicalisation, de tarir les ressources financières des terroristes par la coopération des cellules de renseignements financiers en Europe et de renforcer la lutte contre la cybercriminalité, en particulier la propagande djihadiste sur l’internet.
Les mesures prises en 2015 contre le terrorisme international incluent un meilleur contrôle par les compagnies aériennes des noms des passagers qui entrent ou sortent de l’Union. Ce contrôle est devenu obligatoire et se matérialise par la mise en place d’un fichier («données des dossiers passagers»), mis à la disposition des services de renseignements. Certains partisans de l’intégration européenne vont plus loin en proposant une coopération intégrée entre les services de renseignements des États membres.
Dans l’Union européenne coexistent actuellement des systèmes judiciaires différents, cloisonnés par les frontières nationales. Mais la criminalité internationale et le terrorisme ne respectent pas ces frontières. C’est pourquoi l’Union européenne a besoin d’un cadre de travail commun pour combattre le terrorisme, le trafic de drogue et la contrefaçon, cela afin de garantir aux citoyens européens un haut degré de protection et de renforcer la coopération internationale dans ce domaine. L’Union a aussi besoin d’une politique commune en matière de justice et de criminalité, afin d’assurer que la coopération entre les tribunaux des différents pays ne soit pas alourdie par leurs définitions divergentes de certains actes criminels.

© European Union
Les dirigeants européens ont renforcé le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pour améliorer la sécurité des frontières extérieures de l’Union européenne.
Le travail d’Eurojust, une structure centrale de coordination installée à La Haye depuis 2003, constitue la coopération opérationnelle la plus significative. Eurojust doit permettre aux autorités nationales chargées des poursuites de travailler ensemble sur des enquêtes criminelles impliquant plusieurs États membres. Sur la base de l’expérience acquise par Eurojust, le Conseil a décidé de nommer un procureur public européen. Le rôle de ce procureur sera d’enquêter et de poursuivre les atteintes contre les intérêts financiers européens.
Le mandat d’arrêt européen, qui est applicable depuis janvier 2004 et remplace les longues procédures d’extradition, est un autre outil utile pour la coopération transfrontalière.
En matière de droit civil, l’Union européenne s’est dotée d’une législation qui facilite l’application des décisions de justice dans des affaires transnationales traitant de divorce, de séparation, de garde d’enfants et de créance alimentaire, de telle manière que les décisions de justice prises dans un pays soient également applicables dans un autre. L’Union européenne a établi des procédures communes pour simplifier et accélérer le règlement de litiges transnationaux dans des affaires au civil peu importantes et dont l’issue est non contestée, telles que des recouvrements de dettes et des faillites.

L’Union européenne a atteint le statut de grande puissance mondiale sur les plans économique, commercial et monétaire. D’autres ont dit qu’elle est devenue un géant économique mais est restée un «nain politique». L’expression est excessive. L’Union européenne pèse de tout son poids dans les enceintes internationales, telles que l’Organisation mondiale du commerce, les organismes spécialisés de l’Organisation des Nations unies, les sommets mondiaux sur l’environnement et le développement.
Cependant, les États membres de l’Union doivent faire encore de nombreux progrès aux niveaux diplomatique et politique pour s’exprimer d’une seule voix sur les enjeux décisifs de la planète. Plus encore, les systèmes de défense militaire — le cœur des souverainetés nationales — restent aux mains des dirigeants nationaux, liés entre eux seulement par les engagements contractés dans le cadre des alliances telles que l’Alliance atlantique.
La politique étrangère et de sécurité commune et la politique de sécurité et de défense commune, prévues par les traités de Maastricht (1992), d’Amsterdam (1997) et de Nice (2001), ont défini les principales missions de l’Union en matière de politique étrangère. L’Union a ainsi développé son «deuxième pilier» — un domaine d’action où prédominent les concertations intergouvernementales, ne faisant intervenir que marginalement la Commission et le Parlement. Le mode de décision est fondé sur le consensus avec la possibilité pour tel ou tel État de s’abstenir. Le traité de Lisbonne, s’il supprime la structure en piliers de l’Union européenne, ne modifie pas pour autant ce mode de fonctionnement en matière de sécurité et de défense. Toutefois, il renforce la visibilité de la politique étrangère et de sécurité en créant le poste de haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
Federica Mogherini occupe cette fonction depuis 2014. Elle est également vice-présidente de la Commission européenne et a pour tâche de représenter le point de vue de l’Union et d’agir au nom de celle-ci au sein des organisations et des conférences internationales. Pour ce faire, elle est assistée du Service européen pour l’action extérieure, composé de fonctionnaires européens et nationaux et qui, dans les faits, est un véritable service diplomatique européen.
La politique étrangère de l’Union vise essentiellement à assurer la sécurité, la stabilité, la démocratie et le respect des droits de l’homme, non seulement dans son proche voisinage, comme les Balkans, mais également dans tous les points chauds du monde, comme l’Afrique, le Proche-Orient ou le Caucase. Cette politique participe de la «puissance douce». Elle comprend: les missions de soutien à la démocratie, notamment lors des processus électoraux; l’aide humanitaire (plus de 1,5 milliard d’euros versés en 2015 et plus de 5 milliards d’euros affectés, depuis le début de la guerre en Syrie, aux populations déplacées); et l’aide au développement, qui représente 60 % de l’aide mondiale et qui assiste les pays les plus démunis dans leurs efforts pour combattre la pauvreté, contrer les pénuries alimentaires, prévenir les catastrophes naturelles, accéder à l’eau et prévenir les épidémies. Cette stratégie de l’Union est accompagnée d’une promotion active, auprès des États concernés, des principes de l’état de droit, de respect des droits de l’homme, de soutien à la société civile et d’encouragement à la libéralisation du commerce. La Commission et le Parlement européen veillent particulièrement à la transparence de ces aides budgétaires, qui doivent être gérées dans un esprit de bonne gouvernance.
Le grand défi à venir pour l’Union est de pouvoir aller au-delà de cette diplomatie de l’assistance technique et financière. Une réalisation concrète majeure sur le front diplomatique a été le rôle décisif joué par l’Union dans l’accord entre l’Iran et les grandes puissances en 2015, relatif au programme nucléaire de l’Iran et à la levée des sanctions économiques envers ce pays.
L’Union est aussi très active dans les négociations internationales concernant la guerre civile en Syrie.
Toutefois, les déclarations et positions communes énoncées par le Conseil européen sur les grandes questions internationales sont trop souvent considérées comme le plus petit dénominateur commun. Les diplomaties traditionnelles des grands États membres n’ont pas encore renoncé à jouer un rôle particulier. C’est pourtant quand elle s’exprime d’une seule voix que l’Union est perçue comme un acteur véritable sur la scène internationale. Son poids économique et commercial et la progressive mise en place de la politique étrangère et de sécurité commune devraient faire progresser sa crédibilité et son influence.
Depuis 2003, l’Union dispose d’une «capacité opérationnelle» lui permettant de conduire des opérations de gestion de crise. Cette capacité s’appuie sur des contributions nationales que les États membres choisissent de mettre au service de l’Union pour ses opérations de politique de sécurité et de défense commune.
L’exécution de ces opérations est confiée à un ensemble d’organes politico-militaires: le Comité politique et de sécurité, le Comité militaire de l’Union, le Comité de gestion civile des crises et l’État-major de l’Union. Ces organes sont placés sous l’autorité du Conseil et sont situés à Bruxelles.
Cet ensemble d’outils forme le corps même de la politique de sécurité et de défense commune et offre à l’Union la possibilité de mener à bien les objectifs qu’elle s’est fixés: missions humanitaires, missions de maintien ou de rétablissement de la paix. Dans ce cadre, il est essentiel d’éviter toute duplication avec l’OTAN, ce que garantissent les accords dits «Berlin plus» passés entre l’OTAN et l’Union, assurant à l’Union l’accès aux moyens logistiques de l’OTAN (détection, communication, commandement et transport).
Depuis 2003, l’Union européenne a ainsi lancé plus d’une trentaine d’opérations militaires et missions civiles, dont la première, en Bosnie-Herzégovine, a remplacé les forces de l’OTAN. Ces différentes missions et opérations sont ou ont été déployées sur trois continents, sous drapeau européen. En voici quelques exemples: l’opération Atlanta dans le golfe d’Aden pour lutter contre la piraterie somalienne; la mission pour aider le Kosovo à établir durablement l’état de droit; la mission en Afghanistan pour aider à la formation de la police afghane; l’opération de formation militaire au Mali et celle de sécurité civile en Ukraine, ainsi que l’opération Sophia lancée en juin 2015 pour porter secours aux réfugiés naufragés en Méditerranée et arraisonner les bateaux des passeurs.
De plus, le prix très élevé et la sophistication croissante des technologies militaires rendent toujours plus nécessaires les coopérations industrielles entre les États membres de l’Union en matière d’industrie d’armement. Cet effort est considéré par les États membres comme d’autant plus impératif qu’ils se sont engagés, dans un contexte de crise économique, à réduire leur déficit public. De même, l’éventuelle intervention conjointe des forces armées européennes sur un théâtre extérieur impose de faire progresser la standardisation et l’interopérabilité des matériels. Dans cette optique, l’Agence européenne de défense a été créée en 2003 afin de soutenir le développement des capacités militaires de l’Union.
Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a évoqué la nécessité, à terme, de bâtir une véritable défense commune européenne. Cette perspective devrait s’imposer au fur et à mesure que les Européens prendront conscience des intérêts communs de sécurité qui les lient dans la défense de leurs intérêts stratégiques et de leurs valeurs. Aucune puissance actuelle, grande ou petite, ne peut plus assumer seule l’ensemble des missions militaires à même de garantir la sécurité de sa population dans un monde en pleine ébullition.
L’Union européenne a la compétence de conclure des accords commerciaux au nom de ses États membres. L’Europe dispose, grâce à son poids commercial, d’un instrument d’influence internationale considérable. L’Union est favorable au système fondé sur les règles définies par l’Organisation mondiale du commerce, forte de 161 membres, qui constitue un gage de sécurité juridique et de transparence dans la conduite du commerce international. L’Organisation fournit un cadre dans lequel ses membres ont la possibilité de se défendre contre des pratiques déloyales, comme le dumping — la vente de produits à des prix inférieurs à leur coût —, utilisées par des exportateurs pour concurrencer leurs rivaux. Enfin, l’Organisation mondiale du commerce prévoit une procédure de règlement des différends dans le cas où un litige surgit entre deux partenaires commerciaux ou plus.
La politique commerciale de l’Union européenne est étroitement liée à sa politique de développement. Dans le cadre de son système de préférences généralisées, l’Union accorde un accès en franchise de droits de douane ou un accès préférentiel à taux réduit à son marché à la plupart des importations en provenance des pays en développement et des économies en transition. Elle va encore plus loin avec les 49 pays les plus pauvres du monde, dont l’intégralité des exportations — à la seule exception des armes — peut bénéficier d’un accès au marché de l’Union en franchise de droits de douane.
En revanche, l’Union européenne n’a pas d’accords commerciaux spécifiques avec ses principaux partenaires commerciaux parmi les pays développés, tels que les États-Unis et le Japon, pour lesquels les relations commerciales sont gérées au moyen de mécanismes mis en place dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. Des accords bilatéraux sont toutefois en cours de négociation. Un accord économique et commercial a déjà été conclu entre le Canada et l’Union européenne en 2014. Cet accord a été signé par les deux parties en octobre 2016.
Une grande négociation a débuté en 2013 entre l’Union et les États-Unis sur un accord de libre-échange, le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement, connu sous le nom de «TTIP». Elle porte sur les barrières douanières, l’harmonisation des normes, l’accès aux marchés publics et la reconnaissance des appellations d’origine. Les deux partenaires représentent 40 % du commerce mondial et 800 millions de consommateurs. Les enjeux sont considérables, notamment pour s’assurer que les futures normes mondiales ne seront pas définies et imposées par d’autres grands compétiteurs, en particulier la Chine. Dans les négociations avec les États-Unis, l’Union insiste sur le respect de ses normes élevées en matière de sécurité alimentaire, de protection sociale et de protection des données, ainsi que sur sa diversité culturelle. L’Union escompte un impact positif sur la croissance des pays européens quand cet accord transatlantique entrera en vigueur.
L’Union européenne accroît ses échanges avec les nouvelles puissances émergentes et les autres régions du monde, telles que l’Amérique latine et l’Amérique centrale, la Chine et l’Inde. Ces accords commerciaux prévoient également des coopérations d’ordre technique et culturel. La Chine est devenue le deuxième partenaire commercial de l’Union après les États-Unis et sa première source d’importations. Pour la Russie, l’Union représente le principal partenaire commercial et la plus grande source d’investissements à l’étranger. La sécurité des approvisionnements énergétiques, particulièrement du gaz, le commerce et les questions transfrontalières sont au cœur de l’orientation stratégique des relations entre l’Union européenne et la Russie. Néanmoins, les sanctions prises par l’Union à l’égard de la Russie à la suite de l’annexion de la Crimée en 2014 ont sensiblement perturbé les courants d’échanges et d’investissements entre les deux ensembles.

© Andy Aitchison/In Pictures/Corbis
L’Union européenne encourage l’ouverture des marchés et le développement des échanges dans le monde.
La relation entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne est ancienne: elle date de la conception même du traité de Rome, en 1957, qui faisait des pays et des territoires d’outre-mer de certains États membres des associés. Le processus de décolonisation entamé au début des années 60 a transformé ce lien en une association d’un type différent, entre pays souverains.
L’accord de Cotonou, signé en 2000 dans la capitale du Bénin, marque une nouvelle étape de la politique de développement de l’Union européenne. Cet accord, qui lie l’Union aux États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, est l’accord le plus ambitieux et le plus vaste conclu entre des pays développés et des pays en développement. Il a succédé à la convention de Lomé, signée en 1975 dans la capitale du Togo, puis régulièrement mise à jour.
Cet accord comporte des changements qualitatifs considérables par rapport à ceux qui l’ont précédé, puisqu’il passe de relations commerciales fondées sur l’accès au marché à des relations commerciales plus étendues. De nouvelles procédures ont été définies pour faire face aux problèmes de violation des droits de l’homme.

© Tim Freccia/Associated Press
L’Union déploie des missions civiles ou militaires de maintien de la paix, comme cette opération de lutte contre la piraterie au large de la Somalie.
L’Union a consenti des concessions commerciales particulières pour tous les pays les moins développés, dont 39 sont signataires de l’accord de Cotonou. Depuis 2005, ils peuvent exporter librement pratiquement tous les types de produits sur le marché de l’Union.
Mais cette politique traditionnelle, pour favorable qu’elle soit aux intérêts des pays africains, est loin de suffire aux défis actuels. Une partie des pays de l’Afrique subsaharienne connaissent des taux de croissance élevés, grâce à l’exploitation de leurs immenses ressources naturelles, ce qui leur permet d’améliorer leurs infrastructures et d’élever progressivement le niveau de vie de leurs populations. Mais d’autres régions restent dramatiquement frappées par les guerres civiles et interreligieuses, la déstabilisation du Sahel, la montée d’un fanatisme destructeur incarné par le groupe Boko Haram, les guerres civiles et les dictatures dans la Corne de l’Afrique.
Les réfugiés politiques et climatiques qui, dans un contexte de démographie toujours très élevée, seraient tentés de rejoindre l’Europe par tous les moyens sont déjà très nombreux et se compteront en millions dans les années à venir. L’Union, au-delà de l’aide humanitaire qu’elle tente d’apporter, doit définir et s’engager dans une stratégie économique de grande ampleur sur le continent africain pour stabiliser sur place les populations. Elle devra enfin s’accorder sur une politique d’immigration qui planifie ses besoins en main-d’œuvre dans un continent, l’Europe, qui commence à faire face à un déclin démographique et à une lente inversion de la pyramide des âges.
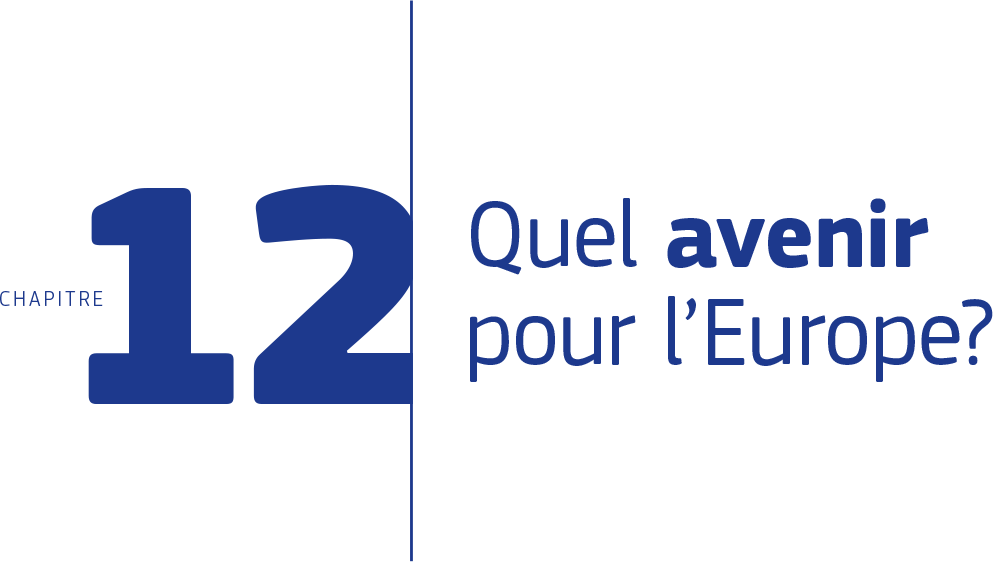
Le 9 mai 1950, Robert Schuman scellait l’acte de naissance politique de la construction européenne en déclarant: «L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble: elle se fera par des réalisations concrètes, créant d’abord une solidarité de fait.» Soixante-six années plus tard, la formule garde toute sa valeur pour l’avenir de l’Union. Les solidarités entre les peuples et les nations de l’Europe doivent constamment être adaptées pour faire face aux nouveaux défis posés par un monde en pleine mutation.
Cela a toujours été le cas tout au long de l’histoire de l’Union européenne. Au cours des premières années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, l’accent a été mis sur l’augmentation de la production en veillant à la sécurité alimentaire des populations. L’achèvement du marché unique, au début des années 90, a été une réalisation majeure. Au cours des années suivantes, l’euro et la Banque centrale européenne ont été créés afin de rendre le marché plus efficace. Dans le même temps, des efforts substantiels ont été accomplis pour surmonter les divisions créées par les régimes communistes pendant la guerre froide. Par ailleurs, la crise économique qui sévit depuis 2008 a mis en évidence le fait que l’euro était vulnérable face aux attaques des spéculateurs mondiaux. Afin de remédier à cette situation, les États membres ont statué sur une coordination plus étroite de leurs politiques économiques nationales et entrepris de mettre en place une union bancaire. Plus récemment, les défis en matière de sécurité et d’immigration et la crise des réfugiés ont dominé l’agenda européen.
Jean Monnet, inspirateur des mécanismes et de la philosophie de la construction communautaire, concluait ainsi ses Mémoires en 1976: «Les nations souveraines du passé ne sont plus le cadre où peuvent se résoudre les problèmes du présent. Et la Communauté elle-même n’est qu’une étape vers les formes d’organisation du monde de demain.»
Faut-il se résigner à considérer, en 2017, que l’Union n’est plus un projet politique pertinent face à la mondialisation? Ou faut-il au contraire se demander comment mieux valoriser le potentiel dont disposent plus de 500 millions d’Européens qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes intérêts?
Dans une Union qui compte presque une trentaine de membres, dont les histoires, les langues, les cultures sont si diverses, peut-on créer un espace politique commun, une conscience partagée «d’être Européen», tout en restant profondément attaché à sa nation, à sa région, à sa communauté? Cela est possible si les États, petits, moyens ou grands, choisissent d’observer entre eux le principe d’égalité des droits et de respect des minorités qui a fait le succès de la première Communauté, issue de la guerre et fondant sa légitimité morale sur la réconciliation et la consolidation de la paix.

© FatCamera/iStock
Les Européens travaillent ensemble aujourd’hui pour construire leur avenir de demain.
Sera-t-il possible de continuer à aller de l’avant dans la construction européenne au nom d’une volonté commune des États et des peuples de l’Union européenne? On pourrait considérer que les mécanismes de coopération renforcée — qui permettent à un groupe d’États membres volontaires d’aller plus loin et plus vite dans le domaine de leur choix —, s’ils se multipliaient, pourraient conduire à une situation dans laquelle chaque État membre aurait le choix de participer ou non à telle politique ou à telle institution. Cette solution peut sembler d’une simplicité attrayante, mais l’Union repose depuis toujours sur la notion de solidarité, à savoir la mutualisation des avantages et des coûts. Cela veut dire avoir des règles et des politiques communes.
Les événements récents ont fortement mis l’accent sur la coopération européenne dans les secteurs traditionnellement réservés à la souveraineté nationale: par exemple en matière de sécurité et de défense ainsi que dans les domaines de la justice et des affaires intérieures — en particulier sur la question des réfugiés. Il est probable que ce sont les domaines où l’Union rencontrera les plus grands défis et où il est impératif de trouver des solutions communes, assurant ainsi aux citoyens un plus grand sentiment de sécurité et une confiance renouvelée dans l’Union européenne.
L’Europe, dans la mondialisation considérée comme une confrontation économique entre grandes puissances traditionnelles (États-Unis, Europe, Japon) et nouvelles puissances émergentes à croissance rapide (Brésil, Chine, Inde), peut-elle encore restreindre l’accès à son marché au nom de la protection sociale et des normes environnementales? Même si elle optait pour une telle stratégie défensive, elle ne pourrait s’abstraire de la réalité de la compétition internationale. Au contraire, l’Union peut jouer son rôle d’acteur mondial à condition qu’elle se présente de plus en plus unie pour exprimer ses intérêts, ce qui suppose qu’elle progresse vers l’union politique.
Parallèlement, l’Union doit impérativement se rapprocher de ses citoyens. Réélu au suffrage universel direct tous les cinq ans, le Parlement européen a gagné du pouvoir à chaque modification des traités. Néanmoins, la participation des électeurs à cette consultation reste inégale selon les pays et trop souvent insuffisante. Comment les États membres (notamment à travers l’éducation, les mouvements associatifs, etc.) et les institutions de l’Union pourront-ils établir une meilleure communication avec les citoyens européens et favoriser l’émergence d’un espace public et politique commun, dans lequel ceux-ci se reconnaîtront? Cela constitue un important défi auquel les États membres comme les institutions doivent plus volontairement s’atteler pour résorber l’euroscepticisme qui favorise les populismes et fragilise la démocratie.
L’une des grandes forces de l’Union réside dans sa capacité à diffuser les valeurs européennes au-delà de ses frontières: des valeurs telles que le respect des droits de l’homme et l’état de droit, la protection de l’environnement et une économie libre dans un cadre stable et organisé, capable de maintenir des normes sociales élevées. Dans la mesure où l’Europe saura affirmer ses valeurs, d’autres régions du monde s’emploieront à s’en inspirer comme d’un exemple positif.
Ce qui pourrait finalement permettre de juger si l’Europe aura accompli à l’avenir sa mission en atteignant des objectifs concrets au service des citoyens dépendra des réponses qu’elle saura ou non apporter aux questions suivantes:
Si nous pouvons le faire, l’Europe continuera à être respectée et à demeurer une source d’inspiration pour le reste du monde.


EN LIGNE
Des informations dans toutes les langues officielles de l’Union européenne sont disponibles sur le site Europa:
https://europa.eu/european-union/index_frEN PERSONNE
Partout en Europe, il existe des centaines de centres d’information locaux de l’Union européenne.
Pour connaître l’adresse du centre le plus proche, visitez la page suivante:
PAR TÉLÉPHONE OU PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne.
Vous pouvez contacter ce service par téléphone gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certains opérateurs de téléphonie mobile n’autorisent pas l’accès aux numéros 00 800 ou peuvent facturer ces appels), ou par téléphone payant depuis l’extérieur de l’Union européenne: +32 22999696, ou par courrier électronique à l’adresse https://europa.eu/european-union/contact_fr
LECTURES À PROPOS DE L’EUROPE
Les publications sur l’Union européenne ne sont qu’à un clic de souris sur le site internet:
op.europa.eu/fr/web/general-publications/publicationsREPRÉSENTATIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
BUREAUX D’INFORMATION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DÉLÉGATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE
12 leçons sur l’Europe
Commission européenne
Direction générale de la communication
Information des citoyens
1049 Bruxelles
BELGIQUE
Manuscrit actualisé en août 2017

© Union européenne, 2017
Réutilisation autorisée. La politique de réutilisation des documents de la Commission européenne est régie par la décision 2011/833/UE (JO L 330 du 14.12.2011, p. 39). Toute utilisation ou reproduction de photos ou d’autres documents dont l’Union européenne n’est pas titulaire des droits d’auteur est interdite sans l’autorisation des titulaires des droits d’auteur.
| ISBN 978-92-79-71568-6 | doi:10.2775/528356 | NA-04-17-736-FR-N | |
| ISBN 978-92-79-71579-2 | doi:10.2775/74090 | NA-04-17-736-FR-C | |
| HTML | ISBN 978-92-79-71614-0 | doi:10.2775/03535 | NA-04-17-736-FR-Q |
En personne
Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres d’information Europe Direct sont à votre disposition. Pour connaître l’adresse du centre le plus proche, visitez la page suivante: https://europa.eu/european-union/contact_fr
Par téléphone ou courrier électronique
Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne. Vous pouvez prendre contact avec ce service:
En ligne
Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les langues officielles de l’Union, sur le site internet Europa à l’adresse https://europa.eu/european-union/index_fr
Publications de l’Union européenne
Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes à l’adresse https://op.europa.eu/fr/web/general-publications/publications. Vous pouvez obtenir plusieurs exemplaires de publications gratuites en contactant Europe Direct ou votre centre d’information local (https://europa.eu/european-union/contact_fr).
Droit de l’Union européenne et documents connexes
Pour accéder aux informations juridiques de l’Union, y compris à l’ensemble du droit de l’Union depuis 1951 dans toutes les versions linguistiques officielles, consultez EUR-Lex à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu
Données ouvertes de l’Union européenne
Le portail des données ouvertes de l’Union européenne (https://data.europa.eu/euodp/fr) donne accès à des ensembles de données provenant de l’Union. Les données peuvent être téléchargées et réutilisées gratuitement, à des fins commerciales ou non commerciales.